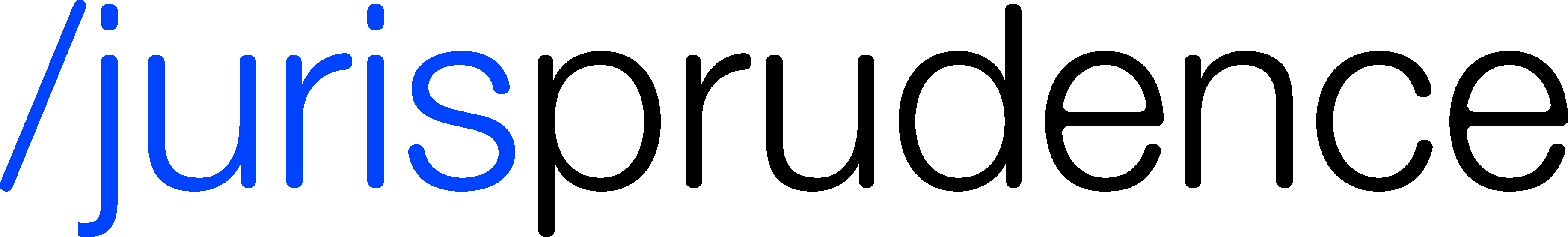Répondre à moitié, risquer le tout : responsabilité pénale et droit d’accès selon la LPD

I. Un contexte révélateur
Une personne concernée (le « Requérant ») a exercé son droit d’accès auprès de TX Group SA et ainsi demandé si TX Group SA traitait des données personnelles la concernant. Le juriste d’entreprise de TX Group SA a initialement répondu qu’au sein du groupe, Tamedia avait pu trouver deux données personnelles concernant le Requérant dans leur système, tandis que le 20 Minuten n’avait trouvé aucune donnée personnelle le concernant. Le Requérant a alors signalé que les informations communiquées à propos du 20 Minuten étaient manifestement incomplètes. TX Group SA a de ce fait reconnu l’existence d’autres données personnelles, mais a refusé leur communication en se fondant sur les restrictions au droit d’accès applicables aux médias de l’art. 27 LPD. Ainsi, selon l’art. 27 al. 1 LPD, lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements si (i) les données fournissent des indications sur les sources d’information, (ii) un droit de regard sur des projets de publication en résulterait ou (iii) la libre formation de l’opinion publique serait compromise.
Sur plainte, le Statthalteramt Bezirk Zürich a considéré qu’en indiquant que le 20 Minuten ne traitait aucune donnée personnelle du Requérant, le juriste d’entreprise avait donné l’impression que les informations transmises suite à la requête d’accès du Requérant étaient complètes, alors que d’autres données personnelles du Requérant étaient en réalité traitées. Le juriste d’entreprise aurait donc sciemment fourni des informations inexactes ou incomplètes tout en donnant l’impression erronée que ces informations étaient exhaustives. Ce faisant, le juriste d’entreprise a intentionnellement violé l’art. 60 al. 1 let. a LPD et a été condamné par le Statthalteramt Bezirk Zürich à payer une amende de CHF 600.-. La motivation de cette décision est particulièrement lacunaire, en ce qu’elle n’examine, inter alia, ni le pouvoir décisionnel effectif ni l’intention sous-jacente à la première réponse incomplète du juriste d’entreprise.
II. Une fausse apparence d’exhaustivité ?
La responsabilité pénale prévue à l’art. 60 al. 1 let. a LPD ne s’applique que lorsque la réponse à une requête d’accès est intentionnellement inexacte ou incomplète, tout en donnant l’impression, à tort, qu’elle est exhaustive. Autrement dit, ni le refus pur et simple ni une réponse partielle indiquée comme telle ne suffisent pour que l’infraction soit commise. À l’inverse, pour que celle-ci soit réalisée, la personne concernée doit avoir été intentionnellement induite en erreur quant à l’existence ou à l’étendue des données en cause.
Cette interprétation a par ailleurs été confirmée par une décision non publiée du Ministère public de Soleure, rapportée par datenrecht.ch, selon laquelle seule la communication d’informations fausses ou incomplètes donnant une fausse impression d’exhaustivité est pénalement répréhensible. Le simple fait de refuser ou d’ignorer une requête d’accès n’est donc pas réprimé. Dans cette affaire, le Ministère public n’a constaté aucune fausse information ou omission trompeuse : le responsable de traitement s’était simplement abstenu de répondre dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 25 al. 7 LPD. Aucune infraction à l’art. 60 al. 1 let. a LPD n’était dès lors réalisée.
Il est toutefois intéressant de noter que, par la présente décision, le Statthalteramt Bezirk Zürich considère que le simple risque théorique d’induire la personne concernée en erreur, sans que cette dernière ne soit effectivement et concrètement trompée, est suffisant pour violer l’art. 60 al. 1 let. a LPD.
Or, à notre sens, une telle appréciation doit être strictement limitée : seule une tromperie effective — c’est-à-dire une erreur concrète et avérée de la personne concernée — devrait être retenue comme fondement d’une sanction pénale. En l’absence d’une telle erreur concrète, la question devrait plutôt relever du droit civil, qui offre les mécanismes appropriés pour réparer un éventuel préjudice causé par l’erreur en question.
Cela étant dit, la décision du Statthalteramt Bezirk Zürich n’est pas définitive. Il sera donc intéressant d’observer si le juriste d’entreprise fait opposition, et si tel est le cas, quelle sera l’appréciation que portera l’autorité de deuxième instance sur ce point.
III. Un pouvoir de sanction important
Les dispositions pénales de la LPD (art. 60 ss LPD) confèrent aux autorités compétentes le pouvoir de prononcer des amendes pouvant atteindre 250 000 CHF.— en cas de violation grave. Ce montant, bien que sensiblement inférieur aux plafonds prévus par le RGPD européen (EUR 20’000’000.- ou 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, art. 83 al. 5 RGPD), demeure exceptionnel dans le contexte du droit suisse (en effet, les amendes sont en principe d’un montant maximum de CHF 10’000.- (art. 106 al. 1 CP).
Il convient en outre de souligner que les sanctions prévues par la LPD visent exclusivement les personnes physiques — contrairement au RGPD qui vise également les personnes morales. La possibilité de prononcer une amende pouvant atteindre 250 000 CHF.— à l’encontre d’une personne physique constitue donc une sanction particulièrement lourde, ce qui renforce encore la portée dissuasive de ces amendes. Ce choix législatif traduit ainsi la volonté claire du législateur d’assurer un véritable effet préventif face aux atteintes graves à la protection des données.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, selon le montant de l’amende prononcée, l’infraction pourra être inscrite au casier judiciaire de la personne condamnée : en effet, conformément à l’art. 18 al. 1 let. c ch. 3 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (« LCJ »), les jugements portant sur une contravention de plus de CHF 5’000.- sont, notamment, inscrits au casier judiciaire. L’inscription est supprimée après dix ans et n’apparaît pas sur l’extrait ordinaire ou spécial du casier judiciaire qu’une personne physique peut demander à titre privé (art. 41 et 42 LCJ cum art. 40 LCJ).
Dans ce contexte, l’amende de CHF 600.- prononcée à l’encontre du juriste d’entreprise, bien qu’inférieure au plafond prévu par la LPD, représente une charge financière non négligeable pour une personne physique.
Et ce d’autant plus que c’est l’employé, en sa qualité de personne directement visée par la sanction pénale, qui en supporte personnellement les conséquences. Il est intéressant de noter à cet égard que la doctrine est divisée quant à la licéité pour une entreprise de prendre en charge une amende prononcée à l’encontre d’un employé. Ainsi, certains auteurs considèrent que, du fait du caractère strictement personnel de l’amende, son paiement par un tiers pourrait constituer un acte de favorisation d’un délinquant au sens de l’art. 305 CP, dans la mesure où cela irait à l’encontre du but répressif visé par la sanction pénale.
D’autres auteurs, majoritaires et dont nous partageons l’avis, rejettent cette interprétation, estimant que le paiement d’une amende par un tiers n’est pas pénalement répréhensible, dès lors qu’il n’entrave pas l’exécution de la sanction. Selon ces auteurs, le simple fait que l’amende soit effectivement acquittée — indépendamment de l’identité du payeur — ne saurait être considéré comme une entrave à la justice. En tout état de la cause, force est de constater qu’il est, en pratique, difficile de déterminer qui assume réellement la charge financière de la sanction.
En l’absence de jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, les responsables de traitement et employés en chargés des requêtes d’accès devraient demeurer prudents avant de décider de l’allocation d’une amende, que ce soit a posteriori ou lors de la conclusion du contrat de travail.
IV. Enjeux pratiques et perspectives
Pour les entreprises, cette affaire met en exergue la nécessité d’instaurer des procédures rigoureuses pour le traitement des requêtes d’accès au sens de l’art. 25 LPD, ainsi que de former avec diligence les collaborateurs chargés d’y répondre, afin de prévenir tout risque de sanction. Il est en particulier essentiel que la première réponse à une requête d’accès soit complète et précise, sans donner lieu à une impression erronée de divulgation exhaustive. À cet égard, il convient d’éviter toute garantie, explicite ou implicite, d’exhaustivité. Par ailleurs, certaines formulations, telles que « nous n’avons pas réussi à trouver […] », bien qu’elles ne soient pas inexactes, pourraient tromper le requérant et suffire à motiver une condamnation pénale.
Sur le plan institutionnel, il serait souhaitable que les autorités compétentes en matière d’application des dispositions pénales de la LPD précisent les conditions dans lesquelles l’art. 60 al. 1 let. a LPD trouve à s’appliquer. Comme mentionné plus haut, il conviendrait en particulier de déterminer si la simple possibilité abstraite d’induire une personne en erreur suffit à constituer une infraction au sens de cette disposition, ou s’il est nécessaire qu’une erreur concrète ait effectivement été provoquée. Une telle clarification est essentielle afin de renforcer la sécurité juridique.
La décision du Statthalteramt Bezirk Zürich n’étant pas définitive, il convient d’observer si le juriste d’entreprise formera opposition. Le cas échéant, il sera intéressant de voir si cette opposition conduira à une réévaluation du montant de l’amende ou à une réflexion plus large sur les conditions d’application des dispositions pénales de la LPD.
Proposition de citation : Claire Tistounet / Philipp Fischer, Répondre à moitié, risquer le tout : responsabilité pénale et droit d’accès selon la LPD, 15 juillet 2025 in www.swissprivacy.law/366

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.