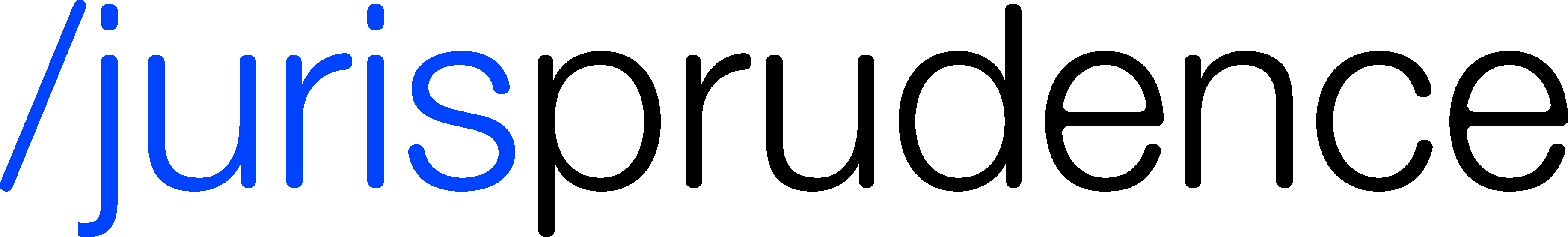Les services d’agents de footballeurs, un marché sous (hyper-)surveillance ?

Introduction
En qualité d’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA supervise l’activité des 211 associations nationales. Ces dernières, ainsi que tous les acteurs de l’industrie du football – soit les clubs, les joueurs et leurs agents –, sont tenus de se conformer aux règlements de la FIFA et d’observer ses décisions.
Le 6 janvier 2023, la FIFA publie le Règlement FIFA sur les agents (« Règlement FIFA ») adopté le mois précédent, par lequel elle cherche notamment à rehausser les standards de la profession d’agent, à limiter les conflits d’intérêts entre les différents acteurs de l’industrie du football (p.ex. : évitant les cas de double-représentation), à renforcer la transparence et à lutter contre toute pratique abusive, excessive ou spéculative (art. 1 par. 2 Règlement FIFA). La FIFA y conditionne le droit d’exercer le métier d’agent de joueurs à l’obtention d’une licence et régit notamment la rémunération, les activités et la conduite des agents. À titre illustratif, la FIFA impose aux agents de d’indiquer diverses informations relatives à leurs activités (p.ex. : noms de leurs clients ; nature, contenu et durée du contrat conclu avec ceux-ci ; détails de toutes les transactions, y compris le montant des indemnités versées aux agents ; etc.), lesquelles sont ensuite mises à disposition des clubs, joueurs ou agents de joueurs (art. 19 Règlement FIFA).
Un agent, l’agence RRC Sports – dont l’agent est directeur général – et le vice-président de l’association d’agents de joueurs « Football Forum » ont introduit une action en cessation pour limiter l’application du Règlement FIFA. En effet, ils estiment que certaines dispositions violent les art. 56 (libre prestation des services), 101 (interdiction des ententes) et 102 TFUE (interdiction des abus de position dominante) ainsi que l’art. 6 RGPD. Amené à statuer, le Landgericht Mainz a décidé d’interroger la CJUE sur la comptabilité du Règlement FIFA avec les dispositions précitées.
Bien que les questions préjudicielles couvrent plusieurs domaines du droit, la présente contribution se concentre sur les aspects de protection des données.
Application du RGDP au secteur du sport
Dans un premier temps, l’avocat général analyse l’applicabilité du droit européen au sport (semi-)professionnel. Il rappelle que selon la jurisprudence de la CJUE, le droit européen a vocation à s’appliquer à l’ensemble du domaine sportif lorsque celui-ci constitue une activité économique. En revanche, les règles (p.ex. : les règles de jeu) sont extraites du champ d’application du droit européen et bénéficient ainsi d’une « exception sportive » à condition qu’elles aient été adoptées uniquement pour des motifs d’ordre non-économique et qu’elles n’intéressent que le sport en tant que tel.
Dans la suite de ses développements relatifs à l’exception sportive, l’avocat général s’épanche sur la question de son applicabilité à la libre circulation et au droit de la concurrence, mais n’expose pas la situation qui prévaut en droit de la protection des données.
À notre sens, le droit de la protection des données s’applique pleinement au sport (semi-)professionnel. En effet, l’applicabilité du RGPD est exclue dans quatre situations, en particulier lorsque le traitement s’inscrit dans le cadre d’une activité ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union (art. 2 par. 2 let. a RGPD) ou lorsque celui-ci est effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique (art. 2 par. 2 let. c RGPD). Ces exceptions doivent être interprétées strictement (CJUE, arrêt du 10 juillet 2018 dans l’affaire C25/17, par. 37).
La première exception n’est toutefois pas applicable car l’Union européenne est habilitée à agir à la fois en matière de marché intérieur (art. 4 par. 2 TFUE let. a TFUE) et en matière de sport (art. 6 let. e TFUE). Quant à la seconde, elle suppose que le traitement ait lieu sans aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale (cf. consid. 18 RGPD), ce qui suppose qu’elle s’inscrive uniquement dans le cadre de la vie privée et familiale de la personne physique (CJUE, arrêt du 10 juillet 2018 dans l’affaire C25/17, par. 42). Or, les traitements en cause concernent le sport (semi-)professionnel et donc une activité commerciale, de sorte que l’art. 2 par. 2 let. c RGPD n’est pas applicable. Par conséquent, aucune exception n’est applicable au secteur du sport (semi-)professionnel.
Dans l’hypothèse où la réglementation en cause portait sur le sport amateur, elle serait également soumise au RGPD faute d’activité s’inscrivant uniquement dans le cadre de la vie privée et familiale. Ainsi, le RGPD demeure en principe applicable aux litiges touchant le secteur du sport.
Les règles relatives à la production et à la divulgation d’informations à examiner
Après avoir orienté l’autorité de renvoi quant aux éléments à prendre en compte lors de l’examen de possibles violations du droit de la concurrence et de la libre circulation, l’avocat général analyse l’existence d’une potentielle violation de l’art. 6 par. 1 let. f RGPD.
En effet, l’art. 16 Règlement FIFA oblige les agents à partager, à travers une plateforme gérée par la FIFA, diverses informations relatives aux accords de service conclus avec les clients, au paiement d’indemnités et à la coopération entre agents. Les agences doivent également fournir des informations sur le nombre d’agents qui opèrent à travers elles et le nom de tous leurs employés. La FIFA met ensuite toutes ces données à disposition sur sa plateforme, en particulier les informations relatives aux clients, aux services fournis par les agents, aux transactions impliquant des agents ainsi qu’à leur rémunération (art. 19 Règlement FIFA).
L’art. 6 par. 1 let. f RGPD dispose qu’un traitement de données personnelles est licite s’il est « nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel […] ». Pour se fonder sur cette disposition, le traitement doit cumulativement respecter trois conditions. Tout d’abord, il doit poursuivre un intérêt légitime. Ensuite, le traitement doit être nécessaire pour réaliser les intérêts poursuivis. Enfin, la pondération des intérêts en présence doit conduire à la conclusion que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées ne prévalent pas sur les intérêts poursuivis par le responsable de traitement ou le tiers (pour un développement de ces conditions, cf. Nathan Philémon Matantu, L’intérêt légitime au sens de l’art. 6 par. 1 let. f RGPD : un examen en trois étapes, 5 février 2025 in www.swissprivacy.law/336).
Avant de procéder à la subsomption, l’avocat général rappelle à juste titre que seules les personnes physiques – c’est-à-dire les agents, leurs employés, les employés d’agences, les joueurs et les employés des clubs – peuvent tirer des arguments d’une éventuelle violation de l’art. 6 par. 1 let. f RGPD. En revanche, les personnes morales (p.ex. : les agences ou les clubs) ne sont pas habilitées à le faire, dans la mesure où le RGPD ne protège que les personnes physiques (art. 1 par. 1 RGPD).
Plusieurs intérêts envisageables, mais sont-ils légitimes ?
L’avocat général souligne que la notion d’« intérêt légitime » est juridiquement indéterminée et peut ainsi couvrir divers intérêts, y compris des intérêts économiques. Un intérêt est notamment susceptible d’être légitime lorsqu’une relation entre la personne concernée et le responsable du traitement préexiste, en particulier lorsque la première est cliente du second ou qu’elle est à son service (consid. 47 RGPD).
La présente relation entre les agents et la FIFA diffère toutefois de la relation classique client-service. Cela étant, les agents représentent les acteurs de l’industrie footballistique et les conseillent à l’aune du cadre réglementaire de la FIFA. En constituant un maillon essentiel de cet écosystème, les agents sont ainsi suffisamment liés à la FIFA.
Au-delà de cette relation de proximité, l’art. 1 par. 2 Règlement FIFA énumère huit intérêts justifiant l’adoption du Règlement FIFA. Alors que certains d’entre eux sont manifestement légitimes – il en est ainsi de la limitation des conflits d’intérêts, de la lutte contre les pratiques abusives et du contrôle de la conformité au Règlement FIFA –, d’autres convainquent plus difficilement l’avocat général. L’intérêt à améliorer la transparence financière et administrative entre dans cette seconde catégorie.
En effet, l’avocat général considère que la transparence est un intérêt légitime lorsqu’il est question d’une activité publique. En revanche, la situation est moins évidente lorsque les activités économiques des personnes privées sont en cause. D’une part, l’intérêt à la transparence doit être pondéré avec le respect de la vie privée de la personne concernée. D’autre part, une transparence concernant des informations économiques et financières peut avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement des marchés (p.ex. : favoriser des actes de concurrence déloyale). Par conséquent, il invite la juridiction de renvoi à vérifier, dans chaque cas, dans quel but la transparence devrait être garantie.
Dans l’ensemble, les orientations de l’avocat général sur la question de la transparence sont convaincantes, mais deux remarques s’imposent selon nous.
En premier lieu, les catégories « activité publique » et « activité économique » ne sont pas adaptées à la situation particulière de la FIFA. La FIFA ne déploie certes pas d’activité publique, mais il n’en demeure pas moins qu’elle exerce, en parallèle de ses activités économiques et avec le consentement exprès ou tacite des autorités nationales et de l’Union européenne, un rôle d’autorégulateur de fait de l’écosystème football. Or, dans la mesure où ce sont bien les rôles de régulateur et de surveillant du marché qui sont en cause, la FIFA devrait pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime à recevoir certaines données personnelles et à les partager.
En second lieu, comme semble le reconnaître implicitement l’avocat général, il existe des constellations où il y a un intérêt légitime à publier des données personnelles, les rendant ainsi accessibles aux autres acteurs du marché. Les données publiées par les autorités de surveillance des marchés financiers (p.ex. : la liste des titulaires d’autorisation) constituent des exemples de constellations où il y a un intérêt légitime à rendre publiques certaines informations de nature économique.
Dans le présent contexte, il peut y avoir un intérêt légitime à publier certaines données personnelles, notamment le nom des agents titulaires d’une licence et certaines sanctions telles que la suspension ou le retrait d’une licence. Dans le même temps, le fait qu’il y ait un intérêt légitime à imposer une transmission des données personnelles à la FIFA ne signifie pas nécessairement qu’il y a un intérêt légitime à les rendre accessibles à l’ensemble des acteurs de l’industrie footballistique. Il convient donc de procéder à un examen précis pour chaque catégorie de données.
Nécessité de communiquer et de publier les données
Une fois les intérêts légitimes identifiés, il convient de vérifier s’il est nécessaire de divulguer les données personnelles à la FIFA et de les rendre accessibles aux acteurs de l’industrie footballistique.
Pour que les traitements soient conformes à l’art. 6 par. 1 let. f RGPD, la FIFA doit, pour chaque catégorie de données, démontrer à la juridiction de renvoi que quatre conditions sont remplies :
- Les traitements protègent réellement l’intérêt général invoqué et ne visent pas à atteindre des objectifs cachés ;
- Il y a un besoin objectif de poursuivre les objectifs invoqués ;
- Les traitements permettent d’atteindre les objectifs poursuivis ; et
- Il n’y a pas de mesures alternatives moins intrusives de la vie privée des personnes concernées.
Constatant que le Règlement FIFA impose aux agents de communiquer de nombreuses catégories de données et que ces données sont susceptibles d’être publiées sans distinction, l’avocat général invite à juste titre l’autorité de renvoi à vérifier s’il est possible de limiter les traitements à l’aune des critères susmentionnés. À titre d’exemple, il doit être possible pour la FIFA de vérifier la conformité à certaines obligations réglementaires sans que les données ne soient publiées.
Pondération des intérêts et attente des personnes concernées
À supposer que les traitements soient nécessaires pour réaliser les intérêts légitimes poursuivis, il convient de pondérer les intérêts du responsable du traitement, resp. des tiers avec les intérêts, libertés et droits de la personne concernée.
À cet égard, l’avocat général rappelle que les attentes raisonnables des personnes concernées doivent être prises en compte (cf. consid. 47 RGPD). En l’occurrence, les agents doivent s’attendre à ce que leurs données soient traitées pour assurer la conformité aux dispositions du Règlement FIFA, mais ne s’attendent pas nécessairement à ce que les données soient rendues accessibles aux clubs, aux joueurs et aux autres agents.
Comme le met en évidence l’avocat général, les informations sur la clientèle des agents et sur le contenu des contrats sont des informations délicates dans un marché si concurrentiel. Leur communication à tous les acteurs du marché pourrait modifier l’équilibre en place au profit des clubs et des joueurs et au détriment des agents. Pour ne pas violer le droit des personnes concernées à la vie privée (art. 7 CDFUE), à la protection de leurs données personnelles (art. 8 CDFUE) ainsi que leur liberté d’entreprise (art. 16 CDFUE), il sied donc de trouver un meilleur équilibre entre les intérêts de tous les acteurs.
Conclusion
Il résulte des conclusions de l’avocat général que tous les traitements en cause dans le cadre de la relation entre la FIFA et les agents ne peuvent pas se fonder sur l’art. 6 par. 1 let. f RGPD. S’agissant des données communiquées à la FIFA, une analyse précise de la situation juridique présuppose que l’on identifie toutes les catégories de données en cause et que l’on détermine l’intérêt poursuivi pour chacune d’elles. Quant à la divulgation de données aux autres acteurs du marché, elle devrait être limitée à un nombre restreint de catégories de données.
Proposition de citation : Nathan Philémon Matantu, Les services d’agents de footballeurs, un marché sous (hyper-)surveillance ?, 22 septembre 2025 in www.swissprivacy.law/373

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.