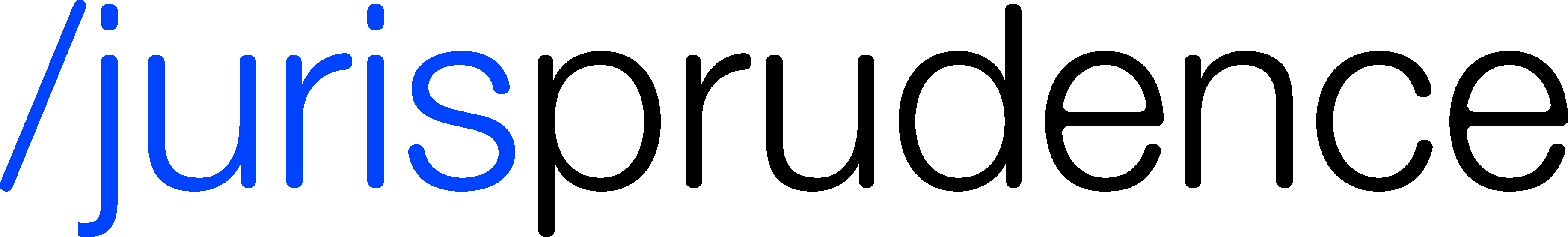Saisie de courriels sans autorisation préalable en procédure administrative

I. Les faits
Les affaires jointes C‑258/23, C‑259/23 et C‑260/23 trouvent leur origine dans des inspections menées par l’Autoridade da Concorrência (AdC), l’autorité portugaise de la concurrence, dans le cadre d’enquêtes portant sur de possibles ententes anticoncurrentielles, en violation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Ces inspections ont donné lieu à des perquisitions dans les locaux des entreprises concernées et à la saisie de données électroniques, notamment des courriels professionnels échangés entre employés. Les mesures ont été effectuées sans autorisation judiciaire préalable, comme le permet le droit portugais de la concurrence.
Les sociétés visées, Imagens Médicas Integradas SA, Synlabhealth II SA et SIBS – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA, ont contesté la légalité des opérations, invoquant une atteinte à leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier les art. 7 et 8, relatifs au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão portugais a donc saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles, portant notamment sur :
- la qualification des courriels professionnels comme « correspondance » protégée par l’art. 7 de la Charte ;
- la compatibilité avec les art. 7 et 8 d’une saisie réalisée sans autorisation judiciaire préalable ;
- la possibilité d’appliquer au domaine du droit de la concurrence le standard établi dans l’arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck où la Cour avait exigé une autorisation judiciaire avant l’accès par la police à des données contenues dans un téléphone portable.
Dans ses conclusions du 23 octobre 2025, l’Avocate générale Laila Medina propose à la Cour de répondre que les art. 7 et 8 de la Charte n’exigent pas systématiquement une autorisation judiciaire préalable pour les inspections des autorités de concurrence, dès lors que la mesure est prévue par la loi, proportionnée et assortie d’un contrôle juridictionnel ex post effectif.
II. Le droit
L’existence d’une ingérence dans les droits fondamentaux
L’Avocate générale commence par rappeler que les art. 7 et 8 de la Charte protègent la correspondance et les données à caractère personnel contre toute ingérence injustifiée. Les courriels échangés entre collaborateurs d’une entreprise, même dans un cadre strictement professionnel, constituent selon elle une « correspondance » protégée.
Cette approche découle de la jurisprudence WebMindLicenses et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment Copland c. Royaume-Uni, qui considèrent que le caractère professionnel d’une communication ne l’exclut pas de la protection de la vie privée, car cette dernière reste susceptible de contenir des informations relevant du domaine privé.
La saisie d’e‑mails constitue donc bien une ingérence dans les droits garantis par la Charte. Reste à déterminer si cette ingérence est justifiée et si elle doit être soumise à une autorisation judiciaire préalable pour être conforme au principe de proportionnalité.
La distinction entre procédure pénale et procédure administrative
Les procédures pénales, par leur finalité répressive, visent à établir la culpabilité d’une personne physique et peuvent déboucher sur des sanctions privatives de liberté. Elles justifient donc un niveau de garantie renforcé, incluant généralement l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour toute mesure d’investigation portant sur des communications privées ou des données sensibles.
Les procédures administratives de concurrence, en revanche, ont une nature différente : elles poursuivent un objectif de régulation économique et préventive, visant à garantir le bon fonctionnement du marché. Les entités concernées sont des personnes morales et les données collectées concernent des activités professionnelles, non des éléments relevant de la sphère intime.
Pour l’Avocate générale, cette différence de finalité et de sujet justifie que les garanties procédurales ne soient pas identiques. Appliquer mécaniquement le standard pénal à des enquêtes économiques reviendrait, selon elle, à paralyser l’efficacité des autorités de concurrence.
Ainsi, elle estime que l’absence d’autorisation judiciaire préalable dans le droit portugais ne viole pas en soi les art. 7 et 8 de la Charte, pour autant que la mesure soit clairement encadrée par la loi et que les personnes concernées disposent d’un recours effectif a posteriori.
L’arrêt Landeck : un précédent non transposable
L’Avocate générale consacre une partie importante de son raisonnement à expliquer pourquoi la solution retenue par la Cour dans l’arrêt Landeck ne peut être appliquée à la présente affaire.
Dans Landeck, la CJUE avait jugé qu’un contrôle judiciaire préalable était indispensable avant que les autorités pénales n’accèdent aux données d’un téléphone portable saisi dans le cadre d’une enquête criminelle.
La Cour avait fondé sa décision sur la gravité particulière de l’ingérence dans la vie privée, soulignant que les téléphones contiennent des informations extrêmement sensibles sur la personnalité, la vie familiale et les relations sociales de l’individu.
L’Avocate générale observe que la situation portugaise est radicalement différente.
Les inspections de concurrence :
- ne visent pas des personnes physiques, mais des entreprises ;
- ne concernent pas des éléments intimes, mais des documents d’activité économique ;
- et ne servent pas à établir une culpabilité, mais à prévenir et sanctionner des distorsions de concurrence.
Elle en conclut que l’arrêt Landeck reposait sur un raisonnement ancré dans le droit pénal, où la protection de la vie privée doit être maximale, tandis que les enquêtes administratives obéissent à une logique de proportionnalité ajustée à leur but.
Pour Medina, transposer sans nuance Landeck au droit de la concurrence reviendrait à confondre deux régimes juridiques distincts, fondés sur des finalités, des destinataires et des degrés d’intrusion incomparables. Les autorités de concurrence, rappelle-t-elle, ne disposent pas de pouvoirs de contrainte pénale : leurs inspections reposent sur la coopération des entreprises et sont soumises à un contrôle juridictionnel complet a posteriori.
Le rôle du contrôle juridictionnel ex post
L’Avocate générale admet que la saisie de documents électroniques nécessite un encadrement rigoureux pour éviter les abus, mais estime que cet encadrement peut se matérialiser par un contrôle juridictionnel ex post plutôt que ex ante.
Selon elle, ce qui compte est la possibilité effective de contester la légalité et la proportionnalité de la mesure devant un juge indépendant. L’entreprise doit pouvoir démontrer qu’une saisie a outrepassé les limites fixées par la loi et obtenir la restitution ou la suppression des données concernées.
Ce contrôle différé, s’il est complet et exercé dans un délai raisonnable, assure un équilibre suffisant entre le droit à la protection des données et la nécessité d’une action administrative efficace.
L’Avocate générale précise toutefois que la proportionnalité demeure une exigence permanente : plus la collecte est large et intrusive, plus la supervision du juge devra être rigoureuse.
Le principe de proportionnalité comme critère directeur
Enfin, l’Avocate générale rattache l’ensemble de son raisonnement au principe de proportionnalité, précisant que les limitations aux droits fondamentaux doivent être strictement nécessaires à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.
Dans le contexte des enquêtes de concurrence, cela signifie que :
- les autorités doivent cibler la collecte de données sur les éléments pertinents ;
- les informations purement personnelles doivent être exclues ou anonymisées ;
- et toute utilisation détournée des données doit être proscrite.
La proportionnalité devient ainsi le fil conducteur qui remplace l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable uniforme.
L’intensité de la protection varie en conséquence selon la nature de la procédure, la finalité de la collecte et le degré d’atteinte à la vie privée.
III. Conclusions
Les conclusions de l’Avocate générale Medina dans les affaires jointes C‑258/23, C‑259/23 et C‑260/23 s’inscrivent dans une approche pragmatique : trouver un équilibre entre efficacité des enquêtes de concurrence et protection des droits fondamentaux.
Elle reconnaît que la saisie d’e‑mails professionnels constitue bien une ingérence dans les art. 7 et 8 de la Charte, mais estime que cette protection doit s’adapter au type de procédure concernée.
Contrairement à l’arrêt Landeck, où la gravité de l’ingérence justifiait un contrôle judiciaire préalable obligatoire, les enquêtes de concurrence peuvent, selon elle, se contenter d’un contrôle ex post, pour autant que la mesure soit prévue par la loi, proportionnée et poursuive un objectif d’intérêt général.
Le droit suisse de la concurrence adopte une logique similaire. L’art. 42 al.2 de la LCart permet à la ComCo d’ordonner elle-même une perquisition et la saisie de courriels. Les personnes concernées peuvent cependant demander la mise sous scellés des pièces (art. 50 al. 3 DPA) ; c’est alors la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui décide si la perquisition est admissible. Ce mécanisme assure, là aussi, un contrôle judiciaire a posteriori, sans bloquer l’action de l’autorité au moment de l’enquête.
Cette comparaison montre que, dans l’Union comme en Suisse, le contrôle du juge reste essentiel, mais qu’il peut intervenir a posteriori, tant que la proportionnalité et les droits des personnes sont effectivement garantis.
En plaçant la proportionnalité au centre du dispositif, l’Avocate générale Medina rappelle que, dans ce domaine, le bon équilibre compte davantage que la formalité d’une autorisation préalable.
Proposition de citation : Samia Moura, Saisie de courriels sans autorisation préalable en procédure administrative, 18 novembre 2025 in www.swissprivacy.law/382

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.