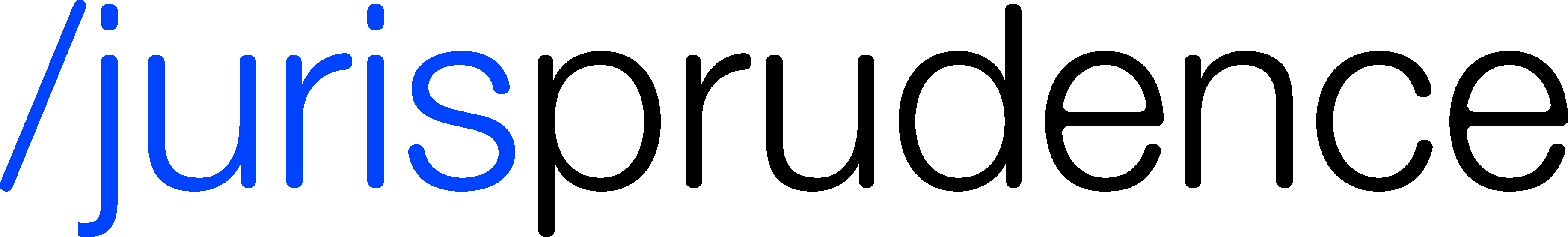Collecte et conservation des données restreintes dans le cadre de la prévention contre les abus de marché

Dans cette affaire, deux prévenus sont poursuivis en France pour délit d’initié et recel de délits d’initiés. Dans le cadre de l’enquête pénale, l’Autorité française des marchés financiers (AMF) communique notamment au juge d’instruction des données personnelles issues d’appels téléphoniques entre les prévenus. Ces métadonnées recueillies sur la base de l’art. L. 34–1 CPCE concernent l’identité du destinataire, les moyens utilisés pour effectuer la communication, la date, l’heure, l’endroit et la durée de celle-ci, ainsi que la localisation des équipements terminaux et la fréquence des communications. L’AMF a pu obtenir ces données auprès d’opérateurs de services de communications électroniques (opérateurs de télécommunications). À la lumière de ces nouveaux éléments, l’instruction est ensuite étendue, et les prévenus mis en examens pour les chefs de délits d’initié, et blanchiment pour l’un d’entre eux.
Étant donné que la mise en examen se fonde sur les données de trafic fournies par l’AMF au juge d’instruction, les prévenus déposent respectivement un recours en invoquant une violation de plusieurs dispositions de droit européen (not. art. 15 par. 1 Directive 2002/58 et diverses dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’UE) ainsi que de la jurisprudence européenne (cf. not. Aff. Tele2Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15 du 21 décembre 2016). En substance, les prévenus considèrent que les bases légales du droit national sur lesquelles se fonde l’AMF pour obtenir les données litigieuses (L. 621–10 CMF ; L. 34–1 CPCE ; R. 10–13 CPCE) ne sont pas conformes au droit européen.
Ces dispositions de droit national imposent une obligation aux opérateurs de télécommunications français de conserver temporairement (un an dès l’enregistrement), mais de manière généralisée et indifférenciée des données de connexion. Le but est de permettre à une autorité administrative (au sens des art. 11 Directive 2003/6 et art. 22 Règlement n°596/2014, l’AMF in casu) de pouvoir se faire remettre les enregistrements existants dans le cas où il existerait des soupçons que les personnes concernées par ces données seraient impliquées dans une opération d’initié ou de manipulation de marché. À relever que de tels enregistrements constituent souvent l’unique preuve pour démontrer la réalisation de telles infractions.
Les recours ayant été rejetés par la Cour d’appel de Paris, les prévenus forment un pourvoi auprès de la Cour de cassation qui décide de surseoir à statuer afin de déposer trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
La première question traite de la compatibilité des règles nationales litigieuses avec le droit communautaire. À titre liminaire, en s’appuyant sur les conclusions de l’avocat général, la CJUE indique que l’examen concernera principalement l’art. L. 621–10 CMF, mais que les art. L 34–1 et R. 10–13 CPCE restent des dispositions clés (par. 58 et 86).
Après une brève présentation des observations adressées par les parties ainsi que par divers pays intéressés, la CJUE relève que le libellé des dispositions européennes concernées (art. 12 par. 2 let. d Directive 2003/6 ; art. 23 par. 2 let. g et h Règlement n°596/2014) est clair. Ces dispositions accordent uniquement un droit d’accès aux données existantes et elles n’instaurent pas une obligation de conservation de tels enregistrements (par. 65‑70).
Toutefois, une interprétation strictement littérale d’une disposition ne doit pas non plus conduire à priver d’effet utile la disposition en cause. Dès lors, la CJUE poursuit son raisonnement en examinant le contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions susmentionnées. En l’occurrence, ledit contexte ne laisse pas non plus transparaître une éventuelle possibilité pour les États membres d’instituer à la charge des opérateurs de télécommunications une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic ni les conditions dans lesquelles ces données devraient être conservées pour être si besoin remises aux autorités compétentes. Elles établissent uniquement un droit d’accès des autorités d’investigation financière aux documents nécessaires pour l’exercice de leurs tâches de surveillance et d’enquête (par. 71‑75).
L’objectif de ces dispositions est d’accorder un accès aux communications existantes. Elles ne laissent pas la possibilité aux États membres d’imposer aux opérateurs de télécommunications une obligation générale de conservation des données. La CJUE conclut donc que ces dispositions communautaires n’accordent pas un mandat législatif pour les États membres de créer une telle obligation de conservation (y compris dans le but de lutter contre des infractions d’abus de marché) (par. 76–78).
La CJUE ajoute également que dans le but de préserver les droits fondamentaux (not. le droit à la vie privée), les États membres devraient prévoir des garanties appropriées contre d’éventuels abus, comme une autorisation préalable d’une autorité judiciaire (par. 79‑85).
La CJUE décide ensuite de vérifier si, pour autant, les dispositions litigieuses de droit français sont incompatibles avec le droit communautaire. Ces dispositions permettaient à l’AMF de recueillir les données de trafic auprès des opérateurs de télécommunications qui devaient conserver pendant une année des données utiles à des fins de recherche, de constatation et de poursuite d’infractions pénales (par. 86–88).
Cette réglementation couvre l’ensemble des moyens de communication et des utilisateurs sans exception. Or, bien qu’elles ne couvrent pas le contenu de ces communications, les données personnelles concernées sont particulièrement précises puisqu’elles permettent de retrouver la source et la destination d’une communication. Par conséquent, mises ensemble, ces données constituent une ingérence importante dans la vie privée puisqu’elles permettraient de reconstituer le quotidien des personnes concernées (lieux de séjour, habitudes de vie, déplacements journaliers, activités, relations sociales, etc.). Ces données sont cependant uniquement collectées et conservées dans le but de lutter contre des infractions pénales, notamment les infractions relatives aux abus de marché. Au vu de ces objectifs, la CJUE estime qu’une obligation de conservation pendant une durée d’un an ne serait pas proportionnée au regard des buts poursuivis et de la violation importante des droits fondamentaux qu’elle constitue (par. 89‑93). Dès lors, la réglementation nationale litigieuse excède le strict nécessaire et n’est pas justifiée. Les dispositions de droit français sont donc déclarées incompatibles avec le droit communautaire, plus spécifiquement l’art. L‑621–10 CMF par. 94‑95).
Ayant constaté qu’il n’existe ni mandat législatif ni compatibilité des dispositions françaises avec le droit européen, la CJUE se penche ensuite sur la seconde question préjudicielle, à savoir la possibilité de limiter dans le temps les effets de cette déclaration d’invalidité. La CJUE relève que le maintien d’une telle réglementation impose aux opérateurs de télécommunication, une obligation contraire au droit européen et qui, de plus, constitue une violation importante aux droits fondamentaux. Par conséquent, la CJUE estime que cette réglementation ne peut pas être maintenue, y compris provisoirement (par. 96‑103).
Enfin, dans un dernier point, la CJUE examine si l’incompatibilité de l’art. L‑621–10 CMF doit avoir une incidence sur la recevabilité des preuves retenues contre les prévenus dans le cadre de la procédure pénale nationale. Après avoir rappelé le principe d’autonomie procédurale des États membres et ses limites, la CJUE conclut que l’admissibilité des preuves relève du droit national. Toutefois, elle précise que le juge pénal national est tenu d’écarter les preuves obtenues dans la présente affaire en violation du droit européen, dans la mesure où les prévenus n’ont pas eu la possibilité de se prononcer sur ces preuves, alors même que ces dernières sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits et qu’elles échappent à la connaissance des juges (par. 104‑107).
Il ressort de cette affaire que le droit européen ne permet pas aux États membres d’adopter à titre préventif, aux fins de lutter contre les infractions d’abus de marché, une réglementation imposant aux opérateurs de télécommunications une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an dès l’enregistrement des données. Ainsi, le droit français n’est pas compatible avec le droit communautaire et les dispositions litigieuses ne peuvent, dès à présent, plus être appliquées. Ce constat d’incompatibilité implique que les preuves obtenues sur cette base dans les procédures pénales pendantes pour ce type d’infractions peuvent potentiellement ne pas être retenues. Il appartiendra aux juges nationaux de se prononcer sur leurs recevabilités.
À relever finalement qu’en Suisse, lorsqu’il est confronté à une question similaire, le Tribunal fédéral parvient à des conclusions diamétralement opposées à celles de la CJUE. Le Tribunal fédéral a, par plusieurs fois, estimé que la rétention systématique de données secondaires de tous les usagers pendant six mois n’était pas contraire à la Constitution fédérale, ni à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux motifs que l’intensité de l’ingérence aux droits fondamentaux des utilisateurs était proportionnée et que l’accès à ces données par les autorités pénales était soumis aux conditions du CPP, rappelant au passage qu’il n’était pas lié par la jurisprudence de la CJUE (cf. www.swissprivacy.law/135).
Proposition de citation : Enzo Bastian, Collecte et conservation des données restreintes dans le cadre de la prévention contre les abus de marché, 26 avril 2023 in www.swissprivacy.law/223

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.