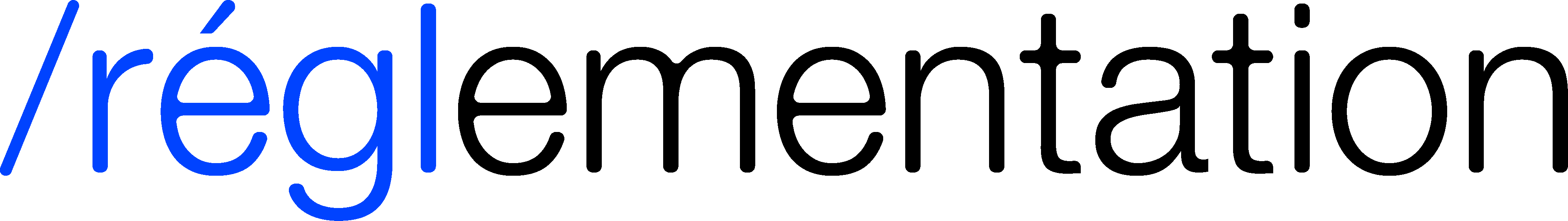La proposition de règlement EHDS : nouvel instrument de l’Union à fort potentiel

Introduction
La Commission européenne a publié sa proposition de règlement sur le nouvel espace européen des données de santé le 3 mai 2022 (ci-après « Proposition EHDS »), plus connu sous le nom de « European Health Data Space » (ci-après « EHDS »). Cette proposition législative attendue et annoncée fait suite à la consultation publique de 2021 au cours de laquelle 385 avis ont été recueillis en vue de proposer la conception d’un cadre juridique spécifique pour l’accès, l’utilisation et la réutilisation des données de santé électroniques. Ce texte s’inscrit dans la stratégie européenne pour les données qui vise notamment à mettre en place un marché unique des données et à favoriser leur circulation au sein de l’Union européenne.
Les motivations de ce texte sont multiples et visent à apporter des solutions concrètes aux différentes carences et lacunes révélées au cours des études réalisées dans le cadre de l’élaboration de la proposition EHDS. Celles-ci ont notamment mis en évidence l’effectivité limitée du droit des individus concernant l’accès à leurs données de santé électroniques, ainsi qu’une interopérabilité restreinte des systèmes d’information utilisés dans le domaine de la santé.
La proposition EHDS poursuit trois objectifs généraux :
- renforcer les droits des personnes physiques en ce qui concerne la disponibilité et le contrôle de leurs données de santé électroniques ;
- permettre l’utilisation primaire et secondaire de ces données de santé au sein de l’Union européenne par différents acteurs en mettant en œuvre une nouvelle infrastructure transfrontalière ; et
- établir des règles pour la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de systèmes de dossiers médicaux électroniques (ci-après « systèmes DME »).
Afin de garantir l’application d’un cadre uniforme et cohérent, la Commission européenne a opté pour une approche identique à celle du RGPD en adoptant un projet de règlement d’application directe. Cette stratégie doit en principe réduire les risques d’une mise en œuvre fragmentée au sein des États membres et favoriser la libre circulation des données de santé électroniques dans le secteur de la santé.
Le cadre juridique de la Proposition EHDS s’appuie à la fois sur un arsenal législatif intersectoriel (cf. le RGPD, le règlement (UE) 2019/881 sur la cybersécurité, le règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données), et monosectoriel propre à la santé (cf. la directive (UE) 2011/24 relative aux soins transfrontaliers, le règlement (UE) 2014/536 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, le règlement (UE) 2017/746 sur les dispositifs médicaux de diagnostics in vitro). Il s’appuie également sur les propositions législatives en cours de négociations telles que la proposition de règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) et la proposition de règlement sur les données (Data Act) (cf. art. 1 al. 4, 5 et 6 Proposition EHDS).
Champ d’application et définitions
Le premier chapitre (art. 1 à 2) explicite le champ d’application de la Proposition EHDS, énonce les différentes définitions utilisées et clarifie sa relation avec les autres instruments de l’Union européenne. S’agissant du champ d’application, trois options stratégiques impliquant des degrés variables d’intervention réglementaire et deux variantes supplémentaires ont été évaluées. La Commission européenne a retenu l’option 2 et 2+ qui correspond à une « intervention d’intensité moyenne ». Cette stratégie va au-delà de la simple coopération renforcée entre les États membres avec la mise en œuvre d’instruments volontaires (option 1, intervention de faible intensité). Il est intéressant de noter que la Proposition EHDS opère des renvois partiels ou complets aux différentes définitions utilisées dans d’autres instruments tels que le RGPD, ce qui devrait favoriser la cohérence et l’interopérabilité entre les différents textes. La définition de données de santé électroniques telle qu’elle ressort de la Proposition EHDS est particulièrement large puisqu’elle englobe à la fois les données de santé électroniques à caractère personnel et non personnel.
Utilisation primaire des données de santé électroniques
La Proposition EHDS rend obligatoire la participation à l’infrastructure commune transfrontalière MaSanté@UE pour l’utilisation primaire des données de santé électroniques (art. 12). Les États membres doivent désigner une autorité de santé numérique responsable de la mise en œuvre du chapitre II à l’échelon national. Ces autorités auraient notamment pour mission de contribuer au développement du format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques et à l’élaboration de spécifications communes traitant des questions d’interopérabilité (art. 10 par. 2 let. h). Elles seraient également chargées de contribuer à l’échelle nationale au développement de solutions techniques pour garantir la mise en œuvre des droits spécifiques conférés aux personnes physiques par la Proposition EHDS (art. 10 par. 2 let. e). À ce propos, chaque personne physique disposerait par exemple des droits suivants :
- accéder, immédiatement, gratuitement et dans un format facilement lisible, consolidé et accessible à ses données de santé électroniques à caractère personnel traitées dans le cadre de l’utilisation primaire (cf. art. 3 par. 1) ;
- recevoir, dans le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques, une copie électronique d’au moins ses données de santé électroniques relevant des catégories prioritaires (cf. art. 3 par. 2) ;
- ajouter des données de santé électroniques dans son propre dossier médical électronique ou dans celui des personnes physiques dont elle peut consulter les informations de santé (cf. art. 3 par. 6) ;
- accorder des accès à ses données de santé électroniques à un destinataire de son choix du secteur de la santé ou de la sécurité sociale (cf. art. 3 par. 8).
Comme le relèvent à juste titre le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données dans leur avis conjoint du 12 juillet 2022, les nouveaux droits introduits par la proposition EHDS nécessitent des clarifications supplémentaires afin d’assurer une cohérence avec les dispositions générales du RGPD relatives aux droits des personnes concernées. À titre d’exemple, les organismes responsables de l’accès aux données de santé électroniques traitées dans le cadre de l’utilisation secondaire seraient exemptés de fournir les informations nécessaires prévues par l’art. 14 RGPD (cf. art. 38 par. 2). La mise en œuvre du droit spécifique introduit par l’art. 3 par. 1 serait donc limitée uniquement aux données de santé électroniques traitées dans le cadre de l’utilisation primaire. Une telle limitation apparaîtrait toutefois peu compatible avec le droit d’accès prévu par le RGPD et la volonté de renforcer le contrôle des individus sur leurs données (cf. art. 1 par. 2 let. a).
Il reste à noter que le chapitre II prévoit que de nombreuses spécificités techniques devront être précisées par la Commission européenne aux moyens d’actes d’exécution. C’est notamment le cas des spécifications techniques relatives au format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques (art. 6) et des exigences relatives à la gestion de l’identification électronique des utilisateurs (art. 7 et 9).
Utilisation secondaire des données de santé électroniques
La réutilisation de données de santé est soumise à la fois aux dispositions du Chapitre IV et aux règles et mécanismes du RGPD.
La Proposition EHDS définit de manière particulièrement large les catégories de données qui peuvent être réutilisées (p. ex. les données issues des DME, d’essais cliniques ou celles générées par des dispositifs médicaux, cf. art. 33) ainsi que les finalités possibles de ces réutilisations (p. ex. le développement de produits de santé et l’IA pour de l’innovation, cf. art. 34). L’art. 35 établit en outre une liste de finalités pour lesquelles la réutilisation de données de santé électroniques est interdite, parmi lesquelles figurent les pratiques discriminatoires contre les personnes, la publicité commerciale ou d’assurance et le développement de produits dangereux.
Un système de gouvernance est également proposé (art. 36 ss), en vertu duquel les États membres désignent un ou plusieurs organisme(s) responsable(s) de l’accès aux données de santé pour leur réutilisation. Dans ce contexte, trois éléments sont particulièrement intéressants. Tout d’abord, la plupart des détenteurs seraient par principe soumis à une obligation de mettre les données à disposition pour une utilisation secondaire dans le cadre de l’EHDS, à l’exception notamment des microentreprises (art. 33). Ensuite, les données devront être remises, lorsque cela est possible, sous forme anonymisée et, à défaut, sous forme pseudonymisée, étant précisé que la clef de cryptage ne pourra être détenue que par l’organisme d’accès aux données de santé (consid. 49). Enfin, en vertu de la Proposition EHDS, les organismes responsables ont le statut de responsables conjoints du traitement de données de santé électroniques traitées conformément aux autorisations de traitement de données (art. 51). Les utilisateurs de données devront soumettre auprès de ceux-ci leurs demandes d’accès conformément aux exigences prévues par les art. 44 et 45 qui reprennent en partie celles du RGPD (principes de minimisation des données et de limitation de la finalité). L’organisme statuera sur les demandes et pourra notamment sanctionner les détenteurs de données qui retiendraient des données de santé électroniques des organismes responsables dans l’intention manifeste d’en entraver l’utilisation ou lorsqu’ils ne respecteraient pas les délais qui leur sont impartis pour communiquer leurs données (art. 43). Finalement, la notion d’altruisme des données et ses modalités sont établies dans ce chapitre également (art. 40).
En parallèle de la Proposition EHDS, le RGPD instaure déjà un cadre légal pour la réutilisation de données. L’art. 5 par. 1 let. b RGPD énonce le principe de limitation des finalités auquel l’art. 6 par. 4 RGPD permet de déroger en permettant la réutilisation des données à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées, à condition notamment que la nouvelle finalité soit compatible avec la finalité initiale. Les données concernant la santé sont par ailleurs soumises à l’art. 9 RGPD, qui interdit en principe leur traitement (par. 1), mais qui le permet exceptionnellement à certaines conditions (par. 2), notamment à des fins de recherche scientifique.
Ainsi, à la teneur du considérant 37 de la Proposition EHDS, celle-ci fournirait une nouvelle base juridique conformément à l’art. 9 par. 2 let. g, h, i et j RGPD pour l’utilisation secondaire des données de santé en établissant les garanties requises pour le traitement de données à des fins licites.
Le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données estiment à ce sujet que l’interaction de la Proposition EHDS avec l’ensemble déjà complexe de dispositions à la fois dans la législation de l’Union européenne et dans celle des États membres n’est pas suffisamment claire en l’état. Ils recommandent également de ne pas étendre le champ d’application des exceptions du RGPD concernant les droits des personnes concernées dans la Proposition EHDS car cela réduirait la possibilité pour celles-ci d’exercer un contrôle effectif sur leurs données à caractère personnel. L’avis conjoint souligne en outre que la description des droits qui figure dans la Proposition EHDS n’est pas cohérente avec celle du RGPD, ce qui risque de générer des incertitudes juridiques et de la confusion. Il relève également un manque de délimitation claire s’agissant des finalités autorisées énumérées à l’art. 34 par. 1 de la Proposition EHDS et en particulier celles figurant aux points (f) – développement de produits ou services contribuant notamment à la santé publique ou à la sécurité sociale – et (g) –formation, test et évaluation de systèmes d’IA – dont la formulation est trop large.
Systèmes de dossiers médicaux électroniques
Le chapitre III (art. 14 à 32) s’attèle à mettre en œuvre un système d’autocertification obligatoire pour les systèmes DME. Ces systèmes DME comprennent tout type d’appareil ou logiciel permettant le stockage et le partage de dossiers médicaux. Pour être mis à disposition sur le marché, ils devront être conformes aux exigences formulées à l’annexe II du projet de règlement EHDS ainsi qu’aux spécificités techniques précisées à l’art. 23. Les États membres seront chargés de désigner des autorités de surveillance du marché qui devront veiller au respect des exigences posées dans le chapitre 3 (art. 28). Il reste à noter que les applications de bien-être ne seront pas tenues de se conformer à ces exigences. Une labellisation volontaire de telles applications sera possible sous réserve qu’elles soient jugées interopérables avec les systèmes DME et conformes aux exigences du projet de règlement EHDS (art. 31).
Conclusion
Bien que le projet EHDS constitue l’une des priorités de l’agenda européen, le texte fait toujours l’objet de propositions d’amendement devant le Parlement et le Conseil européen. L’objectif est de parvenir à un compromis avant la fin de l’année 2023. Toutefois, la proposition de règlement élaborée par la Commission européenne suscite un certain nombre de critiques. Certaines préoccupations juridiques ont déjà été relevées dans l’avis conjoint du 12 juillet 2022, notamment en ce qui concerne les interactions avec d’autres instruments tels que le RGPD. Le texte présente également des contours assez flous en matière de garantie de sécurité. Bien que les bénéfices financiers estimés soient conséquents (environ 11 milliards d’économies sur dix ans), la mise en œuvre du projet EHDS nécessite des moyens humains et financiers conséquents alors que le contexte économique reste incertain avec des prévisions de récession au niveau de la zone euro. Malgré les incertitudes techniques, les préoccupations sur le plan juridique et celui de la cybersécurité, le nouveau cadre de gouvernance des données de santé présente un fort potentiel pour faire progresser les soins de santé. Son succès dépendra toutefois de la confiance que placeront les citoyens européens et citoyennes européennes dans cette nouvelle infrastructure transfrontalière.
Proposition de citation : Mathilde Heusghem / Clément Parisato, La proposition de règlement EHDS : nouvel instrument de l’Union à fort potentiel, 17 mai 2023 in www.swissprivacy.law/227

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.