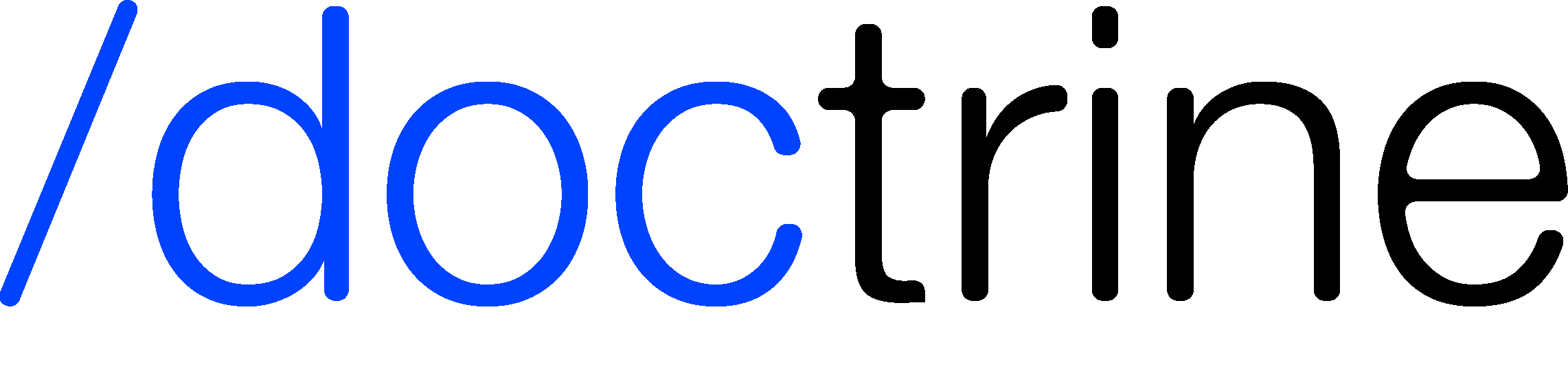L’impact des travaux de Daniel J. Solove sur l’appréhension de la privacy

Dans un article publié récemment dans The University of Chicago Law Review, intitulé « What is Privacy ? That’s the Wrong Question », Woodrow Hartzog, Professeur en droit et en informatique à l’Université de Northeastern (USA) revient sur la notion de privacy. Il se base en particulier sur les travaux réalisés par Daniel J. Solove.
L’objet de l’article de Hartzog est de montrer que les contours de la notion de privacy sont tout autant larges que flous. Arrêter une définition immuable serait inopportun. Dans la suite de la présente contribution, nous décidons volontairement de ne pas utiliser de traduction française de la privacy afin de rester fidèle aux termes propres de l’auteur. Utiliser les termes de vie privée ou de confidentialité serait bancal pour les propos de cette contribution.
Hartzog se souvient des diverses définitions de la privacy données par ses étudiants lors de ses premiers cours de protection des données. Il constate ainsi que chacun se fait sa propre idée de ce qu’englobe ce terme et que, bien que toutes ces visions ne soient pas fausses, ces dernières n’embrassent pas la notion dans son ensemble.
Il explique qu’en réalité, diverses définitions de la privacy ont été données depuis la fin du xixe siècle, celles-ci se rapportant à la liberté d’opinion, au contrôle de son corps ou à la maîtrise de ses données, au droit de vivre sa vie en paix, à l’absence de surveillance, à la protection de sa réputation ou encore aux garanties générales de procédure. Certaines définitions sont plutôt axées sur l’autonomie de la personne concernée, alors que d’autres le sont sur son intimité ou sa dignité.
L’auteur est également d’avis que le fait d’avoir une seule conceptualisation très large de la privacy n’est pas utile en droit. Le législateur adopterait dans ce cas des règles trop vagues, les entreprises pourraient se vanter de respecter la privacy telle que conceptualisée alors qu’elles occulteraient des problèmes non inclus dans cette vision. De manière générale, les discussions tenues à propos de la privacy pourraient ne déboucher sur aucun résultat simplement du fait que les personnes ne partagent pas la même notion de la privacy.
C’est à cet égard que Hartzog fait l’éloge des travaux de Solove, qui ont permis d’envisager la notion de privacy sous un angle nouveau. Grâce à ceux-ci, la question n’est plus de donner une définition immuable de ce que serait la privacy mais plutôt de s’intéresser à ce pourquoi elle peut être utile. Cette approche permet alors de la concevoir comme étant un hyperonyme. Ses travaux ont également tordu le cou à l’idée que la privacy n’existerait que dans le but de protéger les personnes qui ont des choses à cacher. Or, nos données ne sont pas utilisées qu’à des fins de surveillance massive, mais elles permettent également par exemple la conclusion et l’exécution d’un contrat, la création de sociétés, l’amélioration de produits, l’avancée de la recherche scientifique, ou encore la prise de décision individuelle automatisée (art. 21 nLPD).
Les travaux de Solove ont donné un cadre de discussion permettant à différents acteurs (politiques, commerciaux, etc.) d’apporter des solutions à diverses situations liées à la privacy. Ils ont aussi permis de mettre en lumière les problèmes spécifiques des populations minoritaires ou marginalisées. L’intérêt de ne pas se focaliser sur la question de la délimitation précise de la notion est de pouvoir bénéficier du temps ainsi économisé pour répondre aux réels enjeux, notamment par la création de règles qui encadrent certains comportements.
Dans un monde où le numérique est devenu la norme et où les grandes entreprises, actives dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, détiennent un grand pouvoir grâce aux données qu’elles traitent, des règles définissant clairement leurs droits et obligations doivent être adoptées. L’auteur déclare ainsi que le RGPD, la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et le California Consumer Privacy Act (CCPA) sont, ensemble, ce qui se rapproche le plus d’un langage commun de la notion de privacy.
Cependant, Hartzog souligne le fait que la plupart des règles actuelles de protection des données servent des intérêts individuels, ce qui restreint davantage la vision que l’on a de la privacy. Il argue qu’encore trop peu de règles de privacy s’intéressent à réduire les disparités entre les individus et les entreprises, à les protéger contre le harcèlement et la manipulation ou à viser au bien-être collectif de personnes appartenant à des catégories particulièrement vulnérables de la population face à l’utilisation de leurs données. En droit européen par exemple, une protection spécifique est accordée aux mineurs (art. 8 RGPD) et ce, contrairement à ce qui est en vigueur en droit suisse.
L’auteur relève encore que les outils existants actuellement comme le consentement des personnes concernées, le contrôle sur ses propres données et la transparence ne sont pas suffisants pour les protéger. En effet, de nombreuses difficultés existent à cause d’une vision encore trop individualiste de la privacy. Celle-ci peut par exemple se rapporter à la trop grande valeur attribuée à un consentement de piètre qualité, à des outils inutiles face aux problèmes existants ou encore au fait que nos données personnelles peuvent parfois également être mises en relation avec autrui, sans pouvoir déterminer à l’avance avec précision les conséquences potentielles sur celui-là.
Aujourd’hui, Solove ainsi que d’autres chercheurs ont proposé une vision de la privacy comme étant un ensemble regroupant différentes sous-catégories, telles que la confidentialité liée à ses idées et opinions, ou à son intimité sexuelle. Ils l’ont approchée de diverses manières, soit comme une notion se rapportant à la confiance, au pouvoir, à une forme de privilège ou à la sécurité, mais également comme un droit fondamental ou encore comme une garantie procédurale.
Cette vision large permet de mieux cerner les problèmes auxquels la société est confrontée, aussi divers et variés soient-ils, tels que la publicité comportementale, les interfaces manipulatrices pour l’utilisateur, la pornographie non consensuelle, la prise de décisions automatisées, l’exploitation de données d’une manière préjudiciable par les entreprises, ou encore la manière dont des populations précarisées sont davantage touchées par les problématiques liées à la privacy. En définitive, une meilleure solution peut leur être adressée, que ce soit en amont par le législateur, ou en aval par les tribunaux.
L’approche de l’auteur se veut pragmatique. Alors que de nouvelles questions liées à la privacy se posent chaque jour, il apparaît pertinent d’envisager la notion de manière multidisciplinaire. Une fois les domaines d’application identifiés, cela permet aux différents secteurs étatiques, de l’économie, ainsi qu’aux particuliers d’identifier les enjeux et de fournir les efforts nécessaires et réellement efficaces afin d’apporter les solutions nécessaires aux situations rencontrées.
En droit suisse, le domaine que l’on peut rapprocher le plus de la privacy est celui de la protection de la personnalité. Même s’il mérite un article dédié, nous pouvons indiquer que l’on est dans un ordre juridique qui différencie le cas où des données personnelles sont liées à une atteinte à la personnalité de celui où tel n’est pas le cas. Dans le premier cas, la LPD ainsi que les différentes lois cantonales de protection des données prévoient des règles détaillées. Dans le second cas, il faudra passer par les art. 28ss CC, dont le contenu a plus été développé par la jurisprudence que par le législateur, par exemple avec la théorie des trois sphères. Du côté du droit pénal, les infractions du Titre 3 du CP sont également en lien avec la protection de la personnalité. En somme, tout en gardant en tête que les ordres juridiques suisse et américain sont différents, la lecture de Solove par le juriste suisse lui est enrichissante et lui permet de mieux comprendre les développements de la privacy aux Etats-Unis.
Proposition de citation : Alexandre Barbey, L’impact des travaux de Daniel J. Solove sur l’appréhension de la privacy, 10 décembre 2021 in www.swissprivacy.law/108

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.