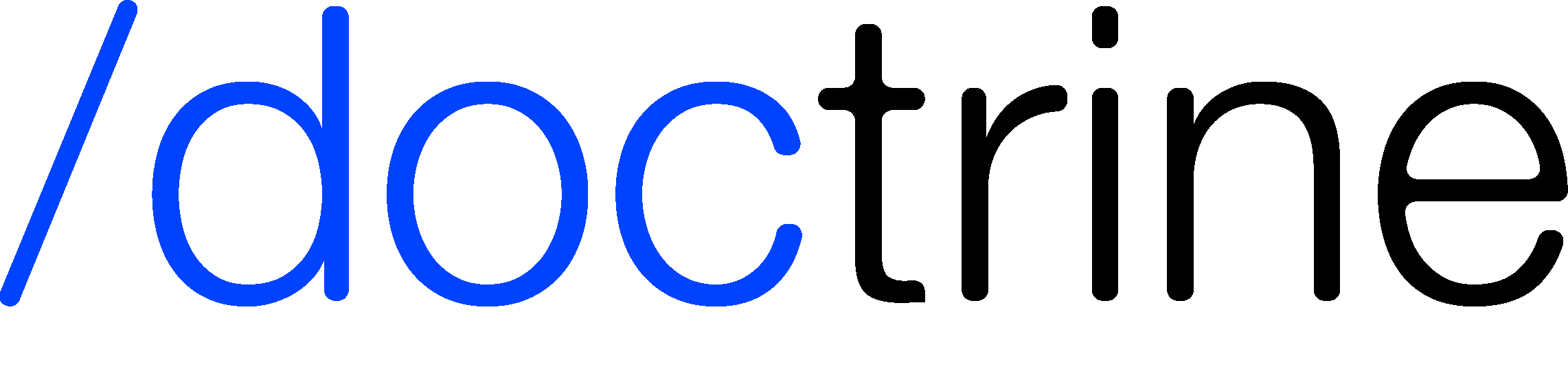Toute personne a le droit de savoir à qui ses données personnelles ont été communiquées : comment mettre en œuvre cette obligation ?

Nota bene : La présente contribution fait partie d’une série de trois contributions consacrées à l’arrêt C-154/21 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 janvier 2023 au sujet de la portée du droit d’accès (cf. www.swissprivacy.law/216 pour une analyse de l’arrêt au fond et www.swissprivacy.law/217 pour une analyse comparative à l’aune du droit suisse). Cette troisième contribution vise à présenter des pistes de réflexion en vue de la mise en œuvre concrète de cette obligation.
I. Introduction
Dans son arrêt du 12 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a tranché que le droit d’accès permet à la personne concernée de demander au responsable du traitement qu’il lui communique l’identité des destinataires auxquelles des données sont communiquées (et pas seulement les catégories de destinataires). La CJUE fonde son raisonnement sur l’art. 15 par. 1 let. c RGPD. Si l’arrêt de la CJUE n’est directement applicable qu’au responsable du traitement soumis au RGPD, soit en raison d’une application territoriale (art. 3 par. 1 RGPD) ou extraterritoriale (art. 3 par. 2 RGPD), notre seconde contribution consacrée à cette jurisprudence présente les motifs pour lesquels celle-ci présente également une pertinence pour les responsables du traitement suisses soumis à la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données future (nLPD) (cf. www.swissprivacy.law/217).
II. Comment mettre en œuvre cette nouvelle obligation à charge des responsables du traitement ?
A. Du registre des activités de traitement
Comme indiqué, la jurisprudence de la CJUE a pour effet de contraindre le responsable du traitement à prendre des mesures en vue ’de permettre de communiquer l’identité des destinataires dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la requête (art. 12 par. 3 RGPD / art. 25 al. 7 nLPD).
Or, les règles applicables au registre des activités de traitement – le principal outil permettant au responsable du traitement de disposer d’une vue exhaustive des traitements qu’il met en œuvre – se limitent à imposer le recensement des catégories de destinataires, et non pas les destinataires en tant que tels (art. 30 par. 1 let. d RGPD / art. 12 al. 2 let. d nLPD). L’on relèvera dans ce contexte ce qui suit :
- L’ 30 par. 1 let. d RGPD impose la mention, dans le registre, des destinataires situés en-dehors de l’Union européenne, mais tel n’est pas le cas de la disposition correspondante au niveau de la nLPD ; et
- Certains responsables du traitement sont exemptés de l’obligation de préparer un registre des activités de traitement (art, 30 par. 5 RGPD : moins de 250 employés, sauf si le traitement est susceptible de comporter un risque pour les droits et des libertés des personnes concernées (d’autres conditions s’appliquent) / 12 al. 5 LPD : moins de 250 collaborateurs et le traitement des données présente un risque limité d’atteinte à la personnalité des personnes concernées).
Dans une perspective concrète, nous sommes d’avis que la nouvelle obligation de transparence que la CJUE a déduit du texte du RGPD imposera (i) l’élaboration d’un registre (ou d’un document analogue pour les responsables du traitement qui ne sont pas formellement soumis à cette exigence) et (ii) un enrichissement des registres existants en vue de recenser de manière systématique l’identité des destinataires (en lieu et place des « catégories » de destinataires).
B. Du contrat de sous-traitance
Lorsqu’un responsable du traitement fait appel à un sous-traitant, le traitement en question doit en principe être régi par un contrat (art. 28 par. 3 RGPD / art. 9 al. 1 nLPD). Dès lors que le sous-traitant est compris dans la notion de destinataire, l’obligation d’établir un contrat de sous-traitance permet au responsable du traitement d’anticiper dans une certaine mesure son travail.
C. De la question de la confidentialité et des efforts disproportionnés
Le responsable du traitement devra veiller à structurer ses relations contractuelles avec les destinataires en tenant compte de cette obligation, ce qui pourrait notamment impliquer l’intégration d’une exception spécifique à la clause de confidentialité généralement prévue dans les accords passés avec ceux-ci.
L’on relèvera dans ce contexte que la CJUE a indiqué (par. 47) que « le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu », ce qui se traduit, s’agissant de la question qui nous occupe ici, par le constat que :
« le droit d’accès pourra être limité à l’information sur les catégories de destinataires s’il est impossible de communiquer l’identité des destinataires concrets, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas encore connus. » (par. 48).
L’illustration fournie par la CJUE pour expliciter le concept d’impossibilité (« [les destinataires] ne sont pas encore connus ») démontre le cadre restrictif que la Cour donne à cette exception. Nous sommes toutefois d’avis que d’autres motifs devraient également permettre de limiter la portée de l’obligation à charge du responsable du traitement.
Une obligation contractuelle de confidentialité conclue avant l’arrêt commenté ici ou une obligation légale de confidentialité devrait également entraîner une limitation de cette obligation. Il nous semble, à première vue, plus difficile de soutenir qu’un accord de confidentialité conclu postérieurement à la publication de cet arrêt permette de faire échec à une requête d’accès focalisée sur ce point. Il en découle que les responsables du traitement devraient, à notre sens, tenir compte de la jurisprudence commentée ici dans le cadre des futures négociations de contrats de sous-traitance.
Dans ce contexte, il convient également de garder à l’esprit que l’art. 12 par. 5 let. b RGPD, qui permet de rejeter les requêtes qui sont manifestement infondées ou excessives. Nous rappelons à cet égard que le considérant 62 prévoit notamment, à juste titre, que la communication de l’identité des destinataires ne peut pas être imposée au responsable du traitement lorsque celle-ci se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Tel serait le cas lorsqu’il s’agit d’un traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Dans tous les cas, le nombre de personnes concernées (ou dans ce cas précis, le nombre de destinataires), l’ancienneté de la communication ainsi que les garanties adoptées doivent être prises en compte.
III. Conclusion
L’arrêt de la CJUE constitue une nouvelle pierre dans le jardin du responsable du traitement et démontre l’importance de prévoir, au sein de chaque responsable du traitement, des procédures internes qui constituent le pendant des droits que les nouvelles règles de protection des données (et leur interprétation par la jurisprudence et les autorités de contrôle) accordent aux personnes concernées. Dans le cas d’espèce, l’obligation de transparence a un impact sur les destinataires, ce qui implique qu’elle doit être reflétée dans les contrats conclus avec ces derniers.
Aux responsables du traitement suisses d’en tenir également compte dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la nLPD qui sont en cours.
Proposition de citation : Philipp Fischer / Livio di Tria, Toute personne a le droit de savoir à qui ses données personnelles ont été communiquées : comment mettre en œuvre cette obligation ?, 11 avril 2023 in www.swissprivacy.law/218

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.