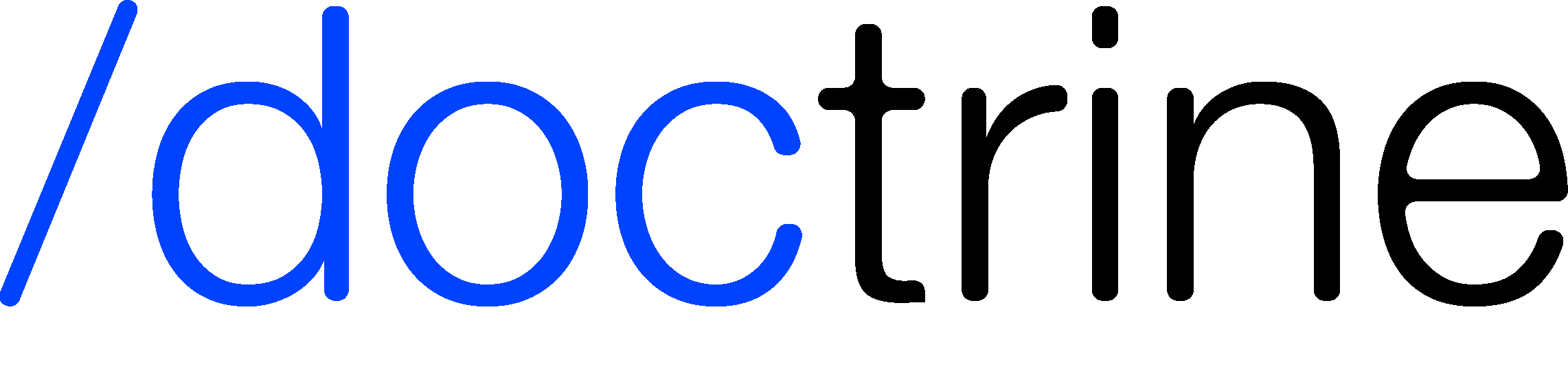Souveraineté numérique et Cloud souverain : l’approche concertée des cantons latins

I. Introduction
À l’heure où les organisations s’appuient de façon croissante sur les outils déployés dans un Cloud public et où les fournisseurs exhortent de plus en plus les administrations en ce sens, les cantons membres de la Conférence latine des directrices et des directeurs du numérique (CLDN) ont décidé d’entamer une réflexion commune sur la souveraineté numérique, en s’appuyant sur la technologie Cloud comme cas d’usage concret. La CLDN est la seule conférence intercantonale politique en Suisse qui est consacrée aux questions de politique numérique. Elle réunit les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais depuis sa création en 2019.
L’informatique s’est développée depuis des dizaines d’années sur des relations d’interdépendance. La position dominante de certains acteurs sur ce marché interroge de plus en plus, à l’image de plusieurs députés du Parlement vaudois qui ont déposé en juin 2020 un postulat demandant au Conseil d’État d’imaginer un plan ambitieux pour sortir de sa dépendance aux GAFAM.
Parallèlement, la question de l’intégrité numérique et de sa définition s’invite également dans le débat public, à l’instar du Canton de Genève où la population a accepté en juin 2023 à près de 94 % l’introduction d’un nouveau droit à l’intégrité numérique dans la constitution cantonale. Ce nouveau droit est décliné en un ensemble de sous-droits, comme le droit à la vie hors ligne par exemple, et fait mention de la souveraineté numérique suisse en faveur de laquelle le Canton de Genève s’engage sur la base de ce nouvel article constitutionnel. De la même manière et dans l’ensemble des cantons membres de la CLDN, ce thème est à l’ordre du jour de l’agenda politique. Il l’est également à l’échelon fédéral où le conseiller national Samuel Bendahan a déposé une initiative parlementaire « introduire dans la Constitution le droit à l’intégrité numérique » (22.479) (pour un avis critique, cf. www.swissprivacy.law/226). En novembre 2023, la Commission des institutions politiques du Conseil national a décidé de ne pas donner suite à cette initiative, par 13 voix contre 11.
Dans le même temps, les éditeurs informatiques, soucieux de déployer des outils modernes, innovants et économiquement plus profitables, ont redéfini depuis de nombreuses années leur stratégie commerciale. Ainsi, ils proposent désormais leurs outils majoritairement et par défaut dans le Cloud, en tant que services, et renoncent au déploiement « on-premise », à savoir sur les serveurs de leurs clients. Rappelons que, si le terme de « Cloud », ou d’informatique en nuage, évoque une image éthérée et dématérialisée, il cache bien une infrastructure physique. Cette évolution vers le Cloud a des répercussions sur de nombreux points. Dans le cas d’une administration publique par exemple, la logique budgétaire s’en trouve affectée puisqu’on passe d’un budget d’investissement à un budget de fonctionnement. Une logique de location – plutôt que d’acquisition – se met en place lors de la souscription à ce type d’infrastructures ou services distants. Par ailleurs, les questions juridiques liées à la protection des données et au secret de fonction sont également rendues plus prégnantes par cette évolution. Enfin, les enjeux liés à l’impact environnemental de ces infrastructures exigent une réflexion, tout comme l’évolution potentielle des coûts qu’entraîne ce nouveau modèle.
La technologie Cloud apparaît dès lors comme un cas d’usage intéressant lorsqu’il s’agit de traiter le thème de la souveraineté numérique. Au vu des différents aspects abordés ci-dessus, choisir cette technologie n’est pas anodin (cf. www.swissprivacy.law/48), puisque la technologie Cloud est à la croisée d’une kyrielle d’enjeux. La Confédération a pourtant renoncé au développement d’un Swiss Cloud sur la base d’un rapport sur l’évaluation des besoins d’un nuage informatique suisse publié en décembre 2020 qui conclut que « la nécessité d’un « Swiss Cloud » sous forme d’infrastructure de droit public et comme clé du succès de la place économique suisse n’est pas démontrée ». En revanche, elle a lancé un appel « Public Clouds Confédération » par le marché OMC-20007, attribué en 2021 à quatre entreprises américaines et une entreprise chinoise, pour un volume d’acquisition de CHF 110 millions au maximum. L’attribution de ce marché a mené à de vives réactions dans les médias et le monde politique. Quant à eux lors de leurs échanges au sein de la CLDN, les Cantons latins ont été convaincus de la nécessité d’aborder la technologie Cloud sous l’angle de la souveraineté. C’est ainsi que la Conférence a initié une démarche basée sur une collaboration entre Cantons pour appréhender cette thématique complexe qui s’est concrétisée par la réalisation de trois études complémentaires confiées à différents spécialistes, puis par des orientations politiques.
Dans cette contribution, nous présentons les principaux résultats de ces travaux, ainsi que les suites données à ceux-ci par les Cantons membres de la CLDN. Les travaux sont disponibles à cette adresse.
II. Cas d’usage : le Cloud souverain
Afin de donner corps à la notion de souveraineté numérique et de contribuer activement aux travaux dans une perspective nationale, la CLDN a choisi de traiter le cas de la technologie Cloud appliquée à l’État. Les administrations cantonales sont aujourd’hui de plus en plus confrontées à des choix délicats lorsqu’il s’agit de développer les systèmes d’information cantonaux. Les petits et grands éditeurs informatiques adaptent leurs stratégies en proposant leurs outils de façon externalisée, de plus en plus systématiquement : ces outils peuvent ainsi non seulement être mis à jour plus régulièrement, avec moins de contraintes pour les clients finaux, mais également bénéficier d’une puissance de calcul plus importante et permettre de bénéficier de l’émergence de nouvelles technologies, telle que l’intelligence artificielle dont la consommation en matière de puissance de calcul est nettement supérieure à un outil standard.
Parallèlement, s’agissant des développements réalisés à l’interne, il pourrait exister un intérêt non négligeable à les déployer dans le Cloud – idéalement souverain – pour diminuer les frais liés à l’exploitation de l’infrastructure technique ou encore développer de nouvelles façons de collaborer entre administrations cantonales en rendant les applications réutilisables et interopérables. Pour bénéficier de ces avantages, il s’agit toutefois de bien cadrer la démarche en explicitant les risques et en les mitigeant.
La CLDN a donc mandaté l’entreprise Eraneos (anciennement AWK) pour réaliser une étude d’opportunité sur le Cloud souverain. L’objectif des Cantons latins était, d’une part, de donner corps au concept de Cloud souverain et, d’autre part, d’évaluer la pertinence et la possibilité éventuelle qu’un tel projet puisse être réalisé dans le contexte suisse. Le résultat principal de cette étude réside dans deux constats.
Tout d’abord, il n’est pas possible de considérer le Cloud de façon monolithique. Il est essentiel de le concevoir de façon plus fine, en examinant l’ensemble de son cycle de vie : sa création avec la possibilité de maîtriser le développement, l’intégration et l’évolution d’un système ; son utilisation avec la possibilité par exemple de choisir la localisation des données ou encore d’accéder au système en tout temps ; son décommissionnement avec par exemple la possibilité de changer de système ou d’extraire des données sans désavantages majeurs ; et, finalement, les conditions-cadres, c’est-à-dire le cadre juridique applicable, la possibilité de s’appuyer sur un savoir-faire et une expertise disponibles au niveau local et la mise en place de contrats qui donnent la latitude de traiter tous ces points. La question de la souveraineté doit alors être posée à chacune des étapes de ce cycle de vie.
Le second constat de l’analyse est qu’en matière de Cloud, il n’est pas envisageable de trancher strictement entre un Cloud souverain et un Cloud non-souverain : il est dès lors indispensable de considérer différents niveaux de souveraineté. En d’autres mots, la souveraineté n’est pas binaire : on n’est pas souverain ou non-souverain et il s’agit plutôt de nuances de gris. Ainsi, une solution informatique déployée dans un Cloud devra répondre, sur l’ensemble de son cycle de vie, à des exigences de souveraineté plus ou moins élevée en regard des enjeux qui y sont associés (données traitées, enjeux métiers, etc.). Cette analyse préalable doit permettre de déterminer si un recours à la technologie Cloud est possible ou non et, dans l’affirmative, le type de Cloud approprié.
Sur la base de l’analyse qui prend en compte des éléments divers parmi lesquels la sensibilité des données, leur typologie, les bases légales en vigueur ou encore les considérations économiques, le choix des administrations publiques peut se porter vers des solutions déployées dans un Cloud. Dans leurs recommandations, les auteurs de l’étude invitent les cantons à élaborer des principes et des stratégies cantonales pour l’utilisation de services ou d’infrastructures Cloud tout en identifiant les cas d’usage pour leur utilisation. Ils conseillent également aux Cantons de créer un référentiel pour guider les démarches communes liées à la souveraineté dans le Cloud. Pour terminer, les auteurs insistent sur l’importance d’effectuer une classification détaillée des données.
Suivant ces recommandations et comme nous le verrons dans la conclusion, les Cantons membres de la CLDN ont entamé un travail en commun pour appréhender cette évolution technologique au sein de leur administration dans le respect de la souveraineté numérique.
III. Une définition de la souveraineté numérique
Le cas de la technologie Cloud, s’il est riche d’enseignements, n’est que l’un des cas concrets des enjeux de souveraineté liés au déploiement de technologies numériques dans nos sociétés. Afin d’appréhender ces enjeux dans leur globalité, la CLDN a également mandaté l’Université de Genève, et pour elle les Professeurs Yaniv Benhamou, Frédéric Bernard et Cédric Durand, pour élaborer une analyse pluridisciplinaire de la souveraineté numérique. Cette étude, fruit d’un travail sous les angles juridiques et socio-économiques, a permis d’établir une définition de la souveraineté numérique, adoptée depuis par les Cantons membres de la CLDN :
« la capacité des autorités à maintenir leur autonomie stratégique, soit à pouvoir utiliser et contrôler de manière autonome les biens matériels et immatériels et les services numériques qui impactent l’économie, la société et la démocratie ».
Cette définition, large, pose bien le concept dans une perspective sociétale et de souveraineté au sens d’autonomie stratégique et de contrôle d’un État sur un territoire, et pas uniquement concentrée sur la localisation des données de l’administration. De plus, la souveraineté numérique est analysée sous l’angle de deux de ses composantes particulièrement étudiées, dont principalement la souveraineté de la technologie (matérielle et logicielle) et la souveraineté des données.
Les auteurs relèvent que la notion même de territoire est redéfinie à l’ère numérique, la question de la souveraineté sur les réseaux se posant sur trois strates : physique, logique et données. La strate physique comprend notamment les machines, physiques, installés sur un territoire spatial, par exemple un centre de données installé sur le territoire d’un Canton latin. La strate logique comprend le code et les normes qui permettent l’échange d’informations entre composants technologiques. La strate des données enfin, celles qui circulent sur les réseaux. Si la souveraineté d’un État peut s’exercer pleinement sur la strate physique, elle est plus diluée sur les deuxième et troisième strates, car elles n’ont pas de limites spatiales.
Au terme d’une analyse des dépendances de la Suisse sur ces trois strates, il est à relever la concentration de l’activité numérique grand public sous le contrôle de quelques sociétés (notamment les GAFAM), ainsi qu’une concentration de la propriété intellectuelle. L’étude relève le dilemme entre autonomie et sophistication. En d’autres mots, il y a une tension pour les autorités entre être pionniers dans les usages numériques et l’autonomie dans l’action publique et l’usage des données. Un État qui adopte les dernières technologies risque la dépendance ; au contraire, l’autonomie peut venir aux dépens de l’usage des dernières technologies. Dans le traitement des données, ce dilemme est à traiter selon le degré de criticité des usages du numérique. De plus, si la souveraineté a une dimension évidemment spatiale, elle est aussi temporelle. Enfin, l’étude relève que dans le cadre constitutionnel suisse fondé sur la subsidiarité, la transition numérique est une compétence cantonale.
Dans leurs recommandations, les chercheurs préconisent notamment le renforcement des collaborations internationales, une action diplomatique engagée en faveur de la souveraineté numérique, la promotion du développement des technologies, des compétences et des industries en Suisse, ainsi que le renforcement de l’autonomie de l’action publique par des choix technologiques et contractuels qui mitigent les dépendances.
IV. Le regard éthique
Si ces premières études technique, juridique et socio-économique posent une base solide pour mieux appréhender la question de la souveraineté numérique et le développement de la technologie Cloud dans les administrations, il est apparu indispensable aux membres de la CLDN d’étendre encore la réflexion en posant un regard éthique sur cette question : que doit faire un Canton juste que l’on pourrait qualifier de « bon », au sens éthique du terme et, dans ce cas précis, un Canton souverain ? À quelles exigences doit-il se conformer lorsqu’il utilise cette technologie aux enjeux multiples ?
La CLDN a mandaté le bureau ethix – Laboratoire d’éthique de l’innovation, pour faire une lecture critique et une analyse éthique des deux premières études. L’analyse permet de déterminer quelles doivent être les actions attendues de la part d’un Canton souverain avant de pouvoir choisir une solution basée sur la technologie Cloud, que ce soit au niveau des infrastructures (IaaS) ou des services numériques (SaaS). S’agissant par exemple de l’infrastructure, un Canton souverain doit être en mesure de garantir que l’intégrité des données est protégée et que ces données restent accessibles. Dans le cas de services numériques, il doit garantir que les services sont adaptés à ses besoins ou encore que les risques de surveillance pour les collaboratrices et collaborateurs de l’administration sont réduits grâce à un paramétrage adéquat.
Sur cette base, l’étude ouvre également la voie à de nombreux champs d’action puisqu’il est nécessaire de définir clairement les limites de ces différentes actions. Dans le cas de l’intégrité des données par exemple, un canton souverain doit être capable de documenter de façon fiable les niveaux d’autorisation souhaitables associés aux différentes typologies de données, tout comme il doit définir la qualité du cryptage exigible pour chaque type de données.
V. Des principes communs
S’appuyant sur les résultats des trois études mandatées par la CLDN, les Cantons membres ont entamé un travail commun pour faire émerger des principes partagés qui doivent guider le développement et l’utilisation des technologies Cloud au sein de leurs administrations. Ce travail s’inscrit dans les objectifs fondateurs de la Conférence, à savoir élaborer et défendre une vision politique commune portant sur la prise en compte du numérique dans les Cantons membres, valoriser les relations et les partenariats avec l’extérieur, en particulier avec les acteurs moteurs des écosystèmes cantonaux, mutualiser les réflexions et les solutions, et légitimer des pratiques nouvelles dans les administrations.
Les principes retenus, puis adoptés durant le 1er trimestre 2023 par chaque Canton membre permettent d’appréhender la problématique dans toute sa complexité. Il s’agit ainsi pour les cantons de « saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies » tout en « réduisant les risques par des partenariats, par une collaboration avec les acteurs locaux et par la diversification des solutions », mais également en « impulsant l’évolution des conditions-cadres » qui doivent permettre une évolution technologique harmonieuse et cohérente. Dans la même ligne, les Cantons visent à « assurer leur autonomie stratégique grâce à des standards communs ». De plus, au sortir de différentes crises qui ont émaillé les années 2020–2022 (pandémie, guerre et pénurie énergétique), les Cantons tiennent à « distinguer le fonctionnement standard de celui du contexte de crise ». Dans le même temps, ils réfléchissent à la gouvernance à mettre en place sur ces questions en travaillant à « garantir les capacités de pilotage au sein des administrations ». Conscients des enjeux humains qui accompagnent toute évolution technologique, ils s’engagent à « encourager la formation dans le domaine du Cloud ». Finalement, et conformément aux objectifs de la Conférence, les Cantons « s’engagent en faveur de la transparence entre cantons, acteurs publics et vis-à-vis de l’extérieur pour préserver et renforcer la confiance numérique ».
L’adoption de ces principes communs permet aux Cantons, d’une part, de travailler sur leurs stratégies Cloud respectives tout en construisant un socle commun et, d’autre part, de parler d’une même voix auprès de leurs partenaires. Ainsi, la CLDN a exprimé au Département fédéral des finances le souhait des Cantons latins de participer activement au développement et à la mise en œuvre d’un Cloud souverain qui répond aux exigences en matière de souveraineté identifiées par les trois études. Cette intention fait suite à l’observation de potentielles collaborations concrètes sur le projet Swiss Government Cloud, projet en cours d’élaboration visant à fournir des solutions Cloud à l’administration publique fédérale, voire du secteur public suisse, et distinct du Swiss Cloud mentionné précédemment, ainsi que du Public Cloud Confédération. Avec une approche reposant sur trois piliers, la question de l’autonomie y est centrale, permettant une convergence avec l’approche des cantons latins.
VI. Conclusion
Au cœur d’une société que la transformation numérique remodèle profondément, la question de la souveraineté numérique est d’une acuité particulière pour les administrations cantonales. Cette notion fait écho à la situation de dépendance technologique que vit l’Europe de façon générale, comme le soulignent les études mandatées par la CLDN, mais résonne également particulièrement dans le contexte suisse de responsabilités partagées lié au fédéralisme. Si ce fédéralisme est parfois vu comme un frein à la numérisation, il est surtout une chance pour mener des expérimentations à petite échelle. C’est le parti pris de la CLDN qui, par les objectifs qu’elle s’est donnés, permet d’avancer efficacement et pragmatiquement sur des thématiques complexes.
Ce travail en commun a permis de renforcer la position de la Conférence comme partenaire crédible du projet de remplacement du Cloud de la Confédération. Une telle collaboration représenterait une opportunité concrète de renforcer les synergies aux niveaux intercantonal et fédéral sur des enjeux centraux de la transformation numérique en Suisse, qui doit se construire sur une réflexion large et à une intention politique claire.
Les enjeux liés à la souveraineté numérique nécessitent un engagement politique fort, qu’il s’agisse des choix technologiques Cloud, des enjeux du respect du droit ou encore de la formation et des développements technologiques.
Proposition de citation : Catherine Pugin / Alexander Barclay, Souveraineté numérique et Cloud souverain : l’approche concertée des cantons latins, 11 décembre 2023 in www.swissprivacy.law/272

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.