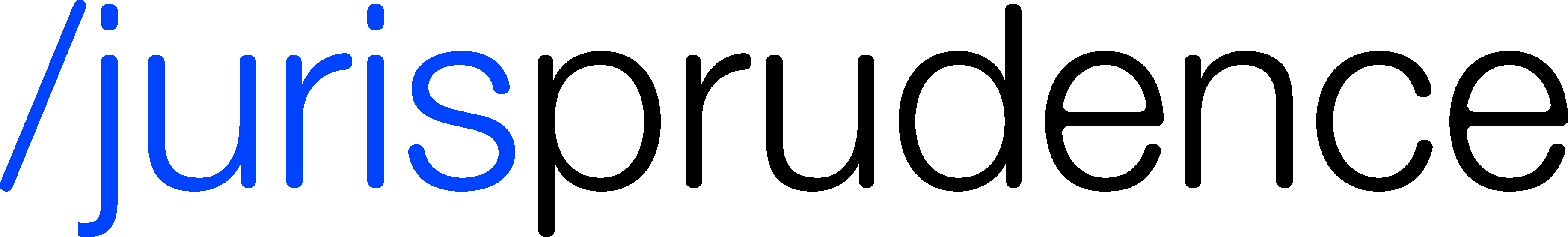La jurisprudence GoPro : de la nature (il)licite d’un traitement de données à l’(in)exploitabilité de la preuve qui en découle en procédure pénale

Au volant d’un véhicule le matin du 18 mai 2018, un automobiliste descendant l’Avenue Denantou à Lausanne klaxonne sans raison un tiers roulant à 35 km/h sur une trottinette électrique et le dépasse dans une longue courbe à gauche. Alors que le trottinettiste se trouve à l’arrière du flanc droit du véhicule, l’automobiliste se rabat subitement à droite et décélère, conduisant le tiers à freiner énergiquement pour éviter toute collision. La scène est filmée par une caméra GoPro fixée sur le guidon de la trottinette et les images sont produites au dossier de la procédure pénale dirigée contre l’automobiliste.
Sur la base de cet enregistrement en particulier, l’automobiliste est reconnu coupable en première instance de violations simple et grave des règles de la circulation routière par négligence (art. 90, al. 1 et 2, LCR) et la Cour d’appel pénale vaudoise confirme cette condamnation. Pas encore soulevé jusque-là, le moyen de l’inexploitabilité des images recueillies par l’intermédiaire de la GoPro, en raison d’un traitement illicite des données personnelles, doit être examiné par le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral commence par définir le cadre juridique applicable à l’espèce par une longue majeure, en se référant d’emblée à l’art. 141 du Code de procédure pénale qui est la disposition topique déterminant le sort des moyens de preuve obtenus illégalement, dont l’al. 2 prévoit :
Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
Cette norme ne réglemente pas l’exploitation des preuves illicites recueillies par des particuliers. Celles-ci sont exploitables dans une procédure pénale aux deux conditions cumulatives suivantes : d’une part, elles auraient pu être obtenues licitement par les autorités ; d’autre part, après une pesée des intérêts, le moyen de preuve apparaît comme indispensable à l’élucidation d’infractions graves. Cette double condition ressortit à la jurisprudence, dans la mesure où l’art. 141 al. 2 CPP ne s’applique que par analogie, et non pas directement, à ce cas de figure non réglementé par la loi (TF, 6B_1311/2017, c. 2.3).
S’agissant en particulier de l’illicéité d’un moyen de preuve, elle peut notamment tirer son origine de la violation de la Loi sur la protection des données (LPD) ou du Code civil (CC), étant précisé que la première complète et concrétise la protection de la personnalité figurant dans le second (art. 28 CC). C’est dans ce contexte que la protection des données joue un rôle, car ses principes généraux doivent être respectés. En effet, tout traitement de données doit, notamment, être « effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité », mais aussi être « reconnaissable pour la personne concernée » (art. 4, al. 2 et 4, LPD). La violation de ces principes constitue a priori une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées en vertu de l’art. 12 LPD. Néanmoins, l’illicéité peut in fine être ôtée et le traitement devenir licite lorsqu’il repose sur un motif justificatif de l’art. 13 al. 1 LPD, à savoir le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou encore la loi.
Ces principes posés, le Tribunal fédéral revient sur l’arrêt dashcam (TF, 6B_1188/2018) à l’état de fait similaire au cas présent. Il y a retenu que l’enregistrement en continu d’une dashcam fixée sur un véhicule automobile constitue une violation du principe de reconnaissabilité (art. 4 al. 4 LPD) qui, par voie de conséquence, doit être qualifiée de traitement illicite (art. 12 LPD). En particulier, il s’est refusé à examiner la présence ou non d’un motif justificatif de l’art. 13 LPD qui aurait pu rendre le traitement licite. Par ce biais, il a retenu une illicéité de façon irréfragable, en consacrant une notion « autonome de l’illicéité en procédure » qui évince le raisonnement en deux temps impérativement exigé lors de l’examen de tout traitement de données.
Soulignant que cet arrêt a été soutenu par une partie de la doctrine, mais aussi critiqué par une importante partie de celle-ci, le Tribunal fédéral justifie son approche restrictive en matière de motifs justificatifs par le fait que les images d’une caméra de bord fixée sur un véhicule « se font en continu et sans discrimination », si bien qu’elles s’apparentent « à un système de surveillance de l’espace public qui relève de la compétence de l’État pour assurer la sécurité du trafic ». Il cite en outre les explications relatives aux caméras de bord (dashcams) du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) pour qui :
Les enregistrements effectués avec une caméra de bord ne devraient être utilisés ni comme divertissement, ni comme moyen de preuve en cas de délits mineurs, comme des manœuvres routières risquées, mais banales. L’atteinte au principe de transparence est alors trop manifeste pour justifier le recours aux données enregistrées. Il faut éviter de jouer à l’apprenti shérif.
Ainsi, une exclusion des motifs justificatifs est nécessaire pour empêcher « toute forme de contrôle, par des privés, du respect des règles de la circulation routière, tâche qui appartient à l’État » et relève de son monopole, selon le Tribunal fédéral.
En dépit de cette justification laissant entendre une confirmation de sa jurisprudence antérieure dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral poursuit en indiquant s’en être d’ores et déjà distancé, après avoir admis qu’un motif justificatif puisse venir lever l’illicéité d’une atteinte s’agissant d’enregistrements vidéo effectués par des particuliers au moyen d’un téléphone portable (TF 6B_1404/2019), d’une caméra de surveillance d’un hôtel (TF 6B_1468/2019) ou d’une bodycam (TF 6B_810/2020).
Le Tribunal fédéral opère implicitement un revirement de jurisprudence par rapport à son arrêt 6B_1188/2018 précité, afin d’écarter la notion autonome d’illicéité de la preuve. En lieu et place, il retient qu’une notion uniforme en procédure, exigeant l’examen de motif justificatif au sens de l’art. 13 LPD, s’impose désormais. En présence d’un moyen de preuve recueilli par un particulier de façon contraire aux principes de la LPD, il y a lieu dès lors lieu de procéder en deux étapes : tout d’abord, examiner la présence d’un motif justificatif, auquel cas le moyen de preuve est exploitable « sans restriction » ; à défaut d’un tel motif, dans un second temps, examiner les deux conditions jurisprudentielles d’exploitabilité des preuves illicites recueillies par des particuliers.
Fort de ces développements, le Tribunal fédéral applique les principes dégagés au cas d’espèce. Implicitement, il reconnaît que les prises de vue de la GoPro, dont la plaque d’immatriculation du prévenu, ont trait à une donnée personnelle (art. 3 let. a LPD) et qu’il s’agit d’un traitement de données (art. 3 let. e). En outre, il constate que la GoPro du trottinettiste, à l’instar d’une dashcam, « enregistrait en continu ce qui entrait dans son champ de vision, sans discrimination », si bien que l’enregistrement était contraire au principe de reconnaissabilité (art. 4 al. 4).
Partant, le Tribunal fédéral considère que l’enregistrement constitue une atteinte à la personnalité du prévenu. En revanche, il s’abstient à ce stade d’opérer un jugement définitif quant à la licéité de l’atteinte en poursuivant l’examen à la recherche d’éventuels motifs justificatifs, conformément à sa nouvelle approche telle qu’exposée ci-dessus.
Ayant préalablement indiqué qu’un pur intérêt de « justicier » d’un conducteur muni d’une GoPro ou d’une dashcam doit être écarté, notre Haute Cour exclut, sans procéder à une véritable analyse, tout motif justificatif de l’art. 13 LPD en raison « des particularités de l’enregistrement, de la nature des infractions reprochées […] et du fait que le dépassement en cause n’a pas occasionné d’accident ou de lésion ». Les prises de vue obtenues au moyen de la GoPro proviennent dès lors d’un traitement illicite de données qui n’est pas justifié en l’espèce, raison pour laquelle la preuve ainsi recueillie doit être qualifiée d’illicite.
Ce constat amène le Tribunal fédéral à examiner l’exploitabilité des images en fonction des conditions qu’il a lui-même établies, notamment répondre à la question de savoir si, dans la pesée des intérêts, la gravité in concreto des faits plaide ou non pour l’exploitabilité. En l’occurrence, les infractions en cause (art. 90, al. 1 et 2, LCR) ne sont pas « graves » de manière abstraite et le comportement du prévenu, aussi bien au regard du bien juridiquement protégé que de l’intensité de la mise en danger en l’espèce, n’a pas atteint le niveau de gravité requis pour justifier l’exploitation des prises de vue de la GoPro. L’examen de la condition de la récolte hypothétique par les autorités est donc superflu. Par conséquent, les prises de vue de la GoPro sont déclarées inexploitables dans la présente procédure.
L’instance inférieure ayant fondé sa condamnation sur la base d’un moyen de preuve inexploitable, il s’ensuit que le jugement cantonal doit être annulé et que les prises de vue en cause doivent être retranchées du dossier pénal.
Destiné à la publication, cet arrêt du Tribunal fédéral doit être salué, en tant qu’il revient sur la jurisprudence Dashcam qui nous semble difficilement justifiable d’un point de vue dogmatique. Certes, sa conclusion était la bienvenue, puisqu’elle constituait une réponse de principe s’opposant aux « citoyens justiciers » et aux abus inhérents aux surveillances privées. En revanche, le cheminement intellectuel pour parvenir à cette solution était peu convaincant, car il avait pour effet une différence de qualification relative aux traitements de données : sous l’angle de la LPD, un traitement pouvait être licite, car justifié selon l’art. 13 LPD, alors qu’il pouvait être qualifié d’illicite sous l’empire du Code de procédure pénale. La notion autonome impliquait un examen partiel d’une loi, en l’occurrence la LPD, omettant ses mécanismes propres, faits de présomptions et de motifs justificatifs. Elle était de toute évidence peu satisfaisante et c’est pourquoi l’approche uniforme de la notion de licéité est plébiscitée par une large partie de la doctrine et doit être approuvée.
Aussi bien dans l’affaire GoPro que dashcam, c’est en particulier l’enregistrement en continu qui nous paraît être problématique. En revanche, lorsqu’un enregistrement intervient après le début des faits pénalement répréhensibles à dénoncer (à l’instar d’un quidam témoin de violences policières qui sortirait son téléphone pour filmer la scène), il en va alors tout à fait autrement. Il ne s’agit pas, en effet, d’autoriser les privés à procéder à une surveillance généralisée de l’espace public, mais à faire triompher l’intérêt public à l’établissement de la vérité, de façon réactive et non proactive. Dans ses explications, le PFPDT avait d’ores et déjà mis en avant le fait que seuls des enregistrements réactifs, « en cas d’incident » par exemple, permettent d’éviter des dérives.
Pour terminer, relevons que le refus par le Tribunal fédéral de qualifier les faits en cause comme relevant d’une « infraction grave » ne prête pas le flanc à la critique. Certes, l’automobiliste « a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui », selon les autorités cantonales. Néanmoins, son comportement n’a causé aucune lésion et n’était pas intentionnel, même pas par dol éventuel, mais relevait d’une négligence, quoique « grossière ». Qui plus est, la quotité de la peine, 30 jours-amende, témoigne d’une culpabilité relativement faible, en plus du fait que le fondement de la condamnation, une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), est un délit et non pas un crime (art. 10, al. 2 et 3, du Code pénal). En définitive selon nous, les faits en cause ne résistaient pas à juste titre à la sanction de l’inexploitabilité des images de la GoPro, l’exploitabilité d’une preuve illicite devant demeurer un régime d’exception pour des faits d’une gravité certaine.
Proposition de citation : Kastriot Lubishtani, La jurisprudence GoPro : de la nature (il)licite d’un traitement de données à l’(in)exploitabilité de la preuve qui en découle en procédure pénale, 9 décembre 2020 in www.swissprivacy.law/41

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.