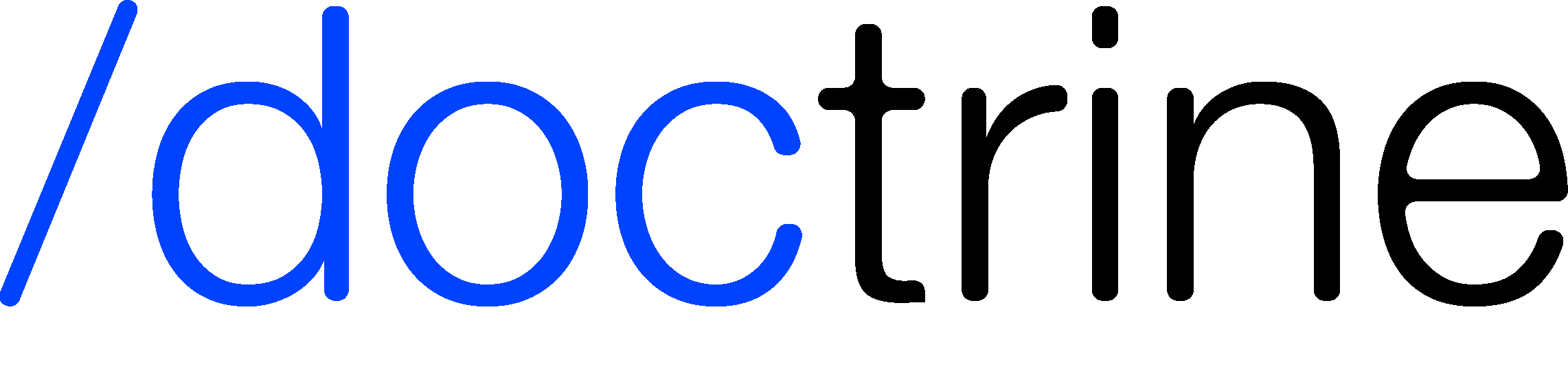Collectes de données personnelles par des étudiants dans le cadre de travaux académiques : qui est responsable du traitement ?

Les universités cantonales jouent un rôle essentiel pour la recherche scientifique en Suisse. Les personnes qui mènent une recherche, qu’elles aient le statut d’employé, d’étudiant ou de doctorant, traitent fréquemment des données personnelles et sensibles. Il est donc essentiel pour les universités de déterminer le régime applicable à ces données et, plus spécialement qui en est le responsable de traitement.
Le régime général de la protection des données (loi fédérale sur la protection des données (LPD), lois cantonales de protection des données, voire le droit européen) prévoit des définitions plus ou moins similaires quant aux rôles qu’il convient d’attribuer aux acteurs qui interviennent lors d’un traitement de données personnelles. Dans les grandes lignes, le responsable du traitement est défini comme : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Le sous-traitant sera quant à lui « la personne physique ou morale, l’autorité publique ou tout autre organisme qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement ». Le rôle de responsable de traitement se trouve donc dans une position centrale, car il assume en première ligne les obligations prévues par la législation applicable.
Quant au droit applicable, on rappellera que les traitements de données effectués par des organes publics cantonaux, tels que le sont généralement les universités, sont soumis aux législations cantonales sur la protection des données, alors que les traitements effectués par des personnes privées et les organes publics fédéraux sont régis par la loi fédérale sur la protection des données (LPD).
Dans le cadre d’une recherche scientifique effectuée par des employés d’une université, comme le sont habituellement les membres du corps enseignant, on admet que c’est en principe l’université qui endosse le rôle de responsable de traitement des données. Même si ce sont les employés qui définissent concrètement les moyens et les finalités d’un traitement de données effectué dans le cadre d’une recherche, ceux-ci agissent pour leur employeur (l’université, la personne morale), dans le cadre de leur cahier des charges, et non pas à titre purement privé (Jotterand Alexandre/Erard Frédéric, Recherche sur l’être humain et données personnelles, Gestion des échanges et répartition des responsabilités, jusletter 30 août 2021).
La situation est différente pour les travaux réalisés par des étudiants dans le cadre de leur cursus, car il n’existe pas de rattachement par le biais de rapports de travail. Il convient donc d’examiner, au cas par cas, notamment au regard de la finalité du traitement, qui est le responsable de traitement. Ci-après, nous passerons en revue plusieurs configurations en faisant au préalable un détour par l’exception de l’usage exclusivement personnel. A noter que le cas des « doctorants » est singulier car, selon l’institution, ceux-ci peuvent en être l’employé ou non. A notre sens, les travaux effectués par les doctorants ne doivent pas être négligés, car ils peuvent impliquer des traitements de données personnelles extensifs.
Exception de l’usage exclusivement personnel (art. 2 al. 2 let. a LPD)
Une personne physique est généralement soumise à la LPD lorsqu’elle traite des données personnelles. Toutefois, lorsqu’elle traite des données pour son usage exclusivement personnel, la LPD ne trouve pas application. Tel sera par exemple le cas dans le cadre de travaux de généalogie effectués à titre de loisirs. En revanche, si les données sont communiquées à des tiers, l’exception ne s’applique pas et la réglementation applicable en matière de protection des données entre en jeu.
Un étudiant traite « de sa propre initiative » des données personnelles dans le contexte de ses études (l’exercice)
Un étudiant enregistre ses camarades avec son téléphone portable (avec leur approbation) dans le but d’exercer certaines techniques apprises au cours d’un enseignement, à l’image d’une transcription verbatim.
Dans ce cas, l’université n’est pas le responsable de traitement des données personnelles collectées et traitées, car l’étudiant travaille en dehors d’un projet de recherche. Il œuvre « pour son propre compte », et non pour celui de l’université. Les finalités et les moyens du traitement sont fixées par l’étudiant lui-même qui, d’une part, souhaite améliorer ses connaissances pour in fine obtenir un diplôme universitaire (finalité), d’autre part, il détermine quelles données seront collectées, comment elles seront collectées et analysées, etc. (moyens). Il s’agit donc d’un cas d’application de l’exception de l’usage exclusivement personnel tant qu’aucune communication à des tiers n’est effectuée.
Un étudiant soumet à l’université un travail, contenant des données personnelles, pour évaluation (le travail de séminaire)
Des étudiants font passer et enregistrent sur leur ordinateur personnel des entretiens semi-directifs dans le cadre d’un séminaire. Les enregistrements et transcription sont ensuite envoyées à un assistant de l’université pour évaluation.
Comme relevé ci-dessus, dès que les données personnelles sont communiquées à un tiers, l’exception de l’usage exclusivement personnel ne peut plus être invoquée. Une fois les données transmises à l’assistant, l’université devient également responsable du traitement des données contenues dans le travail soumis. En effet, l’assistant qui corrige le travail traite les données personnelles qu’il contient (en le lisant) dans le but de déterminer la note que l’université va attribuer aux étudiants. La finalité poursuivie par l’université (attribuer une note, dispenser un enseignement) peut donc être différente de celles des étudiants (obtenir des crédits ECTS, apprendre un métier, etc.).
Pour déterminer si un étudiant effectue une recherche pour son compte ou celui de l’université, la question des moyens techniques du traitement est également importante. Si l’université impose à un étudiant de recourir aux infrastructures informatiques de l’université pour réaliser un travail, on peut difficilement avancer qu’il agit pour son propre compte car l’université déterminera, à tout le moins partiellement, les moyens du traitement.
Un étudiant traite des données personnelles alors qu’il travaille pour un enseignant (l’intégration dans un groupe de recherche)
Il n’est pas rare qu’afin de plonger des étudiants dans la pratique scientifique, ceux-ci interviennent activement dans un projet de recherche mené par un enseignant. L’université est alors responsable du traitement, car l’étudiant traite les données dans le cadre d’une recherche académique pour les finalités poursuivies/fixées par l’université (« effectuer la recherche XY sur la dyscalculie menée par l’Université ABC »). Habituellement, les moyens du traitement sont dictés par l’université au travers de la supervision exercée par un employé (professeur, chercheur, etc.) et non par l’étudiant lui-même.
Dans cette configuration, l’université serait bien avisée de veiller à ce que les étudiants prennent des engagements portant sur la confidentialité des données. En effet, comme ceux-ci ne sont pas liés par des rapports de travail, leurs obligations ne sont aucunement comparables à celles d’un employé soumis à un secret comme le secret de fonction ou à qui des formations sur la thématique de la protection des données peuvent être proposées (voire imposées).
Il est à noter que la situation des doctorants se trouvent entre celle des étudiants et des employés. A l’Université de Lausanne par exemple, ces derniers obéissent à deux régimes : bien qu’ils fassent partie du corps intermédiaire, ils sont également considérés comme des étudiants. Cette situation peut être clarifiée en précisant soit dans les contrats de travail, soit à l’occasion d’une future révision de la loi sur l’université que les activités de recherche dans le cadre de la thèse sont des « activités au service de l’Université » afin de déterminer le responsable de traitement.
Conclusions
Les situations dans lesquelles un étudiant peut réaliser des recherches impliquant une collecte de données personnelles sont multiples. Mis à part certains cas clairs, un « examen au cas par cas » s’impose pour déterminer qui endosse le rôle de responsable de traitement. Il est par ailleurs opportun de garder à l’esprit la perception des participants à la recherche lorsque des données personnelles sont collectées auprès d’eux : un participant doit pouvoir comprendre si ses données seront traitées par l’université, avec toutes les garanties, notamment de sécurité, qui pourront lui être accordées ou s’il s’agit d’un étudiant disposant de moyens limités. Enfin, si les travaux effectués par les étudiants durant leur parcours académique visent à les préparer à effectuer des recherches scientifiques, il semble judicieux que les exigences en matière de protection des données personnelles soient intégrées suffisamment tôt dans leur cursus afin qu’ils soient à même de répondre aux exigences légales dans ce domaine.
Proposition de citation : Benjamin Amsler / Marie Pfammatter, Collectes de données personnelles par des étudiants dans le cadre de travaux académiques : qui est responsable du traitement ?, 5 mai 2025 in www.swissprivacy.law/350

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.