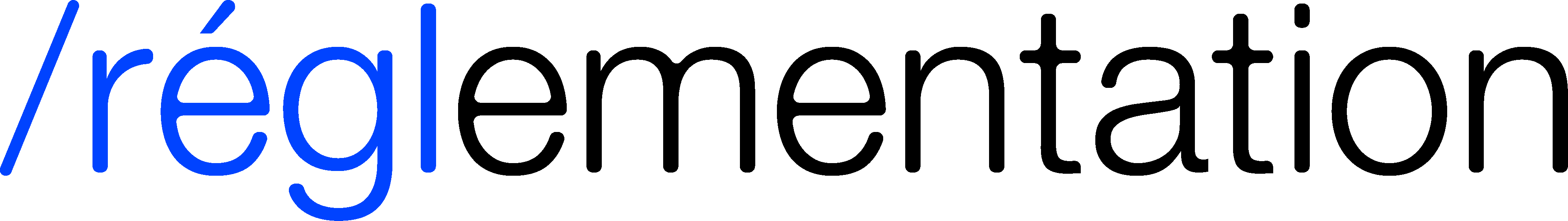Vers un nouveau modèle de réutilisation des données médicales en Suisse ?

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 15.4225 Humbel du 18 décembre 2015, Mieux utiliser les données médicales pour assurer l’efficience et la qualité des soins, 4 mai 2022
Le 4 mai 2022, le Conseil fédéral a publié un rapport de 72 pages en réponse à un postulat qui le chargeait d’examiner comment les données contenues dans les registres spécifiques à certaines maladies ou dans les études médicales pourraient être reliées afin d’être mieux exploitées. Le Conseil fédéral a identifié trois questions principales. La première interroge le potentiel de la réutilisation et de l’exploitation appariée des données médicales (données individuelles sur les mêmes personnes fusionnées à l’aide d’une ou plusieurs caractéristiques personnelles). La deuxième vise à identifier les conditions à remplir pour que les données médicales puissent être réutilisées et traitées par différents groupes d’utilisateurs. Enfin, la troisième question doit permettre d’explorer les développements techniques, organisationnels et juridiques à initier pour la réutilisation des données de santé.
En guise d’introduction, le rapport offre des précisions terminologiques utiles, notamment sur les différents types de réutilisation des données de santé dans le cadre de la recherche. Il présente ensuite un aperçu bienvenu des nombreuses stratégies politiques ou projets scientifiques actuellement menés en Suisse sur la thématique de la numérisation de la santé.
Pour répondre aux questions principales du rapport, le Conseil fédéral commence par mettre en lumière les avantages offerts par une meilleure réutilisation des données de santé. Celle-ci permet en particulier de réduire les « distances » existantes, qu’il s’agisse de distances temporelles (données collectées à différents moments de la vie d’un individu), de contenu (situation de vie), de lieu (espace de vie, facteurs environnementaux) ou de finalité (fins médicales, statistiques ou surveillance…). Concrètement, une réutilisation plus efficace de données doit éviter les collectes multiples de mêmes données, offrir une meilleure flexibilité pour des fins telles que la recherche ou encore optimiser l’utilisation des ressources.
Pour permettre la réutilisation des données entre différents groupes d’utilisateurs, le rapport recourt au concept d’«espaces de données », qu’il définit comme « la structure des relations entre les acteurs des données, c’est-à-dire les personnes concernées, les producteurs de données/responsables et les utilisateurs secondaires de données ». Un espace de données dans le secteur de la santé doit être développé en Suisse. Ce dernier implique la prise en compte d’aspects techniques, juridiques ou sémantiques, mais aussi le développement d’une culture commune de réutilisation des données. Le rapport souligne à cet égard la nécessité de clarifier le rapport entre les acteurs de santé et les données, notamment sous l’angle de la « propriété » des données. Il évoque une piste selon laquelle les données pourraient être considérées comme « propriété partagée (bien collectif) » dans l’espace des données dès lors que la personne concernée par les données y aurait consenti. Le rapport insiste par ailleurs sur la nécessité de développer les principes FAIR, dont le recours est aujourd’hui largement promu dans les milieux de la recherche. En droite ligne avec l’idéal d’open science, les principes FAIR visent à ce que les données de recherche soient faciles à trouver (Findable), accessibles (Accessible), interopérables (Interoperable) et réutilisables (Re-usable).
Sous l’angle juridique, le rapport n’apporte rien de révolutionnaire. Tout en rappelant à juste titre que les aspects éthiques et juridiques sont souvent sous-estimés, il mentionne que « les conditions-cadres du droit de la protection des données et de la recherche [ne sont présentés dans le rapport] que sous une forme générale et fragmentaire, sans émettre d’appréciations concrètes et juridiquement définitives ; celles-ci seront l’objet de clarifications juridiques approfondies dans le cadre des prochaines étapes du projet en ce qui concerne les options à concrétiser ». Le Conseil fédéral se limite ainsi à présenter les concepts généraux applicables sous l’angle des lois fédérales et des réglementations applicables en matière de recherche sur l’être humain, à l’exemple de ce qui constitue ou non une donnée personnelle ou les conditions légales pour la réutilisation des données personnelles à des fins de recherche.
Le rapport expose ensuite une proposition de mise en œuvre d’un « système national de réutilisation et d’appariement des données médicales à des fins de recherche ». Si cette proposition ne peut pas être décrite en détail ici, on retiendra néanmoins qu’elle prévoit la mise en place d’un organe national de coordination des données, un catalogue de métadonnées, ainsi qu’une infrastructure sûre pour le traitement et l’enregistrement des données. Dans les faits, la plupart des composantes de ce modèle sont déjà en développement au travers de différentes initiatives en cours, à l’instar du Swiss Personalized Health Network (SPHN) ou du programme national de gestion des données conduit par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ce dernier développe par exemple une plateforme d’interopérabilité (I14Y) visant une conservation coordonnée et centralisée de métadonnées coordonnée.
Parmi les exigences prises en compte pour la proposition de ce nouveau système figure en particulier une réflexion sur le consentement à l’utilisation primaire et secondaire des données « ou une autre forme de prise en compte adéquate de la personne concernée ». L’une des pistes proposées par le rapport prévoit que les données pourraient, sous certaines conditions, être réutilisées à des fins secondaires si la personne ne s’y est pas opposée (système d’opt-out avec information par voie électronique sur les projets concernés). Le rapport propose par ailleurs l’adoption d’un identificateur univoque pour chaque personne concernée (nécessité pour l’appariement des données) ou encore un concept étendu de protection et de sécurité des données.
Au terme du rapport, le Conseil fédéral donne mandat au DFI de concrétiser les processus et les structures du système proposé ainsi que les adaptations nécessaires des bases légales, en particulier dans le domaine de la protection des données. Le DFI doit en particulier évaluer la plausibilité et la faisabilité des propositions développées dans le rapport.
Ce rapport doit évidemment être salué dans la mesure où il constitue un pas important vers une meilleure exploitation des données médicales, en particulier pour la recherche biomédicale. Il laisse néanmoins une impression plutôt mitigée en ce qui concerne les aspects juridiques. Si l’importance de ceux-ci est soulignée à plusieurs reprises, ils sont souvent traités de manière assez floue tout en indiquant qu’ils devraient faire l’objet d’évaluations futures plus poussées. En ce qui concerne la proposition de nouveau modèle pour la réutilisation des données, on constate que la plupart des « éléments » du système existent déjà aujourd’hui (ou sont à tout le moins en cours de développement). Il s’agit maintenant d’entamer ce chantier important pour réunir les différentes pièces du puzzle et construire un système qui soit à la fois efficace et favorable à la recherche, tout en protégeant les personnes concernées et en assurant un niveau de sécurité optimal. Hasard du calendrier ou non, le PFPDT a en effet récemment constaté dans son dernier rapport d’activités (p. 48) que la sécurité et l’exactitude des registres de données de santé gérés par les associations privées ou fondations laissait souvent à désirer (pour l’exemple particulier de la fondation mesvaccins.ch, voir www.swissprivacy.law/94).
Proposition de citation : Frédéric Erard, Vers un nouveau modèle de réutilisation des données médicales en Suisse ?, 12 juillet 2022 in www.swissprivacy.law/156

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.