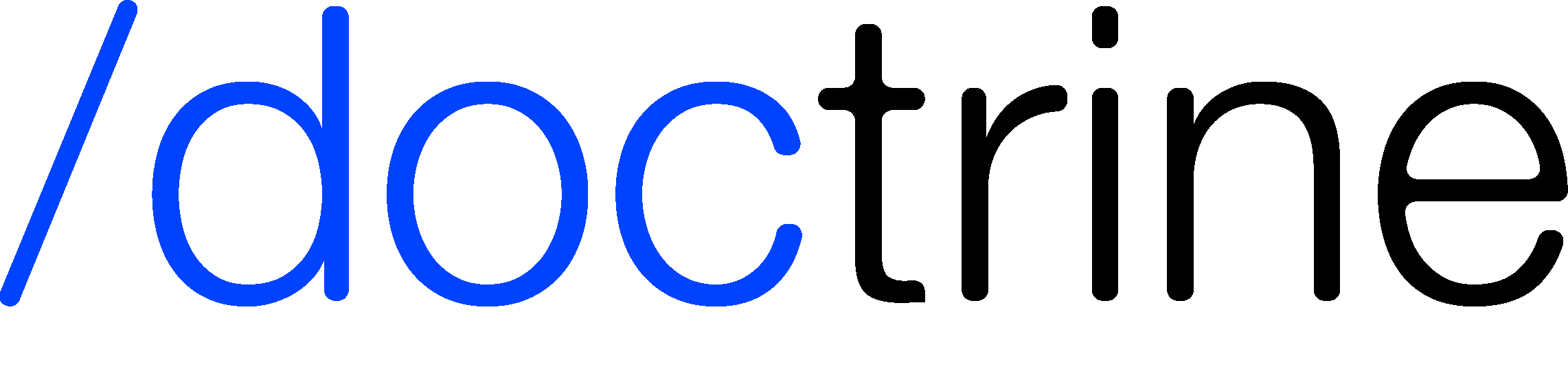Cookies Walls – La nouvelle arnaque aux données

Publicité en ligne
Il est impossible de déterminer avec exactitude les origines des premières pratiques publicitaires. Pour l’anecdote, il est cependant intéressant de constater que des fresques annonçant des combats de gladiateurs ont été retrouvées par des archéologues, ce qui suggère que de telles pratiques existaient déjà dans la Rome antique. En ce qui concerne le World Wide Web, la première bannière publicitaire est apparue en 1994 sur le site web du magazine en ligne HotWired, spécialisé sur l’incidence des technologies émergentes. Il s’agissait d’une publicité du fournisseur de services téléphoniques AT&T. Pour la plus grande satisfaction de l’industrie – et à l’inverse, pour la plus grande frustration des internautes –, la publicité en ligne s’est depuis nettement développée, et ce en raison de plusieurs motifs.
Premièrement, les éditeurs de sites web sont désormais nombreux à tirer des revenus de la vente d’espaces publicitaires. Ce choix délibéré s’explique notamment en raison du nombre élevé d’éditeurs de sites web offrant gratuitement du contenu. Il existe pour eux un véritable intérêt à monétiser leur travail.
Deuxièmement, le World Wide Web est devenu rapidement un outil indispensable, si ce n’est irremplaçable. Le nombre d’internautes n’a logiquement jamais cessé de s’accroître, au même titre que les moyens informatiques pour y accéder.
Troisièmement, les fournisseurs de réseaux publicitaires ont investi des moyens considérables pour développer des technologies – invasives – pour déterminer avec précision les centres d’intérêt des internautes. Figure parmi les technologies les plus décriées en matière de protection de la vie privée celle du traçage en ligne des internautes qui permet de déterminer avec précision leurs centres d’intérêt, et donc de proposer du contenu publicitaire pertinent.
Par abus de langage, ou simplification de la réalité technique, la notion de cookies publicitaires (que nous reprendrons également) est couramment utilisée, alors même que les technologies de traçage comprennent de nombreuses technologies (p. ex. cookie, fingerprinting, web beacon, etc.). À souligner qu’en pratique, et sans prétendre à l’exhaustivité, la distinction entre les cookies nécessaires et les cookies non nécessaires est généralement faite. Les cookies non nécessaires comprennent notamment les cookies statistiques, les cookies fonctionnels ou les cookies publicitaires.
Les méthodes de suivi en ligne posent de nombreux défis juridiques, dont un certain nombre ont été empoignés par les autorités européennes de protection des données ou par les tribunaux européens à l’aune du RGPD. Parmi ceux-ci, nous pensons notamment aux principales obligations à respecter (p. ex. l’information des personnes) ou aux modalités du consentement (p. ex. la récolte, la durée de validité, le retrait et les exemptions).
Les conditions quant à la collecte du consentement (art. 7 RGPD) sont particulièrement délicates à mettre en place pour les éditeurs de sites web, celles-ci empiétant sur leur intérêt à monétiser le contenu de leur site web. Pour y faire face, de nombreux éditeurs de sites web ont mis en place des cookies walls (ou murs de traceur) afin de permettre à leur modèle économique de perdurer.
Cookies walls
Les cookie walls permettent à l’éditeur de site web (i) de bloquer l’accès à son site web, ou plus précisément au service proposé sur celui-ci, pour tout internaute ayant refusé le dépôt de cookies non nécessaires à la fourniture de ce service et (ii) de conditionner l’accès au service à l’acceptation par l’internaute du dépôt de cookies non nécessaires. Cette pratique vise principalement le dépôt de cookies publicitaires et se heurte au principe de la liberté de consentement. À noter qu’aujourd’hui, en cas de refus de l’internaute au dépôt des cookies non nécessaires, l’éditeur du site web propose généralement une alternative consistant en un accès payant au service (p. ex. l’accès au site web) plutôt que de purement et simplement refuser son accès.
Critères d’évaluation
Sans avoir été interdite, l’expansion de cette pratique a conduit la CNIL à présenter des critères d’évaluation pour déterminer leur conformité vis-à-vis du RGPD.
Premièrement, le site web doit proposer une alternative réelle et équitable pour accéder au contenu dans le cas où l’internaute refuserait les cookies non nécessaires (p. ex. le paiement d’une somme d’argent). Dans le cas contraire, l’éditeur du site web doit démontrer l’existence d’un autre site offrant une telle alternative. L’accès au contenu de cet autre éditeur de site web doit être possible sans cookie wall. La CNIL met en avant le risque de déséquilibre entre l’éditeur du site web et l’internaute. En effet, le choix entre les traceurs et l’alternative doit être libre et l’accès à cette dernière facilité. Dans le cas où un éditeur de site web aurait l’exclusivité sur les contenus proposés ou lorsque peu d’alternatives existent, le choix ne peut pas être considéré comme véritable.
Deuxièmement, si l’alternative consiste au paiement d’une somme d’argent, le montant de cette dernière doit être raisonnable. Celui-ci est considéré comme tel lorsqu’il ne prive pas l’internaute d’un choix véritable. Le montant se détermine au cas par cas, mais ne doit pas reposer selon nous sur la situation économique personnelle de l’internaute. La CNIL encourage la publication de l’analyse faite par les éditeurs de sites web pour justifier le caractère raisonnable de la contrepartie financière. L’utilisation de porte-monnaie virtuels est également privilégiée, afin que des transactions ponctuelles soient possibles sans enregistrement des données bancaires de l’internaute. La création d’un compte ne doit être imposée que si la finalité le justifie.
Si l’alternative est acceptée, aucun cookie non nécessaire ne doit être déposé. Reste cependant la possibilité pour l’éditeur du site web de récolter le consentement de l’internaute au cas par cas pour les cookies non nécessaires qui ne concernent pas les cookies publicitaires. Il appartient alors à l’éditeur du site web de respecter les exigences usuelles.
Troisièmement, dans le cas où l’utilisateur accepte les cookies non nécessaires, seuls les cookies publicitaires dont la finalité est la rémunération peuvent être déposés. La CNIL reconnaît implicitement ici l’intérêt des éditeurs de sites web de déposer de tels cookies afin de monétiser le contenu de leur site web (et ce même si la question est controversée). À l’inverse, il faut comprendre que les autres cookies non nécessaires ne visant pas cette finalité ne peuvent pas être imposés par un cookie wall, à l’instar des cookies statistiques. Là aussi, l’éditeur du site web peut toutefois récolter le consentement de l’internaute au cas par cas pour les autres cookies non nécessaires.
Quel avenir pour les cookies walls ?
Les critères d’évaluation de la CNIL apportent de la clarté quant à la question du recours aux cookies walls. Il est probable que d’autres autorités européennes de protection des données émettent des critères semblables, celles-ci adoptant généralement une forme d’unité dans le traitement des affaires. À titre d’exemples, on peut citer les décisions prises dans les affaire Google Analytics : la décision de l’autorité autrichienne de protection des données du 22 décembre 2021 ainsi que la décision de mise en demeure de la CNIL du 10 février 2022 et plus récemment la décision de l’autorité italienne de protection des données du 9 juin 2022.
La question des cookies walls n’a jusqu’à aujourd’hui jamais été traitée par la CJUE. Elle a toutefois été effleurée dans le cadre de l’arrêt C‑673/17 du 1er octobre 2019. Sans que la question ne lui soit posée par la juridiction de renvoi, la CJUE souligne au considérant 64 dans son arrêt ce qui suit :
« Il convient, enfin, de souligner que la juridiction de renvoi n’a pas saisi la Cour de la question de savoir si la circonstance que le consentement d’un utilisateur au traitement de ses données personnelles à des fins publicitaires conditionne la possibilité, pour celui-ci, de participer à un jeu promotionnel, comme cela semble être en l’occurrence le cas, selon les indications figurant dans la décision de renvoi, à tout le moins pour la première case à cocher, est compatible avec l’exigence d’un consentement « libre » […]. »
La remarque de la CJUE peut être transposée au cas des cookies walls, dès lors que ceux-ci conditionnent l’accès à un site web à la possibilité de déposer des cookies publicitaires. Si la CJUE n’a vraisemblablement pas souhaité ouvrir la boîte de pandore, elle devra toutefois le faire dans le cadre de l’affaire C‑446/21 qui a été portée devant la CJUE par la Cour suprême autrichienne. Plusieurs questions préjudicielles sont posées dans le cadre de cette affaire opposant Maximilian Schrems (oui, ce Schrems là) à Facebook Ireland (oui, encore). Parmi celles-ci, il y a notamment la question de savoir si le consentement (art. 6 par. 1 let. a RGPD) est l’unique motif justificatif possible quant à la possibilité de traiter des données personnelles à des fins de publicité personnalisée.
Outre les considérations juridiques, il reste à voir quelle attitude sera adoptée par les internautes dans le futur quant à la question de la publicité personnalisée et des cookies walls. Les alternatives payantes seront-elles réellement utilisées par les internautes, ou ceux-ci préféreront-ils – en toute conscience ou non – le dépôt de cookies publicitaires ? L’avenir le dira. À noter finalement que la technique est elle aussi susceptible de se développer rapidement. La société Google, qui est l’un des principaux acteurs de la publicité en ligne, réfléchit déjà à changer en profondeur le fonctionnement de son système relatif à la publicité en ligne.
Proposition de citation : Charlotte Beck / Livio di Tria, Cookies Walls – La nouvelle arnaque aux données, 3 août 2022 in www.swissprivacy.law/163

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.