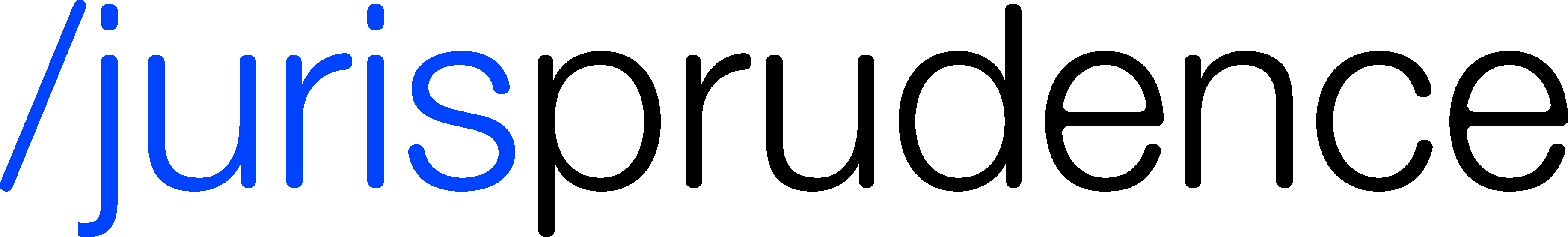Protection des données et archivage : la fin de la quadrature du cercle ?

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1024/2021 du 2 novembre 2022 (destiné à la publication)
Le pitch
Dans le cadre d’une affaire menée par le Tribunal des mineurs du canton de Bâle-Ville entre 1988 et 1991, le recourant est suivi par la Clinique psychiatrique universitaire bâloise pour enfants et adolescents. Cette dernière constitue un dossier médical comprenant des documents de traitement, des expertises psychiatriques et des rapports d’évolution. Le dossier judiciaire du recourant est déposé aux Archives de l’État en 2008 par le Tribunal des mineurs. En 2017, la Clinique transmet à son tour le dossier médical du recourant aux Archives de l’État pour qu’il soit joint à son dossier judiciaire.
Le recourant demande aux Archives de l’État de lui remettre son dossier judiciaire et son dossier médical ainsi que leurs éventuelles copies. Subsidiairement, il demande au moins que l’accès à ces documents soit bloqué. Cette demande est refusée devant toutes les instances cantonales. Bien qu’elles reconnaissent que la conservation des données personnelles du recourant constitue une atteinte grave à son droit à l’autodétermination informationnelle, elles relèvent cependant que cette atteinte repose sur une base légale au sens formel, qu’elle poursuit un intérêt public et qu’elle paraît également proportionnée au regard des finalités du traitement des données. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral donne raison aux autorités cantonales.
Le Tribunal fédéral relève qu’il n’est pas contesté que la transmission du dossier judiciaire et du dossier médical du recourant aux Archives de l’État constitue une atteinte grave à son droit à la sphère privée et à l’autodétermination informationnelle. Cela est même d’autant plus vrai que les données ne sont plus conservées conformément à leur but initial. Mais les droits fondamentaux ne sont pas absolus et peuvent subir des restrictions à conditions d’être prévues par la loi, d’être justifiées par l’existence d’un intérêt public et de satisfaire au principe de proportionnalité.
La légalité du traitement
Le Tribunal fédéral débute avec l’examen de la légalité de la conservation des données du recourant. Il procède à une analyse détaillée de la législation du canton de Bâle-Ville en faisant jouer entre elles plusieurs lois différentes.
Il commence par indiquer que les données litigieuses sont soumises initialement au délai de conservation de dix ans prévu dans la loi cantonale sur la santé (GesG ; RS/BV 300.100). À l’issue de ce délai, elles tombent sous le coup de l’art. 16 de la loi cantonale sur l’information et la protection des données (IDG ; RS/BV 153.260). Selon cette disposition, les données qui ne sont plus nécessaires et qui sont jugées comme ne présentant aucune valeur archivistique doivent être supprimées. C’est à ce moment qu’intervient la loi cantonale sur les archives (Archivgesetz ; RS/BV 153.600). Cette dernière prévoit que les organes publics sont tenus de proposer périodiquement les documents dont ils n’ont plus besoin pour l’accomplissement de leurs tâches aux Archives de l’État pour qu’elles les prennent en charge (art. 7 al. 1 Archivgesetz). Cette obligation vaut pour tous les documents, y compris ceux qui « contiennent des données personnelles dignes de protection » ou qui « sont soumis à une obligation spécifique de garder le secret » (art. 7 al. 2 Archivgesetz).
Le Tribunal fédéral parvient ainsi à la conclusion que, selon la loi cantonale sur les archives, il revient aux Archives de l’État de décider ultimement du sort des données lorsqu’elles se prononcent sur la valeur archivistique d’un document (art. 5 al. 1 let. a Archivgesetz). Même s’il reconnaît que les Archives bénéficient dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation, il relève cependant que ce pouvoir n’est pas infini. Il est limité par les restrictions d’accès aux données archivées (délais de protection ; art. 10 Archivgesetz) et les possibilités de contrôle (voie de recours ; art. 19 Archivgesetz) prévues par la loi. Le Tribunal fédéral propose de rediscuter ce point à l’étape de la pesée des intérêts publics et privés à la conservation des données litigieuses.
L’intérêt public du traitement
La deuxième étape du raisonnement consiste à savoir si la conservation par les Archives de l’État du dossier judiciaire et médical du recourant poursuit un intérêt public. Ici, la réponse ne fait pas un pli.
L’archivage – écrit le Tribunal fédéral de sa plus belle plume – permet aujourd’hui de se confronter rationnellement à hier.
Le retour sur le passé proche ou lointain doit servir à la société en tant qu’acte d’affirmation et d’autodétermination. Cela permet de retranscrire la réalité sociale […] et de rendre l’action de l’État compréhensibles et contrôlables. Dans ce but, il faut des informations fiables, une « mémoire collective ». Les archives ont pour fonction de conserver à long terme les documents nécessaires à cet effet. Elles représentent une tâche indispensable – publique en ce qui concerne l’action de l’État – pour la compréhension (rétrospective) et le contrôle de l’action étatique. Selon le Tribunal fédéral, l’ingérence dans la sphère privée et le droit à l’autodétermination informationnelle du recourant sert donc indiscutablement un intérêt public.
La proportionnalité du traitement
C’est donc dans la dernière étape de l’examen de la proportionnalité et de la pesée des intérêts en présence que se dénoue cette affaire.
Le Tribunal fédéral rappelle qu’en cas d’ingérence dans le droit à la protection des données, il convient, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, de mettre en balance l’intérêt public à la collecte ou à l’archivage des données avec celui de la protection de l’autodétermination informationnelle de la personne concernée. Les données médicales bénéficient à cet égard d’une protection particulière, car il s’agit non seulement de préserver la vie privée, mais aussi la confiance dans la profession médicale et dans le système de santé. Il faut dès lors prévoir des garanties suffisantes contre une éventuelle utilisation abusive de ces données.
Se replongeant une deuxième fois dans la loi cantonale sur les archives du canton de Bâle-Ville, le Tribunal fédéral relève que les données qui sont archivées ne deviennent pas librement accessibles. Il existe notamment des délais de protection durant lesquels les documents archivés sont, en principe, soustraits de la consultation. Les documents qui, comme ceux du recourant, se rapportent à des personnes physiques de par leur destination ou leur contenu essentiel, ne peuvent être utilisés que 10 ans après le décès de la personne (ou 100 ans après la naissance si la date du décès n’est pas connue). Une consultation anticipée ne peut avoir lieu qu’à des conditions très strictes dans des buts prédéfinis et uniquement par des personnes autorisées. Le Tribunal fédéral arrive ainsi à la conclusion que la loi cantonale sur les archives tient compte de manière appropriée des intérêts dignes de protection du recourant et des intérêts publics à la conservation de ses données personnelles. Selon le Tribunal fédéral, ces données pourront vraisemblablement servir pour l’étude de l’histoire de la psychiatrie ou du droit pénal analytique des mineurs.
Dans un dernier grief, le recourant invoque une inégalité de traitement entre les patients des cliniques privées et ceux des cliniques publiques en matière d’archivage, car les documents des patients des cliniques privées ne finissent pas dans les Archives de l’État. Le Tribunal fédéral rétorque que le but de la loi cantonale sur les archives est de rendre compréhensible et contrôlable les activités des organes publics, pas des institutions privées.
Sur la base de cet examen, le Tribunal fédéral déclare le recours infondé et confirme que c’est à bon droit que le dossier judiciaire et le dossier médical du recourant ont été déposés aux Archives de l’État.
La critique
L’arrêt a, en quelque sorte, l’avantage de la simplicité. Tandis que les questions d’archivage et de protection des données sont généralement vues comme insolubles par les juristes des administrations publiques, le Tribunal fédéral leur répond qu’ils doivent conserver tous leurs documents et les proposer le moment venu aux Archives pour que ces dernières fassent le tri. On imagine leur soulagement.
Mais si la question a jusqu’ici été jugée aussi compliquée, ce n’est probablement pas un hasard. Elle met en évidence la difficulté qu’il peut y avoir à concilier certaines valeurs et certains intérêts que le législateur a élevés au rang de loi avec ceux qui figurent dans d’autres réseaux normatifs, notamment la réalisation des droits fondamentaux.
Le Tribunal fédéral souligne à raison le rôle essentiel des archives dans une société démocratique, car elles documentent l’action de l’État et la rendent vérifiable par tous. Les archives constituent la mémoire collective de la société. Les histoires et les trajectoires individuelles en font naturellement partie et il existe des raisons objectives de vouloir en conserver une trace. C’est notamment grâce à l’archivage de données personnelles qu’il a été possible de mettre en évidence des pratiques antidémocratiques comme l’affaire des fiches ou celle des enfants placés.
Néanmoins, il semble que l’arrêt arrive au résultat que la législation sur l’archivage constituerait en fin de compte une loi spéciale (une lex specialis) par rapport à la législation sur la protection des données. Au sein des administrations publiques, le principe de la conservation des informations présentant une valeur archivistique l’emporterait ainsi de manière systématique sur celui de la suppression des données personnelles qui n’ont plus d’utilité (autre qu’archivistique)
Du point de vue de la protection des droits fondamentaux, il en résulte un certain malaise. Un principe cardinal du droit de la protection des données se retrouve presque estompé avec un risque d’abus réel, puisqu’il existera toujours un moyen pour les pouvoirs publics ou d’autres personnes privées de retrouver de vieilles informations sur un individu.
Malgré tout, le raisonnement du Tribunal fédéral paraît difficilement critiquable sur le plan de la technique juridique. Il peut même trouver une justification supplémentaire dans le fait que le RGPD prévoit lui-même toute une série d’exceptions concernant les traitements ultérieurs de données à des fins archivistiques dans l’intérêt public (cf. les art. 5 par. 1 let. b et e, 9 par. 2 let. j, 14 par. 5 let. b, 17 par. 3 let. d et 89)Reste qu’on peut se demander s’il n’existe pas malgré tout un meilleur moyen de concilier les intérêts prévus dans la législation sur la protection des données avec ceux prévus dans la législation sur l’archivage. Plutôt que de tout déposer aux Archives, on pourrait envisager, en tout cas pour les dossiers les plus sensibles, de procéder au moyen d’un échantillonnage et d’accorder aux personnes concernées une possibilité de s’opposer à l’archivage définitif des données les concernant.
Finalement, on n’oubliera pas non plus que certaines données ne doivent pas être archivées. Dans ce cas, est-il suffisant de prévoir dans une loi (ou une ordonnance ?) que des données doivent être effacées ou supprimées à l’issue d’un certain délai pour que cette règle devienne à son tour une lex specialis par rapport à la loi sur l’archivage ? Ou, à l’instar de l’art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ ; RS 330), sera-t-il nécessaire d’énoncer expressément que les données du casier judiciaire ne sont pas archivées ? Du point de vue du législateur, il faudra dorénavant intégrer cette nouvelle composante au moment de traiter ces questions.
Proposition de citation : Michael Montavon, Protection des données et archivage : la fin de la quadrature du cercle ?, 2 mars 2023 in www.swissprivacy.law/205

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.