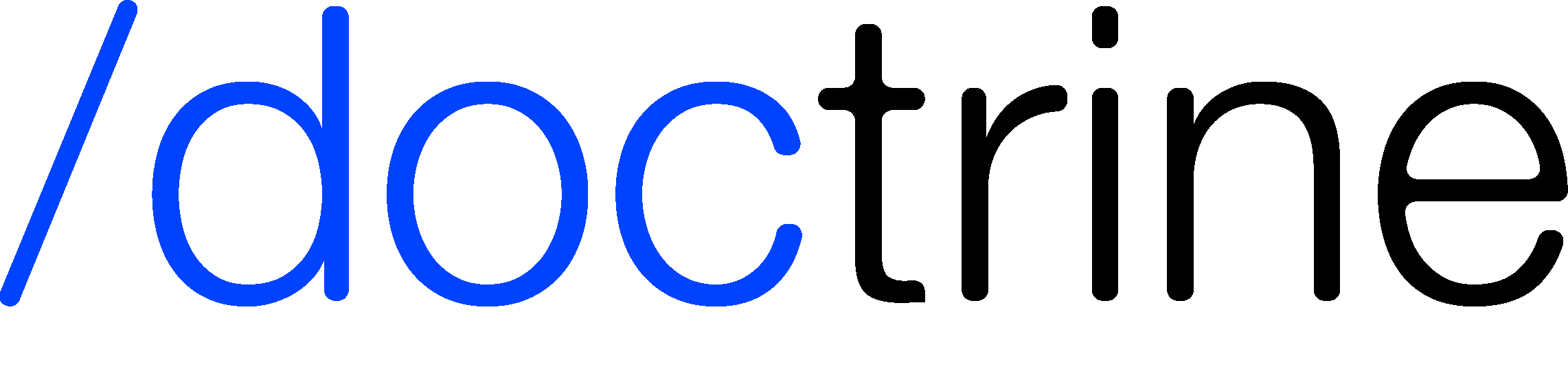Droit à l’intégrité numérique : une réponse dans l’air du temps ?

Un nouveau concept indéterminé
Le droit à l’intégrité numérique (Das Recht auf digitale Integrität) est aujourd’hui un concept en vogue, et ce notamment en Suisse romande. Des projets de modifications constitutionnelles ont éclos dans les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud. Au niveau fédéral, l’initiative 22.479 « Introduire dans la Constitution le droit à l’intégrité numérique » déposée par le député vaudois Samuel Bendahan est actuellement à l’étude. Le droit à l’intégrité numérique est en revanche moins discuté outre-Sarine.
Quelle sera la portée normative de ce nouveau droit en gestation ? Celui-ci sera-t-il justiciable ou non ? Existe-t-il une redondance avec la protection de la sphère privée ou le droit à la liberté personnelle ? Qu’implique-t-il en termes de prestations attendues de l’État ? La réponse à ces questions reste à ce jour relativement complexe, car le droit à l’intégrité numérique n’existe encore nulle part et ne fait pas l’objet d’un consensus.
Dans sa version la plus épurée telle que présentée par l’initiative de Samuel Bendahan, l’intégrité numérique se veut comme le prolongement de l’intégrité physique et psychique de la personne. Sa concrétisation au niveau constitutionnel ne requerrait qu’une modification succincte du droit fondamental à la vie et à la liberté personnelle. Sur le plan fédéral, il suffirait de modifier l’art. 10 al. 2 Cst. pour que celui-ci garantisse à tout être humain l’intégrité numérique, en addition à l’intégrité physique, psychique et à la liberté de mouvement.
Mais le droit à l’intégrité numérique se prête aussi à des conceptions plus hétéroclites. Dans les cantons de Genève et de Vaud, le droit à l’intégrité numérique octroierait à l’individu une protection contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne et le droit à l’oubli. S’y ajoute la responsabilité pour l’État de ne pas traiter des données à l’étranger dans des pays n’assurant pas un niveau de protection adéquat et l’obligation de favoriser l’inclusion numérique et de s’engager en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse.
Dans le canton du Valais, le droit à l’intégrité numérique consisterait dans la capacité de l’individu à agir librement par le biais des technologiques numériques, le droit à un accès ouvert et sans discrimination au réseau internet, et le droit de contrôler et de disposer de son identité numérique, notamment à des fins d’identification et d’accès à des services.
Dans le canton de Neuchâtel, l’intégrité numérique regrouperait cette fois la sécurité dans l’espace numérique, le droit de ne pas être surveillé, mesuré ou analysé, le droit à une vie hors ligne et le droit à l’oubli.
Il est vrai qu’il n’est pas inhabituel pour un droit fondamental de se dessiner progressivement et même de conserver une certaine indétermination pour atteindre ses objectifs. Mais il est plus inhabituel qu’il prenne des directions et des acceptations aussi différentes en fonction de la collectivité publique concernée. Dans un domaine aussi protéiforme et instable que le numérique, cela risquerait de soulever des difficultés au moment de l’interprétation et de la mise en œuvre du nouveau droit.
Des motivations dans l’air du temps
Du développement d’Internet à la globalisation en passant par le Big Data, les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle ou l’émergence de l’empire des GAMAM, les prétextes sont nombreux pour vouloir dépoussiérer le catalogue des droits fondamentaux que renferme la Constitution fédérale ou les Constitutions cantonales.
Le droit à l’intégrité numérique tire son fondement de la société de l’information dans laquelle nous vivons. Puisque nous évoluons dorénavant dans un monde de technologies numériques et de données, le droit doit prendre en considération ce nouvel écosystème et y apporter des réponses appropriées.
Sont concernées notamment toutes les traces numériques que les individus laissent derrière eux lorsqu’ils font usage d’Internet ou d’une application en ligne. Pour les défenseurs d’un nouveau droit à l’intégrité numérique, ces traces ne seraient pas uniquement des données personnelles, mais correspondraient plus largement à des éléments constitutifs de la personne humaine. À l’image du sang, chaque personne devrait disposer sur celles-ci de droits inaliénables et opposables à tous.
Cette nouvelle conception vise à renverser le déséquilibre qui s’est installé dans les relations entre, d’une part, les personnes dont les données sont collectées et, d’autre part, les organisations qui traitent ces données et/ou en font leur modèle d’affaires. Pareille tentative de rééquilibrage est perçue comme un prérequis nécessaire à la préservation de la démocratie et de l’État de droit. Car en s’arrogeant des situations de quasi-monopole sur l’usage de nos données, certaines organisations privées en sont venues à sérieusement concurrencer le pouvoir des collectivités publiques dans plusieurs domaines d’activité qui devraient normalement être soumis à la loi.
Une (brève) analyse
Le constat selon lequel le développement fulgurant des technologies numériques met le législateur sous pression n’est pas nouveau. Mais il est vrai qu’il a sans doute acquis récemment une dimension renouvelée avec l’interdiction temporaire de ChatGPT prononcée par le Président de l’autorité italienne de protection des données (cf. https://swissprivacy.law/213/) et l’appel à un moratoire sur le développement de l’IA lancé par un panel d’experts.
Pour autant, peut-on réellement parler d’une faillite du droit et, dans l’affirmative, peut-on réellement attendre que celle-ci soit résolue par la reconnaissance d’un nouveau droit constitutionnel à l’intégrité numérique ?
S’agissant de la première question, la réponse doit certainement être nuancée. D’un côté, il est incontestable que les développements technologiques et sociétaux intervenus depuis quelques années ont engendré de nouvelles menaces pour la protection des droits et des libertés. De l’autre côté, les normes de droit en vigueur ont généralement fait preuve d’une étonnante capacité d’adaptation (notamment en raison de leur caractère technologiquement neutre) et les appels à modifier de fond en comble les lois existantes n’ont la plupart du temps pas été suivis d’effets, seuls des besoins d’adaptations ponctuelles ayant été mis en évidence (p. ex. dans le domaine du travail : Rapport du Conseil fédéral sur les conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques).
Cela ne veut pas dire que des adaptations plus globales ne soient jamais nécessaires. Preuve en est la révision totale de la Loi fédérale sur la protection des données. Elle assurera à la population un niveau de protection des données renforcé sur de nombreux aspects (transparence, profilage, décisions rendues par des machines, analyses d’impact, annonces des violations de la sécurité, etc.). Mais cet exemple tend plutôt à démontrer qu’en présence d’un besoin avéré d’intervention, une action du législateur est alors préférable à une action du constituant, car elle permet de traiter un problème dans son ensemble. Il en va probablement ainsi également du développement de l’intelligence artificielle (pour une analyse du projet législatif européen en la matière, cf. www.swissprivacy.law/213).
À cela s’ajoute que le risque d’une défaillance d’ordre constitutionnel semble peu probable. À notre connaissance, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a jamais mis en évidence une véritable lacune dans la protection des individus face au numérique. L’aurait-elle fait que le Tribunal fédéral aurait pu combler cette lacune lui-même en créant un nouveau droit constitutionnel par voie prétorienne. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait lorsque, en s’éloignant du texte trop limitatif de l’art. 13 al. 2 Cst., il a repris le droit fondamental à l’autodétermination informationnelle créé quelques années plus tôt par la Cour constitutionnelle allemande. Dorénavant, toute personne jouit du droit de décider si et dans quels buts des informations qui la concernent peuvent être conservées et traitées par des tiers, publics ou privés (p. ex : ATF 148 I 233, consid. 3.1).
Il existe sur cette base une vaste jurisprudence irriguant aujourd’hui tous les domaines du droit tant privé que public. Dans ces circonstances, on peut sérieusement se demander s’il ne serait pas préférable d’inscrire (enfin !) dans la Constitution le droit à l’autodétermination informationnelle plutôt que de s’aventurer sur un terrain, certes passionnant, mais un peu incertain quand même. Il est vrai toutefois que le droit à l’autodétermination informationnelle se limite uniquement à garantir la maîtrise d’une personne sur ses données et qu’il ne s’étend pas à n’importe quelle facette du numérique tel que le droit à la déconnexion ou le droit à l’inclusion. Vouloir traiter tous ces droits au moyen d’une seule et même disposition semble néanmoins un peu illusoire. Par ailleurs, ne peuvent-ils pas déjà être déduits d’autres droits tels que la liberté individuelle, l’intégrité psychique, l’égalité ou encore d’autres lois, notamment la loi sur le travail et les dispositions qu’elle contient sur les horaires de travail (s’agissant du droit à la déconnexion, cf. réponse du Conseil fédéral à la motion 19.4156 « Outils numériques. Droit à la déconnexion »).
Cette remarque appelle les questions suivantes :
- Le numérique constitue-t-il réellement un élément distinct de la personnalité d’un individu méritant d’être protégé au même titre que son intégrité physique et psychique ou n’est-il pas plutôt un environnement dans lequel cette personnalité se déploie ?
- Dans l’hypothèse d’une atteinte à l’intégrité numérique d’une personne, est-ce que la souffrance en résultant se distingue-t-elle de la souffrance causée à son intégrité physique ou psychique ?
- Les droits et les libertés reconnus dans la Constitution et les lois sont-ils limités à l’univers physique ou n’ont-ils pas vocation à s’appliquer également aux environnements numériques ?
Conformément à l’article art. 35 al. 1 Cst., les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a retenu que la suppression d’un commentaire publié par un individu sur la page Instagram de la SRF constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression et doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle judiciaire au sens de l’art. 29a Cst. (cf. arrêt 2C_1023/2021*, consid. 2.1, 3.1 et 4.2). À supposer que le droit à l’intégrité numérique existât, on aurait probablement pu envisager son invocation dans cette affaire. Mais l’arrêt du Tribunal fédéral indique, semble-t-il de manière satisfaisante, que l’utilité d’un tel droit n’est pas vraiment démontrée, la liberté d’expression ayant aussi vocation à protéger les individus (et leur intégrité) sur Internet.
Last but not least, il reste encore la question du champ d’application et de la justiciabilité du droit à l’intégrité numérique. Vu le contenu du droit à l’intégrité numérique tel qu’il est proposé dans les cantons surtout, ainsi que les motivations de ceux qui défendent la reconnaissance d’un tel droit, on comprend que le but poursuivi n’est pas uniquement de protéger les individus contre les organes des collectivités publiques, mais de leur offrir une protection la plus globale possible sur Internet. Or les droits fondamentaux ne sont pas dirigés contre les entreprises privées, mais avant tout contre l’État. Au niveau cantonal, ce principe ne peut pratiquement pas être contourné, si bien que les promesses faites ne pourront que très difficilement être tenues. Au niveau fédéral, la situation est légèrement différente mais pas de beaucoup. L’art. 35 al. 3 Cst. consacre certes une forme d’applicabilité des droits fondamentaux dans les rapports privés. C’est l’effet horizontal des droits fondamentaux. Mais il s’agit d’un outil délicat à mettre en œuvre, qui n’est pas comparable à un droit directement invocable.
Demeure alors l’argument de l’effet symbolique de l’inscription d’un droit à l’intégrité numérique dans la Constitution. Un tel argument ne doit pas être sous-estimé. Si, conscient de la portée symbolique de son texte, le constituant mise sur la force qu’il pourra exercer pour faire évoluer le droit dans une certaine direction, alors pourquoi ne pas éventuellement tenter l’opération ? Mais, pour cela, il faudrait être transparent sur la portée et les limites du nouveau droit proposé. Il semble aussi qu’il serait souhaitable que les défenseurs du droit à l’intégrité numérique commencent par se mettre d’accord sur son contenu véritable plutôt que de voir apparaître sous une même dénomination une multitude d’idées un peu disparates selon les lieux.
Proposition de citation : Michael Montavon / Livio di Tria, Droit à l’intégrité numérique : une réponse dans l’air du temps ?, 12 mai 2023 in www.swissprivacy.law/226

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.