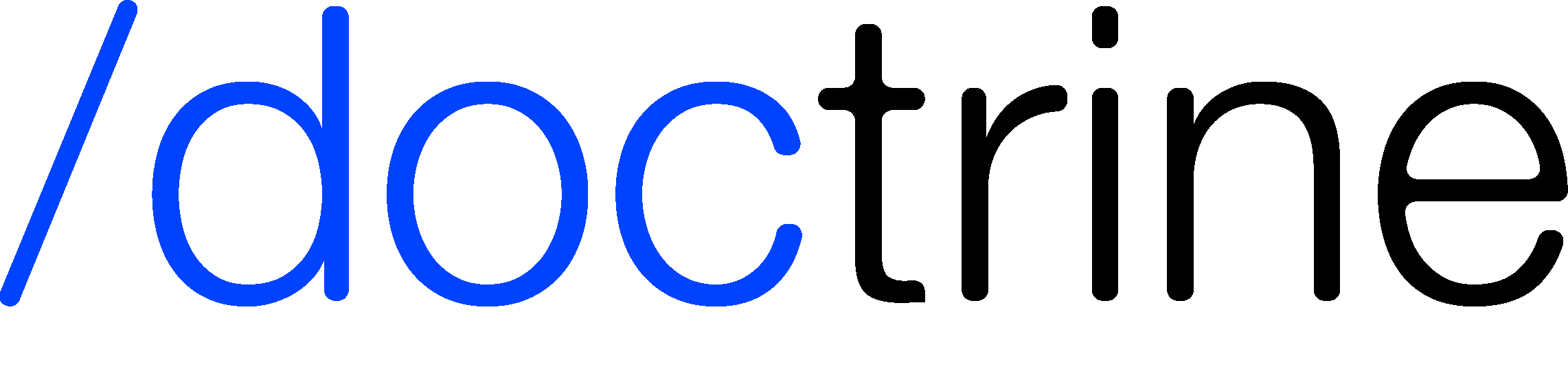L’accès aux données d’examen

Introduction
Pour les étudiants, les joies de l’été sont encadrées par deux périodes de tension : les sessions d’examen de juin et de septembre. La soif de savoir de certains étudiants ne s’arrête pas au contenu des cours, mais également à la mécanique des examens, et aux critères qui les ont conduits à réussir ou à échouer. Certaines informations sont librement accessibles, d’autres facilement communiquées, mais pour aller au fond des choses, il est parfois nécessaire de recourir à des moyens juridiques. Le droit d’accès aux données d’examen fait l’objet de la présente contribution. Nous nous focaliserons sur les institutions d’enseignement de droit public, les établissements privés ne relevant pas des mêmes règles, en particulier en matière de transparence.
À titre liminaire, nous devons exposer la différence entre les garanties procédurales (en particulier le droit d’être entendu) et le droit d’accès. Lorsqu’un étudiant se trouve dans un contentieux avec une institution d’enseignement, les règles de la procédure administrative s’appliquent. L’étudiant peut ainsi obtenir une décision motivée, accéder au dossier et aux pièces, et se déterminer à leur propos.
Le droit d’accès se recoupe en partie avec ces droits de procédure (en particulier devant les tribunaux administratifs de première instance sur le plan fédéral, cf. art. 2 al. 3 LPD), mais ne se confond pas. En particulier, le droit d’accès ne suppose pas un contentieux existant, mais ne permet pas non plus d’obtenir des informations autres que celles qui existent déjà ou qui se rapportent au traitement – au contraire, par exemple, d’explications détaillées établies par un examinateur au titre du droit à une décision motivée. Comme nous le verrons ci-après, un lien avec l’institution d’enseignement n’est même pas nécessaire pour l’accès aux informations sur la base du principe de transparence.
Nous avons pu exposer dans d’autres contextes les règles de procédure s’appliquant aux recours universitaires (cf. Les recours universitaires) et nous nous focaliserons ici sur le droit d’accès.
Ce droit d’accès doit lui être divisé en deux catégories : celui relevant de la protection des données et celui relevant de la transparence. Pour la détermination du texte applicable, il faut encore déterminer si l’on a affaire à une autorité fédérale (écoles polytechniques fédérales, commissions fédérales d’examens – par exemple en médecine – diplômes relevant de la compétence du SEFRI, etc.) ou cantonale (écoles publiques, universités cantonales, certaines hautes écoles, commissions cantonales d’examens, par exemple pour l’accès au barreau ou au notariat, etc.).
Ainsi, une autorité fédérale est tenue par la Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) et par la Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans), tandis qu’une autorité cantonale applique le droit de son canton. Par exemple, on retrouve la dualité protection des données/transparence dans le canton de Vaud, avec la Loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD/VD) et la Loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo/VD), tandis que dans le canton de Genève, les deux aspects sont regroupés dans une unique loi, la Loi du 5 octobre 2001 sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD/GE).
Ces différentes lois forment le canevas d’analyse qui nous servira pour les trois questions que nous avons choisi de traiter :
- Puis-je accéder à ma propre copie ?
- Puis-je accéder aux documents d’examen et grilles d’évaluation (vides) ?
- Puis-je accéder à la copie d’un autre étudiant ?
L’accès à sa propre copie
L’étudiant sera au premier chef intéressé par consulter sa copie d’examen (respectivement le procès-verbal, par exemple pour un oral) et de consulter les éventuelles annotations qui y auront été portées par les examinateurs. Chaque enseignant à sa propre méthode : correction directement sur la copie, feuille de correction individuelle à part, tableau regroupant toutes les copies avec, par exemple, une ligne par question ou élément de réponse, et une colonne par étudiant.
La LPD adopte une approche large dans la définition des données personnelles : « toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable » (art. 5 let. a LPD). Les lois cantonales ont une approche similaire (cf. art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD/VD ; art. 4 let. a LIPAD/GE).
Une copie d’examen corrigée et les documents qui s’y rattachent, par exemple, une grille de correction complétée ou un procès-verbal, satisfont à cette définition, peu importe la méthode ou le support. En effet, on se trouve en présence d’une information ou d’un ensemble d’informations (le fait que l’étudiant était présent et inscrit à cet examen, les réponses apportées qui illustrent sa connaissance de la matière, l’évaluation qui en a été faite, les annotations de l’examinateur, etc.), qui se rapporte à une personne physique, l’étudiant.
Le fait qu’une copie a été anonymisée avant correction ne supprime pas la qualification de donnée personnelle. L’autorité doit nécessairement avoir un moyen de rattacher une copie d’examen à un étudiant en particulier (par un numéro attribué à l’étudiant par exemple), faute de quoi l’évaluation et la délivrance du diplôme n’auraient guère de sens. Au sens de la protection des données, on comprend qu’il s’agit d’une pseudonymisation et non d’une anonymisation.
Le traitement nous apparaît généralement licite : l’étudiant consent à ce que ses données soient traitées, en particulier en vue de la poursuite de ses études et de la délivrance du diplôme convoité. S’il devait révoquer son consentement, il n’en demeure pas moins que la loi fournit aux institutions d’enseignement une base légale pour le traitement de ces données, parfois implicitement – car le traitement est inséparable de la fonction de l’institution – et parfois explicitement, par exemple à l’art. 36b de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF).
Il s’ensuit que l’étudiant a le droit d’accéder à sa copie, comme il a le droit d’accéder à toute donnée le concernant (art. 25 al. 2 let. b LPD ; art. 25 al. 1 LPrD/VD ; art. 44 al. 2 LIPAD/GE). Cet accès sera en principe octroyé dans les 30 jours (art. 25 al. 7 LPD ; art. 26a LPrD/VD).
L’étudiant n’aurait en revanche pas accès à plus que ses données personnelles et celles relatives à leur traitement. Si les garanties de procédure permettent d’obtenir une décision d’évaluation motivée (avec un seuil minimum d’annotations, une explication détaillée par écrit ou une séance de correction individuelle ou collective), le droit d’accès ne contraint pas l’institution à s’expliquer ou à créer des documents justificatifs. Seul l’existant est remis, que cela satisfasse ou non l’étudiant.
Les restrictions au droit d’accès peuvent être rattachées à trois motifs principaux : la loi, l’intérêt prépondérant contraire (de droit public ou privé) et les efforts disproportionnés (art. 26 LPD ; art. 27 LPrD/VD ; art. 46 LIPAD/GE).
Concernant tout d’abord la loi, la LPD prévoit directement une restriction pour les données relevant d’une autre procédure, comme l’accès au dossier d’un procès civil ou d’une instruction pénale (art. 2 al. 3 LPD) ou lorsque « la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière. » (art. 26 al. 1 let. c LPD).
Nous n’avons pas connaissance de restrictions générales s’appliquant, par exemple, à toute une université ou école. L’art. 36b Loi sur les EPF précité ne prévoit typiquement pas une telle restriction d’accès. On trouve toutefois certaines restrictions dans des lois spéciales. Ainsi, l’art. 56 de la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd) prévoit ainsi que : « Afin de garantir la confidentialité des épreuves d’examen dans les professions médicales, la remise des dossiers d’examen peut être refusée, la production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte. ».
Nous comprenons que cette disposition vise à éviter que les questions d’examen soient copiées, reprises ou diffusées. Le risque étant alors que les étudiants se focalisent sur celles-ci, au détriment d’une approche plus holistique de la matière (ou de la profession visée, s’agissant d’examens professionnels). Elle ne nous convainc toutefois pas complètement, ce qui nous conduit au deuxième critère : celui de l’intérêt prépondérant.
Sans compter le risque de violations des garanties fondamentales de procédure, une restriction d’accès ne nous semble pas soutenable sur le plan pédagogique. En effet, un examen se doit de refléter la matière traitée et les objectifs d’apprentissage de l’enseignant.
Si l’enseignant « pioche » chaque année dans une base de données de questions, ces questions doivent couvrir l’entier du champ qu’il souhaite tester. Si les questions ne reflètent que partiellement la matière, elles doivent soit être étendues, soit le mode d’évaluation doit changer : les objectifs d’un QCM, d’un cas pratique et d’une dissertation sont très différents.
Nous proposons une expérience de pensée pour l’illustrer : supposons un cours et un examen portant uniquement sur l’art. 1er de la Constitution fédérale. Il existe une infinité d’objectifs pédagogiques possibles : vision historique et évolution de la Constitution, politique interne de la Suisse, simple liste des cantons qui constituent notre pays, etc.
Si l’enseignant établit vingt questions vrai/faux sur le modèle « cette entité appartient-elle à la Suisse ? » et liste dix cantons et dix régions limitrophes (« leurres »), il ne peut alors tester que le fait de se rappeler de ces éléments (premier niveau de la taxonomie pédagogique de Bloom), mais ne peut espérer que ses étudiants prennent la peine d’étudier l’histoire des premières alliances, des bailliages communs ou de l’indépendance jurassienne, ni la répartition des sièges à l’Assemblée fédérale ou le système de la double majorité. Il y a plus : si par tropisme latin les questions de la base de données ne portent jamais sur les cantons suisses allemands, il n’est pas nécessaire pour l’étudiant de les apprendre, car leur connaissance sera sans impact sur la réussite ou l’échec de l’examen.
On nous opposera sans doute que c’est une vision étriquée de l’enseignement, que le contrat pédagogique n’est pas bassement transactionnel et que le diplôme ne signifie pas uniquement que l’on a coché les bonnes cases au bon moment. Nous souscrivons à ces intentions sur le principe, mais sommes conscient que les études sont rarement une fin en soi et que l’étudiant cherche parfois autant l’efficacité que l’épanouissement.
Ainsi, il nous semble que restreindre l’accès d’un étudiant à ses données d’examen en l’absence d’une base légale expresse n’est admissible que dans des cas très particuliers. Nous y reviendrons dans notre deuxième partie, les lois relatives à la transparence fournissant des pistes intéressantes d’analyse à ce sujet.
Enfin, reste le cas des efforts disproportionnés. À nouveau, ce cas de figure nous semble d’application rare : les données d’examen sont généralement bien identifiées, car rattachées au parcours de formation de l’étudiant. Leur format est généralement assez compact (quelques pages d’examen, un procès-verbal). Les retrouver et les transmettre ne nécessite donc, en principe, pas d’effort particulier.
Si les données ont été effacées après un certain temps et n’ont pas été archivées selon les lois applicables, l’institution ne conservant, par exemple, que les notes elles-mêmes, mais non les copies d’examen, l’accès aux données devient impossible, et elles ne sont en tout état plus traitées en tant que telles (sous réserve de l’indication qu’elles ont bien été effacées ou détruites).
L’accès à la donnée et à la grille de correction
L’énoncé de l’examen et la grille de correction qui s’y rattache, cas échéant, est le deuxième cas de figure que nous voulons examiner.
Le droit d’accès sur la base de la transparence est à certains égards plus large que celui de la protection des données. Avec la protection des données, l’étudiant ne peut accéder qu’à sa propre copie, pour une matière et une session d’examens données. En revanche, au titre de la transparence, l’étudiant peut, en principe, demander tous les examens, dans toutes les branches. À vrai dire, la qualité d’étudiant est sans pertinence ici : « toute personne » est en droit d’accéder aux documents, qu’elle se trouve ou non dans un rapport particulier avec l’administration. Ainsi, un journaliste, un chercheur ou même un simple citoyen intéressé pourrait obtenir ces informations.
Les deux approches sont complémentaires, car l’étudiant ne pourrait pas demander des informations le concernant directement au titre de la transparence, car ce domaine est réservé à la protection des données (art. 3 al. 2 LTrans).
À nouveau, l’étudiant ne peut demander plus que ce qui existe : l’accès à d’anciennes données d’examen ou grilles de correction n’entraîne pas d’obligation pour l’institution ou l’enseignant de fournir des explications à leur sujet – il ne l’interdit pas non plus. Il est toutefois possible que ces informations soient contenues dans un autre document (syllabus, fiche de cours, objectifs d’apprentissage, etc.). L’étudiant qui obtient ces données doit également être conscient d’un risque : l’enseignant n’est pas lié par un mode d’évaluation et peut changer ses critères d’une année à l’autre (par exemple en passant du QCM au cas pratique, ou inversement), indépendamment d’une demande d’accès.
Il existe une série d’exceptions générales au principe de la transparence. Certaines ne trouveront que peu ou pas d’application en matière d’évaluation, comme l’atteinte à la sûreté ou aux intérêts de l’État (art. 7 al. 1 let c‑f LTrans ; art. 16 al. 2 let. a, b et d LInfo/VD ; art. 26 al. 2 let. a, b et l LIPAD/GE). On peut toutefois concevoir que cette exception soit invoquée pour des examens d’accès à des fonctions diplomatiques, militaires (formations de l’École d’état-major général, forces spéciales, etc.), de sécurité ou pour des postes élevés de l’administration.
Dans les études de droit, de médecine, de maïeutique (ou dans certains cas de théologie vu le secret de la confession), un examen qui incorporerait des éléments tirés de cas réels tomberait sous le coup de l’exclusion de la protection des secrets professionnels, respectivement de la garantie du secret si un tiers a consenti à ce que son cas soit étudié et utilisé comme examen (art. 7 al. 1 let. g et h LTrans ; art. 16 al. 3 let. a et c LInfo/VD ; art. 26 al. 2 let. h‑k LIPAD/GE). On peut également envisager que, dans d’autres formations, des secrets de fabrication ou d’affaires soient révélés aux étudiants et utilisés. Le cas nous paraît à nouveau peu fréquent.
Enfin, il est possible de refuser l’accès aux documents en cas d’atteinte notable à la « libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité » (art. 7 al. 1 let. a LTrans ; art. 16 al. 2 let. a LInfo/VD ; art. 26 al. 2 let. c LIPAD/GE) et si cela risque d’entraver l’autorité dans son action (art. 7 al. 1 let. b LTrans ; art. 16 al. 2 let. a LInfo/VD ; art. 26 al. 2 let. c‑f LIPAD/GE). Ces motifs nous semblent les plus fréquents.
Un étudiant ne pourrait typiquement pas obtenir l’accès à la donnée de l’examen avant de le passer, car cela influencerait notablement les résultats de l’examen et mettrait en péril les objectifs de l’institution, en particulier quant à la valeur des diplômes délivrés (quoiqu’il soit possible d’avoir des examens dont la donnée est connue à l’avance, mais les critères d’évaluation sont alors différents).
L’accès à l’énoncé nous semble également pouvoir être repoussé jusqu’à ce que les notes soient rendues, pour éviter toute interférence dans le processus d’évaluation. L’art. 8 al. 2 LTrans prévoit d’ailleurs une restriction d’accès tant que la décision administrative (dans notre cas, la note) n’est pas rendue. On devrait également exclure les échanges internes, par exemple, entre enseignants (cf. art. 9 al. 2 LInfo/VD ; art. 26 al. 3 LIPAD/GE). Le délai de prise de position et de communication sera en tout état généralement plus long que le temps à disposition des enseignants pour corriger les examens et rendre les notes.
Ces dispositions ne nous semblent toutefois pas être un blanc-seing pour que l’autorité puisse refuser de mettre à disposition d’anciennes données d’examen ou les grilles de correction. Au contraire, l’autorité devrait démontrer en quoi garder le secret sur les anciens examens est nécessaire à son bon fonctionnement. Comme nous l’exposions dans notre première partie, nous ne voyons guère de vertu pédagogique à dissimuler les modalités et anciennes questions d’examen. Au contraire, si l’étudiant sait à quoi s’attendre lors de l’évaluation, il ne pourra que mieux se préparer et exposer les connaissances acquises, sans que des critères implicites ne viennent interférer.
Il nous semble qu’une exception pourrait se concevoir si l’accès aux questions vidait de son sens la passation de l’examen, par exemple, car les questions sont trop peu nombreuses par rapport au champ de la matière et que l’examen doit nécessairement être standardisé, par exemple, car il est passé par de nombreuses personnes et/ou car il s’agit du seul moyen de garantir l’égalité de traitement entre les candidats. En revanche, si la base de questions est suffisamment étendue ou qu’il est possible de l’étendre sans effort disproportionné, il n’y a, à notre sens, pas lieu de conserver les informations secrètes.
Un dernier cas d’exclusion reste possible : une disposition d’une loi spéciale pourrait supprimer ou restreindre l’accès à certains documents ou catégories de documents de façon plus large que les motifs ci-dessus. Cette possibilité est toutefois l’apanage du législateur plus que de l’institution.
L’accès à la copie d’un tiers
Dernier aspect que nous voulons traiter, l’étudiant pourrait avoir le souhait d’accéder à la copie d’un de ses camarades de classe. Les raisons sont multiples : comparaison avec sa propre copie pour comprendre ses erreurs ou pour chercher des arguments pour un éventuel recours, envie de comprendre ce qui constitue une « bonne copie » (respectivement une « mauvaise copie ») aux yeux de l’examinateur ou simple curiosité.
Ce troisième cas de figure met en lumière la relation entre les deux pôles du droit d’accès et la tension entre les données personnelles et la transparence dans l’administration.
On peut d’emblée exclure l’accès sur la base de la protection des données : l’étudiant ne demande pas ici l’accès à ses propres données, mais à celles d’un tiers. Reste donc uniquement la voie de la transparence.
La protection des données viendrait toutefois s’opposer au droit d’accès sous l’angle de la transparence. L’autre étudiant pourrait certes consentir à la transmission, mais il pourrait ne pas souhaiter que sa copie soit accessible.
La pesée des intérêts qui s’ensuit devrait en général favoriser le secret. L’étudiant a un intérêt propre relativement limité à l’obtention de la copie d’un tiers. Il ne peut, en particulier, pas se prévaloir d’une violation de l’égalité de traitement pour remettre en cause la note qu’il aurait obtenue (ce grief n’a pas de portée propre par rapport à l’interdiction de l’arbitraire dans la copie : soit une copie est corrigée correctement, soit elle ne l’est pas).
De façon générale, il est difficile pour un individu de démontrer un intérêt prépondérant à consulter une copie donnée : la plupart des informations utiles à la formation de l’opinion et au contrôle de l’administration se trouvent dans les données et grilles de correction. On peut envisager certaines hypothèses où un étudiant ou un groupe d’étudiants serait favorisé ou défavorisé dans le cadre de certains examens, mais cela nécessitera de la part du demandeur un effort d’argumentation.
Le refus n’est toutefois pas la seule option : une transmission des copies dont les informations personnelles auront été caviardées nous semble possible sans effort démesuré – il serait toutefois difficile de cibler la copie d’un étudiant déterminé.
Conclusion
Les écoles, hautes écoles, universités, commissions d’examens ou autres lieux de savoir ne doivent pas être des lieux de secret. Comme démontré ci-dessus, les étudiants – et les tiers – peuvent avoir accès à une série d’informations concernant l’évaluation des examens. Des garde-fous existent toutefois en présence d’intérêts légitimes de l’institution ou de tiers, mais ne devraient pas empêcher un accès large aux données visées.
Cette vision n’est pas seulement juridique, la protection des données et la transparence n’étant pas des fins en elles-mêmes. À notre sens, l’enseignement gagne toujours à être clair sur les modalités d’évaluation. Les étudiants informés peuvent se focaliser sur les objectifs d’apprentissage et la matière qu’ils doivent maîtriser, et savent comment retranscrire au mieux leurs connaissances, sans que des biais implicites d’évaluation viennent brouiller le résultat. La transparence est ainsi un gage de bonne pédagogie.
Proposition de citation : Grégoire Geissbühler, L’accès aux données d’examen, 4 octobre 2023 in www.swissprivacy.law/255

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.