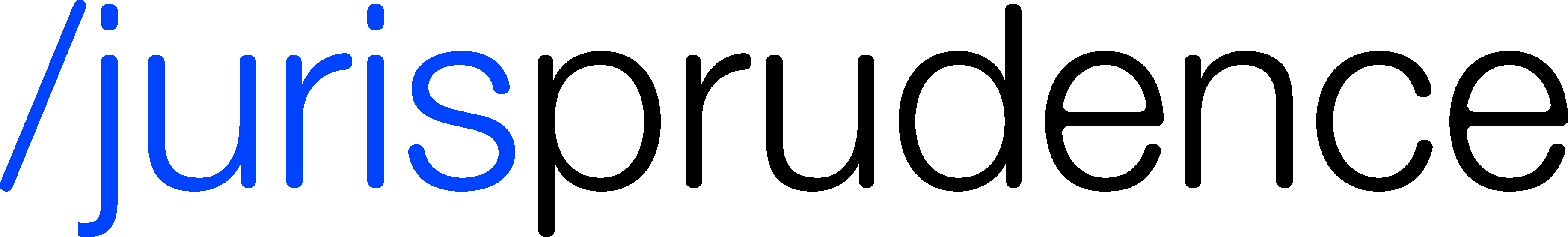La caméra de surveillance a‑t-elle pris une décision individuelle automatisée ?

Introduction
Les propriétaires d’une maison installent une caméra de surveillance qui détecte tout mouvement devant leur domicile et les en informe par courriel.
En décembre 2021, ils ne reçoivent plus de notification, mais le problème est rapidement résolu par le fournisseur. Deux mois plus tard, de nouveaux dysfonctionnements se produisent. L’époux apprend alors que l’algorithme a automatiquement suspendu les notifications pour des motifs sécuritaires. En effet, l’algorithme a détecté qu’un nombre anormalement élevé de courriels a été envoyé et soupçonne donc un usage abusif du compte des propriétaires. Cette mesure dure jusqu’à fin février 2022.
Considérant que la suspension constitue une décision individuelle automatisée (DIA ; art. 22 RGPD), l’époux introduit une réclamation (art. 77 RGPD) sur laquelle le Tribunal administratif fédéral autrichien (TAF/AT) a été amené à se prononcer.
La DIA européenne
Aux termes de l’art. 22 par. 1 RGPD, la DIA est une « une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. ». L’existence d’une DIA suppose le respect de trois conditions cumulatives :
- L’existence d’une décision ;
- Le caractère exclusivement automatisé de la prise de décision ; et
- Les effets significatifs de la décision sur la personne concernée.
De la volonté du législateur européen, la personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé (considérant 71 du RGPD). Les DIA font donc l’objet d’une interdiction de principe (art. 22 par. 1 RGPD). Elles ne peuvent être prises que (i) si elles sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement, (ii) si elles sont prévues par le droit de l’Union européenne ou par le droit d’un État membre ou encore (iii) si la personne concernée y a explicitement consenti (art. 22 par. 2 RGPD).
Dans le cas d’espèce, l’époux allègue en substance que la suspension automatique des notifications par l’algorithme du fournisseur constitue une DIA. Or, dans la mesure où aucune des exceptions de l’art. 22 par. 2 RGPD n’est réalisée, la DIA serait illicite.
Ce raisonnement ne convainc pas le TAF/AT. S’épargnant en particulier l’épineuse question de savoir si la suspension des notifications constitue une décision (pour une interprétation de la notion de décision par la CJUE, cf. Michael Montavon, La CJUE serre la vis au traitement des données par les sociétés de fourniture de renseignements commerciaux , 18 décembre 2023 in www.swissprivacy.law/274), il analyse directement la troisième condition et conclut à l’absence d’effets significatifs sur la personne concernée. En effet, la suspension temporaire des notifications a certes été décidée par un algorithme, mais la gravité de ses effets n’est pas comparable à celle de l’annulation d’un contrat, du refus de prestations sociales ou du refus d’un crédit (cf. Groupe de travail Article 29, Lignes directrices relatives à la prise de décision individuelle automatisée et au profilage aux fins du règlement (UE) 2016/679, p. 23 s.). L’argumentaire de l’époux, selon lequel la perte de sécurité résultant de l’absence de notification l’affecte de manière significative, tombe donc à faux.
Par ailleurs, le TAF/AT relève qu’en tout état de cause, l’art. 22 par. 2 let. a RGPD aurait trouvé application. En effet, en vertu du contrat liant l’époux et le fournisseur, ce dernier doit garantir la stabilité, la sécurité du réseau et la protection des données de l’époux. La suspension temporaire des notifications est nécessaire à l’exécution de cette obligation contractuelle et il n’y a pas d’alternative. En particulier, au vu du nombre important de clients, il ne peut être exigé de procéder à une analyse au cas par cas.
Partant, l’art. 22 RGPD ne trouve pas application et la réclamation de l’époux est écartée.
Les enseignements de l’arrêt
Cet arrêt du TAF/AT comporte plusieurs enseignements. En premier lieu, il met en exergue qu’un traitement effectué au moyen d’un algorithme n’est pas nécessairement une DIA. Encore faut-il que la décision déploie « des effets juridiques » ou affecte la personne concernée « de manière significative de façon similaire ». Par ailleurs, contrairement à ce que l’art. 22 par. 1 RGPD laisse suggérer, tant les effets juridiques que les autres effets similaires doivent avoir une incidence grave pour être couverts par l’art. 22 RGPD (cf. Groupe de travail Article 29, Lignes directrices relatives à la prise de décision individuelle automatisée et au profilage aux fins du règlement (UE) 2016/679, p. 23 s.).
En second lieu, l’arrêt démontre que l’application de l’art. 22 par. 2 let. a RGPD suppose une analyse approfondie. En plus d’identifier les clauses contractuelles pertinentes, le responsable du traitement doit prouver la nécessité de la DIA en expliquant qu’il n’y a pas d’autre méthode moins intrusive pour atteindre le même but.
Que faut-il en tirer pour la DIA suisse ?
« [T]oute décision qui est prise exclusivement sur la base d’un traitement de données personnelles automatisé et qui a des effets juridiques pour elle ou l’affecte de manière significative » est une DIA au sens de l’art. 21 al. 1 LPD. À l’instar du droit européen, l’art. 21 al. 1 LPD pourrait laisser croire que les effets juridiques ne doivent pas nécessairement avoir une grave incidence sur la personne concernée. Toutefois, le législateur suisse s’étant inspiré de la définition européenne (Message concernant la LPD, FF 2017 6565, p. 6619 s. et 6673 s.), nous estimons que la DIA suisse suppose nécessairement des effets significatifs (cf. ég. Célian Hirsch/Nastassia Yasmina Merlino, Do Robots Rule Wealth Management ? A Brief Legal Analysis of Robo-Advisors, in : Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht, 2022, vol. 94, n° 1, p. 33 ss, p. 43).
Malgré une définition similaire de la DIA, le législateur suisse a prévu un régime différent. En effet, il n’a pas opté pour une interdiction de principe, mais mise plutôt sur le devoir d’information. Ainsi, le responsable du traitement doit informer la personne concernée de l’existence d’une DIA (art. 21 al. 1 LPD), sauf si :
- la DIA est directement liée à la conclusion ou l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée et donne satisfaction à cette dernière (21 al. 3 let. a LPD) ; ou
- la personne concernée a expressément consenti à la DIA (21 al. 3 let. b LPD).
Par conséquent, le raisonnement du TAF/AT ne peut pas être transposé tel quel en droit suisse. Il n’en demeure pas moins qu’il fournit des enseignements intéressants pour l’art. 21 al. 3 let. a LPD. Pour s’en prévaloir, le responsable du traitement doit identifier la clause contractuelle topique et expliquer en quoi la DIA est liée à cette obligation contractuelle.
Toutefois, pour être libéré de son devoir d’informer, le responsable du traitement doit en plus démontrer qu’il a fait droit à la demande de la personne concernée.
Proposition de citation : Nathan Philémon Matantu, La caméra de surveillance a‑t-elle pris une décision individuelle automatisée ?, 12 mars 2024 in www.swissprivacy.law/286

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.