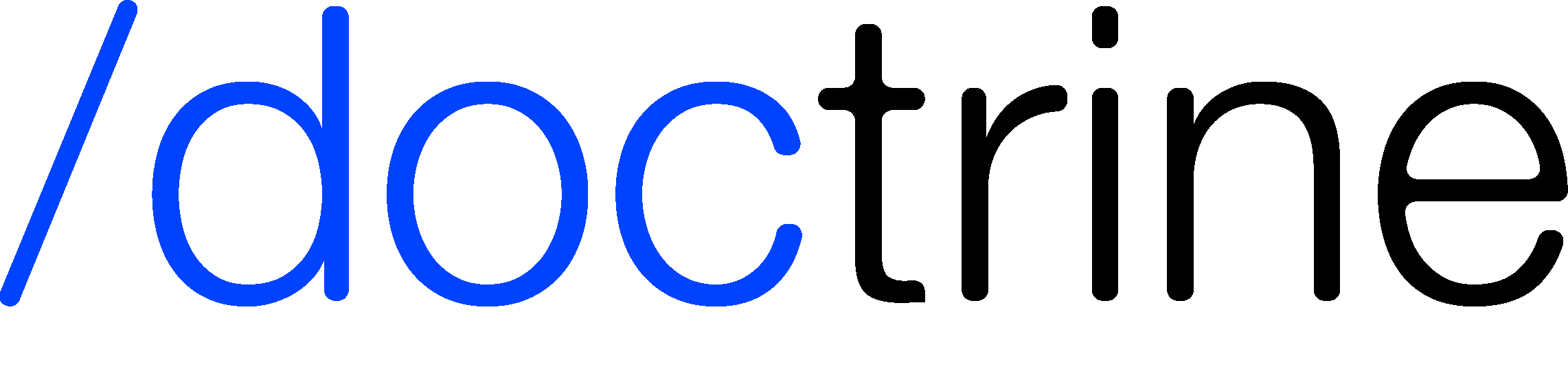32e Rapport d’activités du PFPDT – Partie transparence

32e Rapport d’activités 2024/2025, publié le 1er juillet 2025
Publié le 1er juillet 2025, le rapport présente l’activité du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) sur la période d’avril 2024 à mars 2025. La présente contribution traite de la partie transparence du rapport, la partie relative à la protection des données ayant déjà fait l’objet d’une contribution distincte (cf. https://swissprivacy.law/368/). L’année sous revue fait état d’une augmentation notable des demandes d’accès et en médiation, entraînant un retard dans une proportion significative des dossiers.
Des demandes d’accès
Le besoin des médias et de la société en informations spécifiques et quant à la transparence de l’administration est toujours aussi fort et a même généré un nouveau pic de demandes. En effet, les demandes d’accès ont connu une augmentation de près de 30% durant la période sous revue (2’186 demandes) par rapport à l’année précédente (1’701 demandes).
Sur la base des statistiques établies par le PFPDT, nous constatons une nette proportion d’octroi d’accès (73%). Effectivement, plus d’une demande d’accès sur deux (52%) conduisent à l’octroi d’un accès intégral et un peu moins d’un quart (21%) conduisent à l’octroi d’un accès partiel ou différé, contre seulement moins d’un dixième (8%) des demandes conduisent à un refus. Par conséquent, le présent rapport du PFPDT porte confirmation du pourcentage élevé de cas dans lesquels l’accès est entièrement accordé.
En outre, la LTrans prévoit le principe de la gratuité de l’accès aux documents officiels (art. 17). Ce principe souffre d’une exception lorsque la demande d’accès nécessite un surcroît important de la part de l’autorité saisie, laquelle peut percevoir un émolument (art. 17 al. 2 LTrans). Il ressort de ce rapport que ce principe est respecté, des émoluments n’ont été perçus que dans 0,3% des cas traités.
Du point de vue des autorités saisies de demandes d’accès, – quand bien même elles ne sont pas tenues de consigner le temps consacré au traitement des demandes – le temps qu’elles y consacrent a connu une augmentation fulgurante. En effet, le travail en découlant a augmenté de 26%, étant précisé que – de l’avis même du PFPDT – le temps de travail déclaré par ces autorités ne correspond que partiellement au temps réellement investi pour le traitement des demandes d’accès.
Des procédures de médiation
Durant la période sous revue, les demandes en médiation ont connu une augmentation encore plus importante, soit de 53% par rapport à l’année précédente pour un total de 202 demandes enregistrées. Il importe de souligner que les plus friands de cette procédure sont les particuliers et les journalistes, lesquels représentent près des deux tiers des demandes en médiation.
Outre cette statistique, il est opportun de relever que les procédures de médiations orales sur places ont également produit des résultats probants avec plus des trois quarts des séances (76%) aboutissant à une solution amiable. Selon le PFPDT, le recours à des solutions amiables présente de multiples avantages, au nombre desquels figurent la clarification de la situation juridique, l’accélération de la procédure d’accès aux documents, ainsi que la facilitation d’éventuelles collaborations futures entre les parties concernées.
En dépit des augmentations susmentionnées qui engendrent une charge de travail plus importante, les effectifs du PFPDT affectés aux questions relatives à la LTrans restent inchangés (6,2 employés en équivalent temps plein). Face à des demandes d’accès particulièrement volumineuses, un nombre important de tiers impliqués dans la procédure ou en raison de la complexité juridique des questions soulevées, cela a pour conséquence d’engendrer un retard dans le traitement des cas. En effet, dans plus de trois quarts des procédures (72%), le PFPDT ne parvient pas à agir dans le délai légal de 30 jours.
« Dans 95% des cas, la séance de médiation a dû être programmée de telle sorte que le délai soit déjà expiré au moment de la séance, en raison des ressources en personnel disponibles et du retard accumulé dans le traitement des dossiers » (Rapport, p. 74).
À ce titre, il convient de rappeler que le PFPDT peut se prévaloir de l’art. 12a al. 2 OTrans afin de prolonger le délai réglementaire de manière appropriée. Or, pour ce faire, la demande en médiation doit requérir un surcroît important de travail (art. 12a al. 1 OTrans), soit en raison du nombre important de documents sur lesquels elle porte ou de leur complexité (let. a), soit des questions juridiques, techniques ou politiques particulièrement ardues qu’elle pose (let. b). De l’aveu même du PFPDT, les nouveaux dépassements du délai de 30 jours qui sont exclusivement imputables à l’augmentation significative du nombre de demandes, constituent, sur le plan juridique, des retards injustifiés.
Du rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats et ses recommandations
Dans son rapport sur les courriels introuvables au Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur, la Commission de gestion du Conseil des Etats relève une absence d’harmonisation des prescriptions relatives au classement et à l’archivage au sein de l’administration fédérale qui requiert une clarification en la matière ainsi qu’un renforcement du droit du PFPDT de consulter les documents officiels. Ce rapport renferme trois recommandations présentant un lien direct avec la LTrans, à savoir de procéder à (i.) l’examen de l’opportunité d’une modification des dispositions légales relatives au droit de consultation des documents présentant un lien à la fois avec l’exercice de la fonction et la sphère privée, (ii.) l’analyse de l’applicabilité de la LTrans aux procédures pénales définitivement closes, et (iii.) l’évaluation de l’opportunité d’une révision de cette dernière en vue de conférer au PFPDT un droit d’intervention, voire de décision, en cas de refus d’accès aux documents le concernant.
Concernant la première des recommandations susmentionnées, le Conseil fédéral retient qu’il convient d’examiner, au cas par cas, si un droit d’accès peut être invoqué en vertu de la LTrans ou s’il s’agit d’un droit de consultation fondé sur la loi fédérale sur l’archivage (LAr). Aucune nécessité de modification législative n’a, en l’état, été identifiée.
En ce qui concerne la seconde des recommandations susmentionnées, le PFPDT considère que le Tribunal fédéral a définitivement scellé la problématique relative à l’accès aux actes de procédure – indépendamment du fait que la procédure soit pendante ou définitivement classée – en concluant que seuls les actes de procédure au sens strict échappent à la LTrans.
Finalement, le Conseil fédéral retient que, concernant la dernière desdites recommandations, la médiation conduite par le PFPDT est une procédure informelle dans laquelle ce dernier n’a aucune compétence décisionnelle, procédure qui ne crée pas de précédent et ne donne lieu à aucun procès-verbal.
De la limitation du principe de la transparence pour les lanceurs d’alerte
Le droit du personnel de la Confédération fait actuellement l’objet de plusieurs remaniements, notamment en ce qui concerne le traitement des signalements effectués par des lanceurs d’alerte.
En effet, l’art. 22a al. 7 du projet de modification de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) vise à exclure du champ d’application de la LTrans les « pièces documentant un signalement au sens de la présente disposition, jointes à un signalement ou établies sur la base d’un signalement ». Une telle exclusion résulte, selon l’Office fédéral du personnel, responsable de ce projet, de la nécessité de préserver, sur le long terme, la confiance dans le mécanisme d’alerte ainsi que de garantir la protection des personnes visées par des signalements alléguant un comportement illicite. Cependant, le PFPDT retient que rien ne justifie la dérogation prévue au principe de la transparence, notamment du fait que les intérêts privés légitimes resteraient protégés même si la LTrans trouvait application et qu’une telle exclusion est contraire au principe de proportionnalité (art. 5 Cst. féd.).
Aviation et surveillance financière
En matière d’aviation et plus généralement de transport, deux modifications futures ou à venir font l’objet de vives critiques du PFPDT.
Tout d’abord, il s’agit de la limitation du principe de la transparence quant à la surveillance de l’aviation civile figurant dans le projet mis en consultation de la loi fédérale sur l’aviation (LA). Le PFPDT fonde son opposition à cette limitation et balaie les arguments prônés par l’Office fédéral de l’aviation civile, lequel est en charge de l’élaboration dudit projet, au motif que la LTrans offre des garanties suffisantes en matière de protection des informations sensibles, y compris dans le contexte des activités de surveillance et des enquêtes de sécurité, et qu’aucun motif légitime ne saurait justifier une exclusion totale du principe de transparence au sein de l’administration, ni, partant, le maintien inconditionnel du secret sur des éléments essentiels des activités de surveillance.
Ensuite, le PFPDT regrette la position du Conseil fédéral visant à soustraire le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) au champ d’application de la LTrans (art. 2 al. 3) dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (OEIT). Une telle exclusion est motivée du fait que l’obtention des informations nécessaires au maintien de la sécurité des transports par le SESE est subordonnée à l’assurance, pour les informateurs, que leurs renseignements ne seront pas rendus publics. Selon le PFPDT, le problème central réside dans le fait que l’administration s’exclut elle-même du principe de la transparence et anticipe de facto une décision du législateur en attente dans le cadre de la révision de la LA.
La création du registre central permettant d’identifier les ayants droit économiques effectifs des personnes morales constitue le leitmotiv du projet de loi sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droits économiques (P‑LTPM). Ce projet – qui a pour but de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la criminalité économique – prévoit une exclusion expresse du champ d’application de la LTrans (cf. art. 53 al. 4 P‑LTPM). Le Secrétariat d’État aux questions financières internationales, l’autorité compétente, soutient qu’un élargissement de l’accès au registre central n’apporterait aucune valeur ajoutée significative, tout en portant une atteinte disproportionnée aux droits liés à la protection de la personnalité. À cet argument, le PFPDT oppose le principe selon lequel les banques de données et registres utilisés par les autorités dans le cadre de l’accomplissement de tâches publiques relèvent, en principe, du droit d’accès garanti par la LTrans et que, de ce fait, et en l’absence de justification, une réglementation distincte pour le registre central de transparence est contraire au principe de la transparence.
Conclusion
L’année sous revue confirme l’intérêt croissant de la société civile pour la transparence et les divers leviers qu’elle offre. La croissance ininterrompue des demandes d’accès et de médiation indique qu’une prise de conscience de l’utilité de la transparence s’opère. Ce phénomène devrait vraisemblablement continuer à prendre de l’ampleur notamment en raison du potentiel recours à de tels outils par les praticiens du droit. Cette dynamique permettra de poursuivre les buts poursuivis par la LTrans, notamment l’amélioration de la compréhension de l’action administrative et, de ce fait, son acceptation.
Toutefois, il convient de remarquer que ce rapport fait état d’une augmentation des dispositions spéciales au sens de l’art. 4 LTrans avec deux nouvelles entrées (projets LPers et LTPM). Bien que cela puisse paraitre anodin, gardons à l’esprit que lesdites entrées portent le nombre d’actes à 13 et représente une augmentation d’environ 16% des actes (entrés en vigueur ou l’étant dans un future proche) réservant l’application de la LTrans (cf. Rapport pp. 84–85). Afin d’apporter davantage de clairvoyance quant à la coordination entre la LTrans et les dispositions spéciales d’autres lois fédérales prévoyant des règles particulières d’accès aux documents officiels, le PFPDT recense les actes concernés sur sa page internet.
En outre, ce rapport met en exergue l’efficacité de la médiation. La prépondérance des accords (92) par rapports aux recommandations (31) en fait état. Une explication possible à ce phénomène réside dans le fait que les particuliers et les journalistes, catégories de la société civile représentant près des deux tiers des demandes en médiation, ne sont pas nécessairement encore aguerris en matière de transparence. Cela peut conduire à ce qu’une simple explication de la part du PFPDT permette de clarifier la situation et déboucher sur la résolution du cas.
Nonobstant ces statistiques réjouissantes quant à l’appropriation progressive de la transparence, l’absence de renforcement des effectifs du PFPDT peut inquiéter et il conviendra d’être attentif – lors de la publication de son 33ème rapport – au retard accumulé dans le traitement des dossiers.
Proposition de citation : Nathanaël Pascal, 32e Rapport d’activités du PFPDT – Partie transparence, 26 août 2025 in www.swissprivacy.law/369

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.