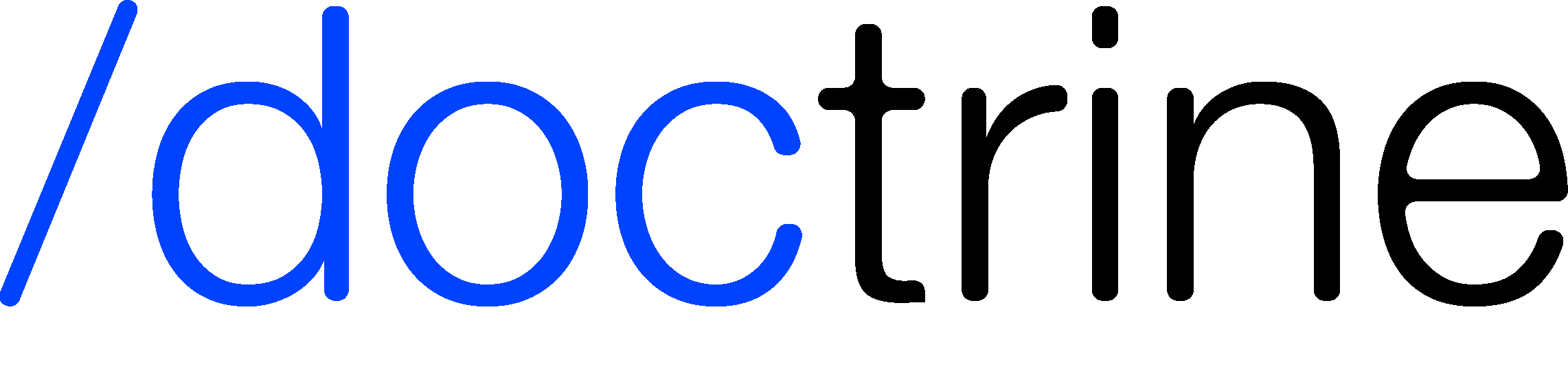Décisions judiciaires cantonales et fédérales : Quelle durée de conservation ?

Introduction
Les décisions rendues par les Tribunaux suisses peuvent être des données sensibles au sens de l’art. 5 let. c ch. 5 LPD (art. 5 let. c ch. 5 LPD).
Les poursuites ou sanctions pénales concernent la justice pénale ordinaire, la justice des mineurs et la justice militaire, mais également l’exécution des peines. Selon la doctrine, la donnée sensible porterait exclusivement sur la personne poursuivie et non une autre personne intervenue dans le cadre de la procédure (témoin, avocat, procureur, PADR, victime, partie plaignante).
Quant aux poursuites et sanctions administratives, ce sont, par exemple, celles en matière fiscale, douanière, de droit des étrangers, de circulation routière, ainsi les procédures disciplinaires. En revanche, les données qui concerne la poursuite en matière d’exécution forcée, au sens de la LP, ne font pas partie de cette catégorie.
Partant, les décisions judiciaires contiennent à l’évidence des données personnelles (p.ex. noms des parties si ce sont des personnes physiques, des avocats, du greffier, des juges, des témoins, de tiers), mais toutes les décisions judiciaires ne sont pas ipso iure sensibles au sens de l’art. 5 let. c ch. 5 LPD.
En vertu du principe de proportionnalité (art. 6 al. 2 et 4 LPD), les données ne peuvent être conservées (et donc traitées) plus longtemps que nécessaire (proportionnalité temporelle). L’idée est que le traitement doit répondre à un besoin effectif et non pas à un besoin hypothétique (« auf Vorat »). La durée de rétention (ou, au moins, la définition des critères pour la déterminer) peut être déterminée par une loi spéciale, un contrat, la jurisprudence, des recommandations du PFPDT, des codes de conduite, ou par le responsable de traitement, etc.
Le présent article a pour but de faire un tour d’horizon des durées de conservation prévues dans certains cantons suisses (VD, BE, FR, ZH, GE) et au niveau fédéral en ce qui concerne les décisions rendues par les autorités judiciaires.
Vaud
L’art. 64 al. 2 de la Loi d’organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01) dispose que le Tribunal cantonal règlemente la conservation des archives judiciaires. Cependant, il ne semble pas avoir fait usage de cette compétence à ce jour.
À titre plus général, l’ordre judiciaire vaudois et son administration sont soumis à la Loi sur l’archivage (LArch ; RSV 432.11) et son Règlement d’application de la loi sur l’archivage (RLArch ; RSV 432.11.1). L’art. 5 al. 1 RLArch prévoit que chaque autorité rédige un calendrier de conservation en collaboration avec les Archives cantonales. Les documents sont proposés aux Archives cantonales au terme du délai de conservation mentionné dans le calendrier de conservation (art. 6 al. 1 RLArch).
Via la page des Archives parapubliques de l’Etat de Vaud, on retrouve un document compilant les différents calendriers de conservation (lien). Il en ressort que la durée de conservation des décisions judiciaires, sans distinction entre les tribunaux, est de 30 ans (p. 33). Bien qu’il semble être la référence utilisée, il n’a pas avoir été actualisé depuis son établissement en 2006. Il serait ainsi prudent de vérifier, lors de son utilisation, si son contenu est toujours conforme aux dispositions légales en vigueur.
Berne
Le Règlement sur la gestion des archives des tribunaux civils et pénaux de première et d’instance supérieure du canton de Berne (RArch JCP ; RSB 162.16) règle la conservation et le versement des documents de la Cour suprême, du Tribunal cantonal des mesures de contrainte dans la mesure où des affaires pénales sont concernées, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs, des tribunaux régionaux, des tribunaux régionaux des mesures de contrainte ainsi que des autorités régionales de conciliation. L’art. 8 RArch JCP prévoit que l’archivage des dossiers en matière civile et pénale a lieu une fois la procédure close. Une procédure est close lorsqu’elle a acquis force de chose jugée formelle.
Aux termes de l’art. 11 RArch JCP, les dossiers de procédure de la Cour suprême sont conservés pendant 10 ans à partir de l’entrée en force de chose jugée puis versés aux Archives de l’État en vue d’une conservation durable.
S’agissant des tribunaux de première instance, les art. 12 et 13 RArch JCP arrêtent des durées de conservation variables en fonction de la nature de l’affaire, la procédure applicable et la possibilité ou non de faire appel. Par exemple, en matière civile, 5 ou 10 ans en procédure de conciliation, 10 ans en procédure simplifiée non susceptible d’appel et jusqu’à 50 ans pour les affaires en droit de la famille ; en matière pénale, 30 ans pour les dossiers devant un juge unique, 50 ans pour les dossiers devant un tribunal collégial.
Au terme de la durée de conservation, les documents sont proposés aux archives cantonales selon leur valeur archivistique (art. 15 RArch JCP) (cf. www.swissprivacy.law/205 pour une analyse de la problématique de conciliation de l’archivage et du principe de proportionnalité).
En matière administrative, le Règlement sur la gestion des archives du Tribunal administratif et des autorités judiciaires indépendantes de l’administration (RArch TA ; RSB 162.628) fixe quant à lui un délai de conservation uniforme de 10 ans dès l’entrée en force de chose jugée formelle (art. 13 al. 1RArch TA). Après l’écoulement du délai de dix ans, les dossiers sont proposés aux Archives de l’État pour être archivés durablement (art. 13 al. 2 RArch TA).
Zurich
L’Ordonnance sur l’archivage des actes de procédure devant le Tribunal cantonal (Verordnung der obersten kantonalen Gerichte über die Archivierung von Verfahrensakten, RS ZH 211.16) prescrit à son art. 21 al. 1 que les actes de procédure sont en général consultables 15 ans après la clôture de la procédure. Ce délai s’élève à 20 ans pour les procédures de divorce ou les actes de défauts de biens (al. 2). En matière pénale, l’Ordonnance renvoie à l’art. 103 CPP, en vertu duquel les dossiers sont conservés au moins jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine. Enfin, le registre des jugements et les dossiers successoraux du juge unique sont conservés pendant 50 ans (al. 3).
Genève
Le Règlement du pouvoir judiciaire sur l’accès aux documents et aux données personnelles (RADPJ ; RS GE E 2 05.52) dispose que « les délais de conservation correspondent à la durée fixée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire, le cas échéant après consultation de l’archiviste du pouvoir judiciaire, des juridictions et des services, pendant laquelle les dossiers doivent être conservés dans leur intégralité, pour des raisons administratives ou légales, avant versement aux Archives d’État ou destruction » (art. 2 RADPJ). Ils courent dès l’archivage, étant précisé qu’un dossier judiciaire est considéré archivé dès que la décision mettant fin à la procédure est définitive selon l’art. 2 RADPJ. Il s’agit d’un calendrier de conservation, qui ne semble toutefois pas publié.
Fribourg
La question est réglée par les Directives du Tribunal cantonal sur le préarchivage des dossiers judiciaires et leur versement aux Archives (RSF 130.421), adoptées sur la base de l’art. 140 al. 1er let. c de la Loi sur la justice (RSF 130.1). Après la liquidation définitive d’une affaire, les dossiers sont inscrits dans une liste de préarchivage selon leur date d’inscription au rôle, la date de liquidation de l’affaire, le nom des parties et la matière traitée (art. 4 Directives).
La durée du préarchivage est réglée à l’art. 6 al. 1 des Directives, qui prévoit ce qui suit : les dossiers pénaux sont conservés 30 ans en matière de crimes et délits (let. a), respectivement 15 ans pour les contraventions (let. b). Deux exceptions sont prévues à ce principe : la première est que tous les dossiers de la juridiction pénale des mineurs sont conservés durant 15 ans (let. c, ch. 1) ; la seconde est qu’en matière de contraventions et de conciliations qui ont abouti, les dossiers des préfets sont conservés pendant dix ans (let. c ch. 2).
S’agissant des dossiers civils, le principe est de les conserver durant 30 ans (art. 6 al. 2 Directives), mais cette durée est réduite à 15 ans pour les dossiers en matière de prud’hommes et de baux à loyer (let. a). Elle est réduite à 5 ans pour les dossiers liquidés par procédure sommaire, en conciliation, par des retraits d’action, par des transactions (let. b).
Tous les dix ans, respectivement 5 ans pour la juridiction pénale des mineurs et des préfets, l’autorité de préarchivage s’adresse au Tribunal cantonal fribourgeois, qui décide du dessaisissement des dossiers arrivés au terme de leur durée de préarchivage (art. 7 Directives). Le Tribunal cantonal requiert l’intervention des Archives de l’État qui, avec la collaboration de l’autorité de préarchivage, décide de l’archivage ou de la destruction des dossiers (art. 7 al. 3 Directives). L’art. 8 des Directives énumère non exhaustivement – laissant ainsi une certaine marge de manœuvre – les cas dans lesquels un versement aux Archives de l’État se justifie en raison d’une valeur permanente ou historique.
Valais
Tous les documents judiciaires qui ont une valeur archivistique sont conservés durablement en vertu de l’art. 2 du Règlement sur l’archivage des dossiers judiciaires (RS VS 173.102). Tous les actes et procédures qui ne sont pas renvoyés aux parties (les mémoires de parties, les preuves recueillies en cours d’instruction, les ordonnances et décisions de procédure, l’arrêt) sont conservés durablement (art. 6 al. 1 Règlement). Passé un délai de protection 50 ans, les tribunaux ont la possibilité de verser les archives judiciaires aux archives cantonales (art. 9 Règlement). Le principe est que les archives judiciaires peuvent ensuite être consultées librement et gratuitement par le public, mais le délai de protection est toutefois prolongeable en cas d’intérêt prépondérant (art. 10 du Règlement). Ces dispositions laissent penser que la rétention dure au moins 50 ans, sans toutefois qu’une durée maximale ne soit fixée dans ce même Règlement, sous réserve de l’art. 6 al. 2, qui prévoit que les dossiers d’instruction pénale clos par une ordonnance pénale sont détruits après trente ans. Ceci ne représente toutefois qu’un faible pourcentage des décisions judiciaires rendues.
Au niveau fédéral
La Loi fédérale sur l’archivage (LAr ; RS 152.1) donne au Tribunal fédéral la compétence de régler l’archivage de ses documents conformément aux principes de la loi (art. 1 al. 3). L’Ordonnance du Tribunal fédéral portant application de la loi fédérale sur l’archivage (RS 152.21) prévoit que lorsqu’il statue comme autorité de recours, sont conservés « durablement » une liste exhaustive de documents, dont les mémoires des parties, l’arrêt attaqué, la correspondance, les ordonnances et décisions et l’arrêt (art. 3 al. 1 Ordonnance). Les pièces non énumérées dans cette liste sont en principe retournées à leur expéditeur après la clôture de la procédure (art. 3 al. 2 et 3 Ordonnance). Il n’y a pas de durée maximale de conservation, mais des délais de protection de 30 ou 50 ans conformément à la LAr (art. 6 de l’Ordonnance renvoyant aux art. 9 et 11 LAr), ce qui tend à démontrer que la durée de rétention ne serait pas inférieure.
Quant au Tribunal administratif fédéral, l’accès aux archives par des tiers est protégé par un délai de protection d’une durée de 30 ans, à l’exception des actes de procédures qui sont soumis à un délai de 50 ans (art. 6 al. 1 et 2 du Règlement sur l’archivage au Tribunal administratif fédéral ; RS 152.13). À l’expiration de ce délai de protection, toute personne peut avoir accès aux archives (art. 10 al. 1 Règlement).
Le Tribunal pénal fédéral connaît le même paradigme (art. 10 et 12 du Règlement sur l’archivage au Tribunal pénal fédéral ; RS 152.12).
Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’on observe que les durées de conservation des décisions judiciaires peuvent être comprises entre 2 et 100 ans selon la nature de l’affaire, voire une durée indéfinie. On constate que les durées inférieures à 10 ans sont plus rares et se limitent essentiellement à la conciliation et à la procédure sommaire (art. 12 al. 1 let. a RArch JCP ; art. 6 al. 2 let. b Directives Fribourg). Parfois, une durée minimale est fixée, mais pas de durée maximale, ce qui laisse une incertitude importante sur la durée finalement retenue. Ceci est d’autant plus vrai si les données ne sont pas détruites mais sont transmises aux Archives en raison de leur valeur archivistique.
Les pratiques cantonales sont diverses et les règles adoptées plus ou moins précises. Ceci est certainement le résultat de l’interprétation du principe de proportionnalité par les cantons. L’on s’étonne toutefois que les tribunaux fédéraux ne soient pas soumis à des règles plus précises sur cette question, vu le principe de proportionnalité ancré de longue date dans la LPD.
Tout en veillant à ne pas trop complexifier le système, le principe d’une gradation semble pertinent, l’importance objective d’une décision pouvant varier nettement selon son contenu. Cela correspond aux principes appliqués dans certains cantons pour la conservation des décisions pénales (cf. art. 13 RArch JCP ; art. 6 al. 1 Directives FR). Cela va aussi dans le sens du principe de proportionnalité ancré à l’art. 6 al. 2 et 4 LPD.
D’autres acteurs, notamment les études d’avocats, les associations et commissions professionnelles et sportives, pourront s’inspirer de ces règles lors de la fixation des durées de conservation qu’ils appliqueront.
Enfin, il sied de rappeler que l’anonymisation des décisions judiciaires devrait permettre non seulement de remplacer la destruction de celles-ci au terme de la durée de conservation, mais également de les publier sans attendre. En effet, si les décisions judiciaires sont caviardées minutieusement, elles échappent aux règles en matière de protection des données, faute de contenir des données relatives à des personnes identifiées ou identifiables. À titre illustratif, le législateur genevois a expressément prévu ce caviardage pour que le public puisse accéder aux décisions rendues, favorisant ainsi la discussion et le développement de la jurisprudence (cf. notamment art. 20 al. 4 et 5 LIPAD ; RS GE A 2 08).
Proposition de citation : Anne Dorthe, Décisions judiciaires cantonales et fédérales : Quelle durée de conservation ?, 4 décembre 2023 in www.swissprivacy.law/270

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.