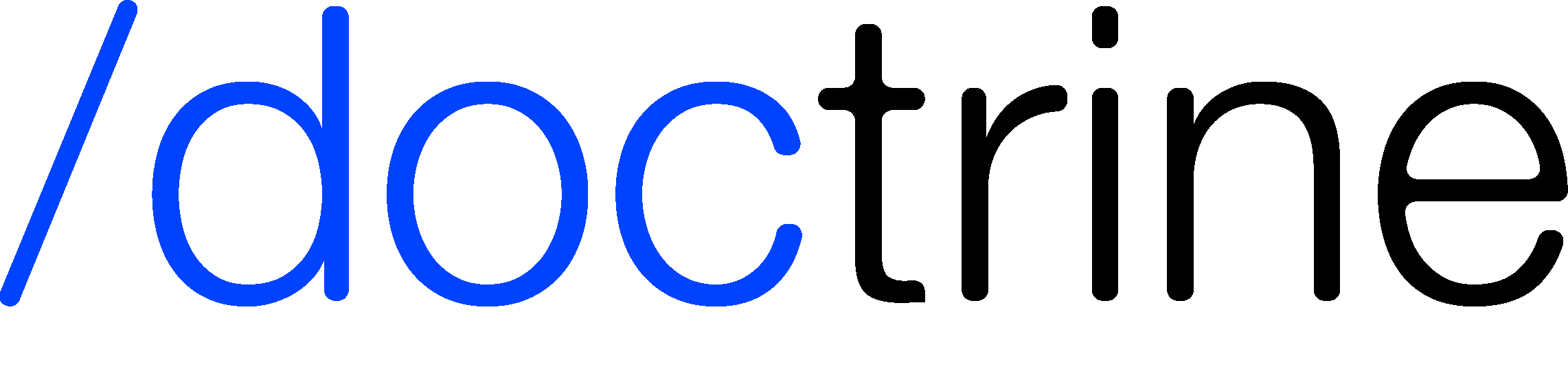L’accessibilité des données issues de l’« Event Data Recorder » en procédure pénale

La présente contribution est une synthèse de l’article scientifique du même auteur publié en open access au sein de la dernière édition de la revue Ex/Ante.
I. Introduction
Les technologies embarquées dans les véhicules jouent un rôle clé en matière de sécurité routière. Parmi ces dispositifs, l’« Event Data Recorder » (ci-après : EDR), ou « enregistreur de données d’événement », occupe une place particulière en tant qu’outil capable d’enregistrer des informations cruciales en cas d’événement, c’est-à-dire généralement un accident impliquant un véhicule automobile. L’EDR est un système embarqué dans le véhicule qui mesure en permanence un certain nombre de données, mais ne les enregistre que lorsqu’un changement de vitesse de plus de 8 km/h intervient en l’espace de 150 millisecondes ou lors du déclenchement de systèmes non réversibles, comme le déploiement de l’airbag. Ces données sont enregistrées depuis cinq secondes avant l’événement jusqu’à 300 millisecondes après l’événement. Elles sont généralement stockées dans le module de contrôle des airbags. Il garde en mémoire les données dynamiques du véhicule, notamment la vitesse avant l’événement, la position des freins, de la pédale d’accélérateur, l’angle de direction, les changements de vitesse dus à l’événement, le statut des ceintures, le déclenchement des airbags.
En Suisse, l’art. 102a OETV, en vigueur depuis le 1er avril 2024, intègre le règlement de droit européen (UE) 2019/2144 et le règlement délégué (UE) 2022/545. Il oblige les nouveaux véhicules à être équipés d’un EDR. Cette obligation est reprise selon le même calendrier que l’UE : les voitures de tourisme et les voitures de livraison importées devaient en être munies au plus tard dès une importation au 7 juillet 2024.Pour les minibus, les autocars, les camions et les tracteurs à sellette, l’obligation s’appliquera à partir du 7 janvier 2029 au plus tard.L’annexe 2 de l’OETV indique quels systèmes sont reconnus en droit suisse, bien qu’une équivalence soit possible pour autant qu’elle soit prouvée par le constructeur. Il convient également de souligner que, bien que les véhicules importés avant ces dates et déjà en circulation ne doivent pas être équipés de tels dispositifs, de nombreux constructeurs ont déjà intégré des EDR dans leurs véhicules sur une base volontaire.
L’EDR est un module électronique supplémentaire dans une unité de commande électronique existante. Il ne constitue donc pas un dispositif autonome indépendant du véhicule. Sur le plan technique, l’EDR se distingue de la fameuse « boîte noire » que l’on retrouve notamment dans les avions par le fait qu’il n’enregistre pas les données en continu tout au long du fonctionnement du véhicule, mais uniquement sur une courte période autour de l’accident. La précision en droit américain selon laquelle l’EDR n’enregistre pas de données audio ou vidéo, reprise depuis en droit européen et national, est capitale, les boîtes noires enregistrant parfois des communications radio ou des bruits environnants.
Pour récupérer les données enregistrées dans l’EDR, un « Crash Data Retrieval » a été développé par Vetronix Coroporation, puis racheté par l’entreprise allemande Robert Bosch GmbH dans les années 2000. Cet appareil a été commercialisé par la suite sous le nom de « Bosch Crash Data Retrieval » (ci-après : Bosch CDR) et est aujourd’hui compatible avec la plupart des véhicules des constructeurs. Il est d’ailleurs possible de trouver actuellement en ligne un kit d’outils Bosch CDR contenant tout le matériel nécessaire pour effectuer une récupération des données issues d’un EDR pour une valeur de 5 900 USD. Par conséquent, il est théoriquement possible pour un justiciable d’extraire lui-même les données d’un EDR en cas d’absence d’intervention de la police, pour les produire en procédure pénale ou auprès de son assurance civile pour prouver une éventuelle absence de faute.
II. « Traces numériques » ou « enregistrements » ?
En cas d’accident, les traces de freinages, de peintures, d’impacts, etc. sont recueillies et mises en sécurité par la police sur la base de l’art. 306 al. 2 let. a CPP. L’intervention de la police dans ce cadre est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation du Ministère public. En effet, la police doit pouvoir entreprendre les premières investigations même sans ordre du Ministère public. Dans ce contexte, les données issues de l’EDR pourraient ainsi être considérées comme des « traces » au sens de l’art. 306 al. 2 let. a CPP. Néanmoins, la question de l’applicabilité de l’art. 246 CPP se pose, car si les données provenant d’un EDR devaient être considérées comme des « enregistrements », alors une perquisition d’enregistrement devrait être prononcée.
A) La solution dite des « traces numériques »
La première solution analysée consiste à considérer les données extraites d’un EDR comme des « traces » qui doivent être mises en sûreté par la police au sens de l’art. 306 al. 2 let a CPP. Cette solution doit selon nous être qualifiée de pragmatique, puisqu’elle considère à juste titre qu’il n’est pas possible de s’opposer à un éventuel mandat de perquisition des données issues de l’EDR par la mise sous scellés, aucun secret ne pouvant raisonnablement être invoqué au sens de l’art. 248 CPP. En effet, la modification du 17 juin 2022 du CPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, définit de manière encore plus restrictive les motifs de mise sous scellés. En ce qui concerne les données issues d’un EDR, il convient de rappeler que ce dernier n’enregistre en principe les informations que cinq secondes avant l’événement. Il est donc difficile d’imaginer quel secret pourrait être invoqué pour justifier la mise sous scellés au sens de l’art. 248 al. 1 CPP, surtout que le texte de ce dernier a été modifié pour que l’intéressé ne puisse plus invoquer « d’autres motifs » pour faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner. De même, quand bien même les données issues d’un EDR seraient qualifiées de « documents personnels » au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP, l’intérêt public lié à la poursuite pénale primerait vraisemblablement sur l’intérêt de la personne concernée à la protection de sa sphère privée, en raison de la nature de ces données.
Le Tribunal fédéral est d’ailleurs d’avis que les objets qui ne sont manifestement pas protégés par un secret et qui ne se prêtent pas à une perquisition et à une levée de scellés peuvent être dispensés de scellés et le Ministère public peut les affecter à un autre usage. Jositsch et Schmid estiment en effet que les objets qui ne sont ni des documents, ni des enregistrements, ni des supports de données et qui ne portent pas atteinte à des droits de confidentialité dignes de protection ne sont pas soumis à la perquisition au sens des art. 246 ss CPP, mais confisqués ou saisis. Dellagana-Sabry pense enfin que les documents et enregistrements incriminants et non couverts par un secret protégé ou par un autre motif peuvent faire l’objet d’une perquisition contre laquelle l’opposition au sens de l’art. 248 CPP n’est pas possible. Par conséquent, il peut être argumenté que la police devrait librement pouvoir mettre en sûreté les données issues de l’EDR au sens de l’art. 306 al. 2 let. a CPP, puisque même dans l’hypothèse où une ordonnance de perquisition devrait être exigée, le justiciable ne pourrait pas justifier une mise sous scellés qui empêcherait l’autorité judiciaire d’obtenir finalement les données en question.
B) La solution dite des « enregistrements »
La seconde solution analysée consiste à considérer les données extraites d’un EDR comme des « enregistrements » devant être perquisitionnés au sens de l’art. 246 CPP. Selon nous, cette solution doit être qualifiée de prudente, car elle a le mérite de préserver l’intégrité de la procédure pénale dans l’éventualité où les données extraites ne peuvent être qualifiées de « traces numériques ». En effet, si les données de l’EDR devaient bien être qualifiées d’« enregistrement », alors une perquisition effectuée par la police sans mandat préalable et en l’absence de péril en la demeure contreviendrait à l’art. 241 al. 1 CPP.
À ce propos, l’art. 241 al. 3 CPP n’entre en ligne de compte que lorsqu’à défaut d’une perquisition immédiate, la perte du moyen de preuve est à craindre. Aussi, même si les données d’un EDD peuvent être abimées, nous nous rallions à l’opinion de Keller qui considère qu’il est pratiquement exclu de retenir une urgence en cas de perquisition d’enregistrements, car il n’est guère probable que le Ministère public soit injoignable, au moins pour ordonner la perquisition des documents par oral. À titre d’exemple, il convient de relever que le Tribunal fédéral considère que la fouille d’un téléphone portable par des agents de police sans mandat constitue « eine Durchsuchung von Aufzeichnungen im Sinne von Art. 246 StPO », peu importe la manière dont la perquisition a eu lieu. Enfin, il y a lieu de remarquer que l’exigence de mandat posée par l’art. 241 al. 1 CPP ne constitue pas toujours une prescription d’ordre dont la violation serait sans effet sur le caractère exploitable des preuves récoltées. Il faut en effet se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce. Par conséquent, bien que la police ait un devoir de mettre en sûreté les traces et les preuves (art. 306 al. 2 let. a CPP), la perquisition est une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, qui a également pour objectif de mettre les preuves en sûreté (art. 196 let. a CPP).
C) La solution dite « hybride »
Nous attribuons à cette dernière solution le qualificatif d’« hybride » car elle combine des éléments des deux solutions précédemment analysées. La solution hybride se compose de deux étapes. Dans un premier temps, les données issues de l’EDR sont considérées comme des « traces numériques » et doivent être mises en sûreté par la police au sens de l’art. 306 al. 2 let. a CPP. Dans un second temps, l’analyse des données récoltées est considérée comme une « Durchsuchung der Aufzeichnungen » : les données sont ainsi considérées comme un enregistrement et nécessitent un mandat de perquisition au sens de l’art. 246 CPP. Cette solution doit selon nous être qualifiée de pratique, car elle a le mérite de se concentrer à la fois sur la conservation des données et sur le respect de l’intégrité de la procédure. Le raisonnement derrière ces deux étapes est le suivant : les données stockées dans l’EDR ne contiennent aucune indication sur le conducteur du véhicule, ni aucune information sur la localisation spatiale ou temporelle d’un événement. Aussi, la possibilité de mettre en relation des données de collision issues d’un EDR avec un conducteur n’est pas différente de celle de mettre en relation des traces analogues avec un conducteur. Ces deux types de traces n’ont aucun rapport avec des pensées humaines, c’est pourquoi il ne s’agit pas d’« enregistrements » au sens du CPP.
En effet, bien que l’art. 306 al. 2 let. a CPP ne fasse pas la distinction entre « trace analogue » et « trace numérique », ce critère est important du point du vue de l’art. 246 CPP. La lettre de l’art. 246 CPP exprime de manière large la notion « d’enregistrements ». Le législateur a en effet voulu une formulation étendue afin que les progrès technologiques à venir en matière de stockage ou de traitement de données puissent encore être perquisitionnés. C’est pourquoi la majorité de la doctrine retient que les enregistrements englobent tous les supports de données, c’est-à-dire les supports d’expression de la pensée humaine, indépendamment de la manière dont ils sont stockés, en particulier ceux qui se trouvent sous forme électronique dans des supports de stockage.
III. Analyse critique : prudence est mère de sûreté
Alors, quelle solution suivre ? La solution des traces numériques — pragmatique —, la solution des enregistrements — prudente —, ou la solution hybride — pratique — ? Pour répondre, il convient premièrement de rappeler que l’art. 246 CPP est une mesure de contrainte visant à mettre les preuves en sûreté au sens de l’art. 196 al. 1 let. a CPP. La perquisition de documents et enregistrements (art. 246 CPP) est un acte de procédure qui porte atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). Par conséquent, la perquisition doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public, être proportionnée au but visé et ne pas violer l’essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.). Il s’agit en effet d’une perquisition d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier. En vertu de l’art. 198 CPP en relation avec l’art. 241 al. 1 CPP, de telles perquisitions de documents et de supports de données doivent être en principe ordonnées par le ministère public (éventuellement le tribunal du fond).
Deuxièmement, il convient de préciser qu’en cas de perquisition, l’ayant droit doit pouvoir invoquer, en plus des éventuels secrets, des objections accessoires, telles que l’insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction, l’absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition, puisqu’il n’est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d’une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite ou encore des privilèges et immunités internationaux et nationaux, qui jouissent en principe d’une protection complète, sous réserve notamment d’une levée de ceux-ci. Aussi, la voie du recours prévue à l’art. 393 CPP entre en ligne de compte si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé par le maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi être ouvert, puisque l’intéressé ne peut défendre ses droits au cours d’une procédure de levée de scellés. Par conséquent, selon nous, la simple absence de motif de scellés ne suffit pas à écarter d’emblée la nécessité d’un mandat de perquisition, puisque d’autres motifs d’inexploitabilité doivent pouvoir être invoqués par le justiciable.
Troisièmement et à notre avis les données issues d’un EDR peuvent être mises en relation avec une idée humaine. En effet, bien que ces données ne caractérisent pas directement le conducteur, elles reflètent, selon nous, l’expression d’une pensée humaine : une soudaine accélération avant un accident révèle quelque chose sur l’intention du conducteur tout comme un freinage peut traduire l’intention d’éviter un accident. La difficulté réside en réalité dans l’interprétation des données selon la probable volonté du justiciable. On peut objecter que des traces analogues présentent les mêmes caractéristiques que leur contrepartie numérique enregistrée dans l’EDR, sans qu’elles ne puissent pour autant être qualifiées d’« enregistrements ». Toutefois, selon nous, la différence réside dans le support électronique. En effet, le législateur a voulu faire preuve de prudence face aux enjeux liés à la protection de la sphère privée dans le cadre de l’évolution des technologies. Par conséquent, les documents et enregistrements visés à l’art. 246 CPP correspondent à l’ensemble des supports d’information envisageable susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve. En somme, cela concerne n’importe quelle information figurant sur n’importe quel support. Le terme de « traces numériques » au sens de « trace » pour l’art. 306 al. 2 let. a CPP, doit être compris en opposition avec l’art. 246 CPP, et doit donc, selon nous, être réservé à des données n’ayant aucun rapport avec l’action humaine (p. ex. les données issues d’une machine mesurant la température). C’est pourquoi, selon nous, il n’est pas possible de considérer dans un premier temps que des données issues d’un EDR ne reflètent pas l’expression des pensées du justiciable afin de pouvoir les mettre en sûreté, puis de considérer ces dernières comme un enregistrement au moment de l’exploitation des données. Le contraire reviendrait à admettre que les données en question acquièrent soudainement, une fois mises en sûreté, un rapport avec une idée humaine nécessitant la mise en place d’une mesure de contrainte portant atteinte à la sphère privée des personnes intéressées. De plus, il convient de souligner qu’en tant que mesure de contrainte, l’art. 246 CPP a pour objectif de mettre les preuves en sûreté (art. 196 let. a CPP) et non d’autoriser leur analyse.
Finalement, la solution de l’enregistrement doit selon nous s’imposer, car elle respecte la lettre et l’esprit de la loi, spécialement de l’art. 246 CPP. Ce dernier a été conçu par le législateur comme étant le plus inclusif possible en prévision des futures avancées technologiques. Par conséquent, il convient selon nous d’opter pour la solution la plus prudente, en accord avec la volonté du législateur.
IV. Quid de l’art. 102a al. 1 OETV ?
L’art. 102a al. 1 OETV prévoit expressément que les autorités responsables de l’étude et de l’analyse des accidents sont les seules à pouvoir traiter les données issues des EDR. Il est alors légitime de qualifier cet article de lex specialis par rapport au CPP, puisqu’il serait inutile d’introduire une disposition qui prévoit l’accès à ces données aux autorités si, d’un autre côté, le CPP prévoyait des limites à cet accès en imposant la nécessité d’un mandat de perquisition. Toutefois, cette conclusion se heurte à un obstacle pratique important. L’obligation d’équiper les voitures d’une EDR introduite par l’art. 102a al. 1 OETV suit le même calendrier que l’UE. Ainsi, les voitures de tourisme et les voitures de livraison importées en Suisse doivent en être munies au plus tard dès la date d’importation du 7 juillet 2024. Pour les minibus, les autocars, les camions et les tracteurs à sellette, l’obligation s’appliquera à partir du 7 janvier 2029 au plus tard. Néanmoins, la plupart des voitures de tourisme et de livraison actuellement en circulation et équipées d’un EDR ont été importées en Suisse avant le 7 juillet 2024. Par conséquent, l’obligation de l’art. 102a al. 1 OETV n’est, à l’heure actuelle, pas applicable à la très grande majorité des véhicules circulant en Suisse. Cette transition progressive implique donc une cohabitation temporaire entre les deux cadres juridiques jusqu’à ce que l’art. 102a OETV devienne pleinement applicable.
Proposition de citation : Leonardo Gomez Mariaca, L’accessibilité des données issues de l’« Event Data Recorder » en procédure pénale, 10 juillet 2025 in www.swissprivacy.law/365

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.