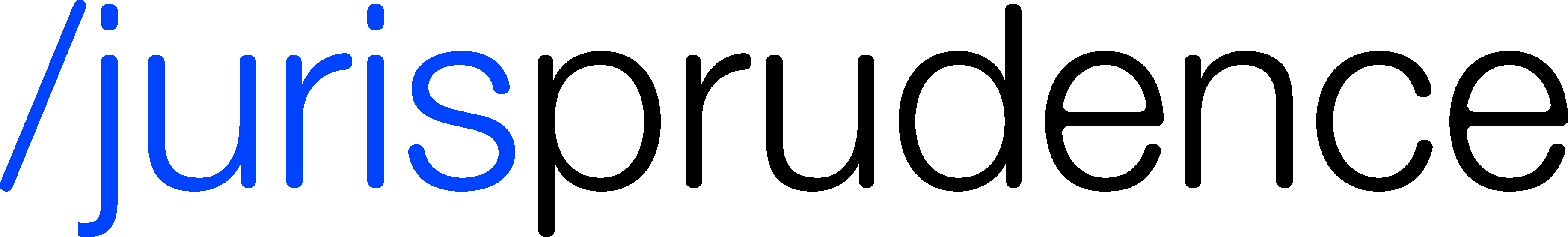Le droit d’accès à un dossier de police : méli-mélo romand

Cour de justice, Chambre administrative, ATA/115/2021 du 2 février 2021
L’affaire concerne l’exercice, par un administré genevois de son droit d’accès au sens des art. 44 ss de la Loi genevoise du 5 octobre 2001 sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD ; RS/GE A 2 08). L’administré sollicite en septembre 2020 l’accès à une main courante concernant des faits remontant à 2018 détenue par la police genevoise. Cette main courante, qui a été déposée par l’une des anciennes enseignantes du fils de l’administré, n’a toutefois débouché sur aucune plainte pénale et n’a pas fait l’objet d’une instruction par la police genevoise.
La demande de l’administré s’inscrit en parallèle d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Au cours de cette procédure, l’administré apprend l’existence de cette main courante par le biais d’un rapport d’évaluation dressé par le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale. Dans le cadre de ce rapport, le service en question a été amené à interroger deux enseignantes du fils de l’administré. Ceux-ci ont informé avoir ouï dire qu’une main courante avait été déposée par l’une de leurs collègues, en la nommant explicitement. Il appert que les deux enseignantes ont appris l’existence de cette main courante dans le cadre d’une discussion dans la salle des maîtres.
Contrairement à l’avis du Préposé cantonal, la commandante de la police genevoise rejette la demande au motif que la main courante a été déposée par un tiers, lequel dispose d’un intérêt privé à la non-communication des informations, en particulier de son nom. La commandante précise en outre que la main courante en question correspond à un extrait du journal contenant un résumé de toutes les opérations effectuées par la police dans le cadre de ses missions et que celui-ci doit être considéré comme un document à usage strictement interne.
L’administré faisant usage de son droit de recours, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève est amenée à préciser sa jurisprudence relative à l’accès à des données personnelles contenues au sein d’une main courante figurant dans un dossier de police. Plusieurs problématiques sont abordées par la Chambre.
Premièrement, la Chambre rappelle que la protection de la personnalité des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est régie par la Loi genevoise du 29 septembre 1977 sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM ; RS/GE F 1 25). Bien que secrets, les dossiers et fichiers de police, et en particulier les données personnelles traitées en application de la LCBVM, ne sont pas soustraits de l’application de la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM).
Deuxièmement, la Chambre souligne que le journal de bord dans lequel la main courante est inscrite fait partie intégrante du dossier de police, quand bien même celui-ci n’a pas une valeur probante. Le journal de bord ne peut donc pas être considéré comme un document à usage strictement interne.
Troisièmement, la Chambre précise que l’accès aux données personnelles n’est pas absolu et peut être refusé si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie. En l’espèce, la Chambre procède à une pesée des intérêts entre, d’une part, l’intérêt de l’administré d’obtenir copie de la main courante au vu des enjeux de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et, d’autre part, l’intérêt du tiers à conserver l’anonymat.
Sur ce point, la Chambre estime que l’intérêt privé de l’enseignante à conserver l’anonymat est grand. Il a toutefois perdu de l’importance au vu des renseignements fournis au service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, ceux-ci ayant été révélés par l’enseignante elle-même à ses collègues. Partant de ce constat, la Chambre administrative estime que l’intérêt de l’administré l’emporte, ce qui lui permet d’avoir accès à la main courante sans que l’identité de l’enseignante ne soit caviardée.
Protection des données dans le cadre de la coopération Schengen
L’arrêt de la Chambre administrative met en lumière la question de l’accès à un dossier de police contenant des données personnelles. À cet égard, les traitements de données personnelles à des fins de prévention, d’élucidation et de poursuites d’infractions ou d’exécutions de sanctions pénales font l’objet de règles spécifiques, tant au niveau de la Confédération qu’au niveau des cantons. Ces règles trouvent leur origine dans le cadre des acquis de Schengen.
En tant qu’État associé à Schengen, la Suisse s’est en effet engagée à accepter, à mettre en œuvre et à appliquer tout développement de l’acquis de Schengen. Dans ce contexte, la Directive 2016/680 de l’Union européenne joue un rôle particulier en ce sens qu’elle établit des règles spécifiques relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales.
Comme pour chaque pays membre de l’Union européenne, la Directive 2016/680 a nécessité de la part de la Suisse un travail de transposition au sein de son ordre juridique interne, et ce dans un délai relativement court. Cette transposition a donné lieu au niveau fédéral à l’adoption de la Loi fédérale sur la protection des données Schengen (LPDS). Désormais, les traitements de données personnelles effectués par des organes fédéraux dans un des buts susmentionnés sont notamment délimités par la LPDS, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données.
S’agissant des traitements de données personnelles par des organes cantonaux, le cadre est pour sa part délimité par les législations cantonales en matière de protection des données, mais aussi par différentes législations cantonales spécifiques, comme celles consacrées aux dossiers de police judiciaire. L’adoption de la Directive 2016/680 par la Suisse entraîne dans son sillage l’obligation pour les cantons de réviser leurs législations sur la protection des données afin de les adapter aux nouvelles prescriptions. Au 20 avril 2021, les révisions étaient achevées dans sept cantons et déjà en vigueur dans six d’entre eux. Privatim tient à jour une liste donnant un aperçu de l’état d’avancement des travaux d’adaptation dans les cantons.
Précisons encore que la reprise de la Directive 2016/680 par la Suisse et par les cantons est cruciale, notamment au vu du mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen. La Suisse a d’ailleurs fait l’objet de trois évaluations à ce jour. Une première évaluation, menée en 2008, concernait les cantons du Tessin et de Fribourg, en plus de la Confédération. Une seconde évaluation, menée en 2014, visait cette fois-ci les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Cette seconde évaluation a donné lieu à des recommandations du Conseil de l’Union européenne, dont un condensé peut être consulté sur le site web du Préposé Jura-Neuchâtel. Une troisième évaluation, dirigée en 2018, s’intéressait à la situation au niveau de la Confédération ainsi que dans le canton de Lucerne. Cette troisième évaluation a également débouché à des recommandations du Conseil de l’Union européenne, exigeant des mesures correctives quant à des manquements constatés.
L’accès à un dossier de police judiciaire dans le canton de Vaud
Les traitements de données personnelles menées par l’administration cantonale vaudoise, ainsi que par les communes vaudoises, sont soumis à la Loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD).
Comme chaque législation de protection des données, la LPrD contient des dispositions générales ancrant les principes à suivre en cas de traitement de données personnelles, mais également les obligations que chaque responsable du traitement doit respecter, ainsi que les droits des personnes concernées.
La LPrD prévoit également des exceptions à son champ d’application (art. 3 al. 3). Parmi ces exceptions, la let. c dispose que la LPrD ne s’applique pas aux données personnelles traitées en application de la loi fédérale sur le renseignement et de l’art. 2 al. 1 de la Loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LPDJu). Cette exception a été ajoutée lors d’une révision partielle de la LPrD, entrée en vigueur 1er octobre 2018.
Au vu de ce qui précède, et bien que la police cantonale reste soumise à la LPrD dans ses autres activités quotidiennes, les traitements de données personnelles utiles à la prévention, à la recherche et à la répression d’un crime, d’un délit ou d’une contravention relevant du droit pénal fédéral et conservées au sein de dossiers de police judiciaire sont exclusivement régis par la LPDJu. Cette dernière prévoit une procédure atypique s’agissant du droit d’accès à ses données personnelles conservées au sein d’un dossier de police judiciaire.
Selon l’art. 8a al. 1 LPDJu, toute personne peut demander des renseignements sur les données la concernant qui sont contenues dans les dossiers de police judiciaire, sous réserve des dispositions sur l’enquête prévues par le Code de procédure pénale. Conformément au second alinéa, ce droit d’accès peut être limité, suspendu ou refusé si un intérêt public prépondérant l’exige. Atypique, la procédure de droit d’accès prévue par la LPDJu prévoit trois particularités qui suscitent notre questionnement :
- l’ 8b LPDJu, lu conjointement avec l’art. 8c al. 1 LPDJu, prévoit que la demande de droit d’accès doit être adressée au juge cantonal désigné par le Tribunal cantonal, et traitée par ce dernier ;
- l’ 8c al. 3 LPDJu dispose que le requérant doit « rendre vraisemblable que des renseignements personnels à son sujet sont susceptibles de porter atteinte à sa liberté personnelle ». À défaut, le juge peut écarter la demande ;
- l’ 8c al. 5 LPDJu souligne que la décision du juge est définitive.
S’agissant du premier point, il est surprenant de voir que le législateur cantonal a choisi de laisser à charge d’un juge cantonal le devoir de traiter une telle demande. Dans une telle hypothèse, le juge se substitue au responsable du traitement, alors même que ce dernier est plus à même de coordonner la requête et de collecter les données concernées par la demande (ainsi que les documents).
Sur le deuxième point, soit le fait de conditionner le droit d’accès à la vraisemblance d’une atteinte à la liberté personnelle de la personne concernée, cela nous paraît contradictoire avec les règles établies au sein de la LPDS, qui renvoient aux dispositions de la LPD en ce qui concerne une demande de droit d’accès, ainsi qu’à la Directive 2016/680.
En sus, il est choquant de conditionner le droit d’accès à un quelconque intérêt. Il ne fait aucun doute que la protection des données a pour but la protection de la personnalité et que le droit d’accès représente en quelque sorte l’institution clé concrétisant cet objectif. Sans possibilité d’accéder à ses données, nul ne pourrait effectivement faire valoir ses droits en la matière. Pour ce faire, le requérant est en effet obligé de connaître les traitements de données personnelles le concernant, mais aussi le contenu de ces données. Le droit d’accès permet ainsi de vérifier leur exactitude et, le cas échéant, de les faire rectifier ou détruire. Dans la mesure où la personne concernée n’est pas forcément sûre que des données la concernant sont traitées, il paraît compliqué de lui demander de rendre vraisemblable que celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à sa liberté personnelle.
Troisième et dernier point, la décision du juge est définitive. La saisine du Préposé cantonal n’est ici pas prévue, pas plus que le recours auprès du Tribunal cantonal (ce qui aurait été assurément étrange puisque la décision est rendue par l’un des siens), sous réserve de l’arbitraire. Le requérant est ainsi obligé d’introduire un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Cette solution nous semble particulièrement critiquable, tant elle complique l’accès aux données. Nous sommes d’avis que la solution d’une procédure de conciliation menée par le Préposé cantonal aurait dû être mise en place.
Au vu de ce qui précède, nous pouvons dire que l’accès à un dossier de police judiciaire dans le canton de Vaud relève du parcours du combattant, alors même qu’un système plus simple aurait pu être mis en place. Cela n’a néanmoins pas empêché deux administrés téméraires de porter leur cause au Tribunal fédéral. Les affaires concernaient toutefois la destruction de données personnelles consignées dans un dossier de police judiciaire (TF 1C_363/2014 du 13 novembre 2014 et TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020). Dans les deux arrêts, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
Outre les difficultés relevées, nous doutons également de la conformité du système vaudois avec le droit supérieur, et en particulier avec les développements liés à l’Acquis Schengen. À cet égard, un groupe de travail a été constitué et a la charge de préparer un avant-projet de loi qui, nous l’espérons, prendra également en compte les problématiques posées par la LPDJu.
Proposition de citation : Livio di Tria, Le droit d’accès à un dossier de police : méli-mélo romand, 21 mai 2021 in www.swissprivacy.law/73

 Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.
Les articles de swissprivacy.law sont publiés sous licence creative commons CC BY 4.0.